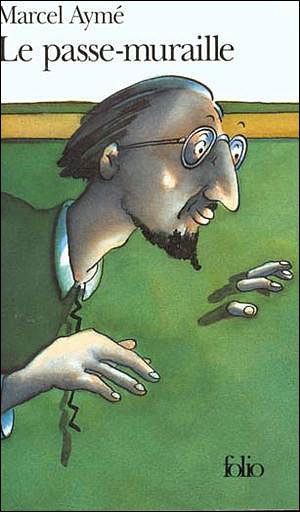Comme quoi, le fantastique n’est pas un sous-genre. C’est l’occasion, en octroyant aux hommes, comme un Dieu taquin des facultés extraordinaires, et en racontant l’usage qu’ils en font, d’illustrer sa conception de la condition humaine. Et celle de Marcel Aymé n’est pas très flatteuse. Les pouvoirs qu’il donne à ses personnages, que ce soit le passage à travers les murs ou l’ubiquité, en leur permettant de s’affranchir des lois humaines, vont leur permettre de satisfaire leurs plus bas instincts. Là-dessus, l’auteur aurait beaucoup à remontrer aux producteurs de platitudes super héroïques américaines : ayant quelque chose à dire, s’amusant malicieusement des situations qu’il met en scène, il pousse ses concepts jusqu’au bout. Et ces concepts font preuve d’une inventivité telle qu’on s’étonne parfois de ne pas les avoir vu repris postérieurement : ainsi l’idée de la carte permettant de vivre plus ou moins de jours dans un mois, destinée à l’origine, dans un contexte de pénurie, à restreindre la consommation de vivre des bouches inutiles au profit des travailleurs utiles, mais qui, dégénérant vite par le marché noir, finit par donner la situation inverse, et même paradoxale de riches accumulant plus de jours de vie mensuelle qu’il n’y a de jours dans le mois… on le voit, comme dans Uranus, la dimension sociale n’est pas absente (on a aussi l’exemple du récit émouvant de l’enfant et de sa mère pauvre et de la botte fantastique) ; la dimension sociale contribue-t-elle à faire la qualité d’un roman ? Je ne sais pas. Je pose la question. J’imagine que le récit se fait plus réaliste, et universel.
De la très bonne littérature fantastique.