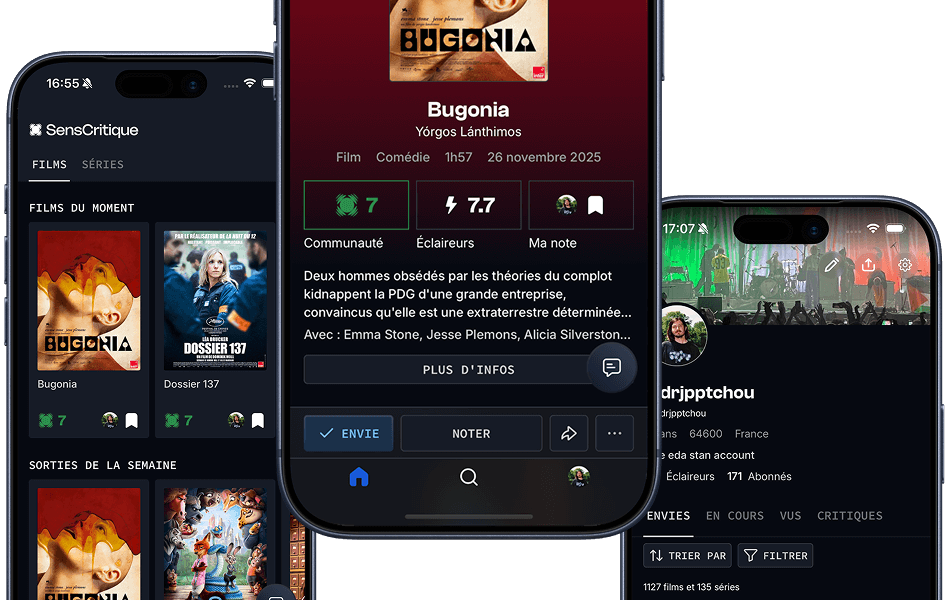« Maître, donne-nous ton avis : Est-il permis oui ou non de payer l’impôt à César ? »
Ce passage célèbre de l'Evangile selon Luc nous relate un piège que les pharisiens tendent à Jésus afin de le livrer. Faut-il répondre "oui" et passer aux yeux des juifs pour un collaborateur de l’occupant romain, ou bien répondre "non" et donc faire acte de sédition face à l’autorité politique ? La réponse, on le verra, sera riche en conséquences :
« Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple ; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. »
Les miracles de Jésus relatés dans le Nouveau Testament sont traditionnellement beaucoup commentés. Ce faisant, ne passe-t-on pas à côté du véritable miracle ? Car la distinction - ne serait-ce que théorique - entre "Dieu" et "César" est une véritable anomalie historique : il a toujours été bien plus naturel à l’homme de confondre en une même entité le spirituel et le temporel.
La fusion du temporel et du spirituel : le "monisme"
Chez les grecs, la conjonction du politique et du religieux se réalise concrètement dans la cité. Les lois édictées par la cité grecque sont sacrées et sont le reflet de la religiosité du Cosmos. C’est la sacralité de la loi de la Cité qui fait que Socrate, condamné à mort de manière légale, a préféré mourir plutôt que de désobéir à la loi. Il est condamné pour avoir porté atteinte à la religion de l’Etat.
Les grandes civilisations de l’Antiquité (greco-latine ou égyptienne) se définissent par l’imbrication du politique et du religieux. Dans toutes les cultures (l’auteur développe aussi l’exemple de la Chine), les réalités politiques possèdent une dimension sacrée. Elles la possèdent en elles-mêmes, et n’ont nul besoin de la recevoir d’ailleurs. Le roi est en même temps le prêtre de la cité : « l’Etat était une communauté religieuse, le roi un pontife, le magistrat un prêtre, la loi une formulation sainte, où le patriotisme était la piété, l’exil une excommunication. L’homme était asservi à l’Etat par son âme, par son corps, par ses biens. »
Ainsi de la structure politico-religieuse de la Rome impériale : César est le grand pontife, le chef de la religion romaine, le gardien des croyances. Sa personne même était sacré et divine. Sur ce point, les romains ne font que reprendre la tradition de la royauté antique.
La tentation de confondre les deux domaines refait aussi surface très fréquemment durant l’histoire occidentale sous une forme ou une autre : millénarisme chrétien, marxisme, national-socialisme, théories politiques d’Auguste Comte ou de Saint-Simon. Mais c'est peut-être Rousseau qui a le mieux exprimé l’aspiration de l’être humain à l’unité profonde du politique et du religieux. Dans un passage du Contrat Social il récuse la distinction chrétienne du spirituel et du temporel, l’unité devant alors être retrouvée par la sainteté du contrat social et des lois :
« Tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien. Toutes les institutions sociales qui mettent l’homme en contradiction avec lui-même ne valent rien ; [...] Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon citoyen ni sujet fidèle ».
Jésus et la "Loi divine"
Pourquoi Jésus ne fut-il pas accepté par bon nombre de juifs comme le "messie" tant attendu ?
Le messianisme juif aspirait à un sauveur de nature politique devant restaurer la justice divine sur terre en créant une cité terrestre sur le modèle du royaume céleste. Le messie devait être un roi de guerre victorieux, chassant l’occupant romain. Le messianisme juif ne distinguait pas non plus le spirituel du temporel. L'Ancien Testament est par ailleurs riche en prescriptions juridiques émanant de Yahvé.
Et pourtant, Jésus affirme que « mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » (Jean, 18, 36). Dans la même idée, le récit évangélique raconte que la foule qui le suivait, émerveillée par ses miracles, s’apprêtait à le proclamer roi. Afin d'éviter cela, il décide de fuir dans la montagne (Jean, 6, 14-15).
Le fondateur du christianisme semble aussi avoir opposé un veto radical à la tentation de créer du droit : il n’existe pas de règles juridiques d’origine divine directe. Ainsi cet épisode où il refuse de régler un conflit qu’on lui soumettait à propos d’une affaire d’héritage, « qui est-ce qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » (Luc, 12, 13-15).
Contrairement à d’autres passages bibliques - l’Ancien Testament est d’inspiration messianique juive - l’Evangile tranche par sa stérilité juridique. Chesterton, dans L’homme éternel, exprime très bien le vide juridique étrange qui se dégage des Evangiles, en prenant un exemple particulier, celui de l’esclavage :
« Le Christ comme Aristote a vécu dans un monde où l’esclavage était tenu pour normal. Le Christ ne parla pas contre l’esclavage. Le mouvement qu’Il fondait pouvait exister dans un monde pratiquant l’esclavage comme il pouvait aussi exister dans un monde ne le pratiquant pas. Le Christ ne dit jamais un mot qui aurait fait dépendre son enseignement de l’état de la société où Il vivait. Il enseignait comme quelqu’un qui sait que tout passe. » Le juridique, au contraire, possède une orientation très nette : celle de fixer.
Ces paroles fondatrices font de la cité idéale du christianisme – le Royaume de Dieu – un élément purement céleste. Jésus change en fait radicalement l’orientation du messianisme juif : il le déplace de la terre vers le ciel. Le christianisme n’envisage pas de rédemption collective terrestre par une cité parfaite, mais propose exclusivement un salut individuel céleste. Il contient "en germe" l’autonomisation de la cité terrestre.
La querelle des "monismes"
Le christianisme a presque toujours créé des structures "doubles", même si elles étaient parfois étroitement alliées. Ainsi, la chrétienté a vu, durant presque toute son histoire, une coexistence de deux pouvoirs distincts : l’un responsable des affaires religieuses, l’autre des affaires politiques.
Or, la disposition naturelle de l’homme à confondre les deux pouvoirs est à l’origine des nombreux conflits entre ces deux institutions. La volonté d’absorber le politique dans le religieux – l’idée de créer une "théocratie ecclésiastique" - a toujours été contrecarrée par la tentation inverse, à savoir un "césaro-papisme" qui absorberait le religieux dans le politique.
Ainsi, au fil des siècles, l’argument du dualisme a été employé, plus ou moins hypocritement, pour combattre l'ambition "moniste" concurrente. Théocratie du pape contre théocratie du prince. Personne n’aimait vraiment le "dualisme" et chacun aurait préféré le "monisme" en sa faveur. Nombreux sont les auteurs qui sont allés puiser leurs idées dans l’Evangile dans le but d’affaiblir l’autorité antagoniste.
Ainsi, le pape Grégoire VII lance un grand mouvement de réforme au XIe siècle afin de dépouiller le pouvoir impérial de son contenu religieux et échapper ainsi à la mainmise religieuse par le temporel. A l’inverse, plusieurs siècles plus tard, Dante, dans La Monarchie, chante les bienfaits de la dualité des pouvoirs – symbolisée par l’image de deux soleils éclairants respectivement la route du ciel et celle de la terre – pour contrer la tentation au pouvoir hégémonique du pape.
De la lutte des empereurs romains pour affaiblir l’autorité des papes (dans une pure tradition "césaro-papiste" romaine, c’est Constantin qui convoque le concile de Nicée), à celle des rois carolingiens avec Rome, en passant par la "querelle des investitures" - sans oublier le célèbre différend ayant opposé Philippe le Bel au Pape Boniface VIII - toute l’histoire de l’Occident est marquée par une tension entre ces deux pôles, le spirituel et le temporel, sans jamais de victoire définitive de l’un ou l’autre.
Cette dynamique interne à l’Europe occidentale, en disloquant toute possibilité monopolistique du pouvoir, fut la matrice de la liberté individuelle : « C’est à ce conflit que nous devons la montée de la liberté civile. Si l’Eglise avait continué à soutenir le trône des rois qu’elle oignait, ou si le combat s’était achevé à la va-vite sur une victoire sans partage, toute l’Europe aurait coulé sous un despotisme à la byzantine ou à la moscovite. »
La distinction entre pouvoir civil et pouvoir religieux est une idée féconde qui demeurait inconnue des nations de l’Antiquité. Or, lorsque le souverain est en même temps roi et pontife, lorsque l’autorité suprême est à la fois humaine et divine, elle confisque à son profit toutes les libertés. De là l’anéantissement de l’individu et la déification de l’Etat.
De la distinction des pouvoirs est sortie la victoire de la liberté individuelle. Le prince, dépositaire des forces matérielles de la société, peut opprimer les corps, mais son joug n’atteint pas les âmes. Le pouvoir religieux, dépositaire des forces morales de l’humanité, n’exerce aucune domination sur les corps. L’homme, à la fois corporel et incorporel, ne peut être complètement esclave que d’un pouvoir qui réunisse ces deux natures, spirituelle et corporelle.
Serait-ce cela, le vrai génie du christianisme ?
*Élie Barnavi