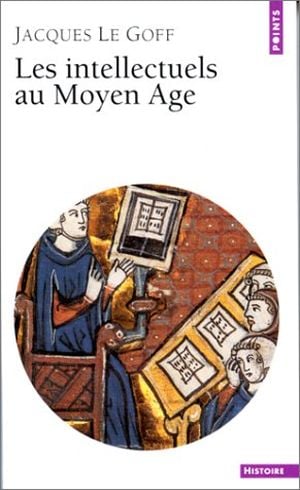L'ouvrage est signé de l'historien médiéviste Jacques Le Goff, qui a longtemps fait figure d'autorité dans son domaine, et entends fournir un résumé de l'histoire intellectuelle du moyen-âge ; mais, plutôt que de se contenter de faire un exposé des grandes doctrines philosophiques qui ont pu naître et évoluer dans le cadre de cette période, il propose aussi d'étudier les conditions matérielles de l'existence de ces « intellectuels », ces travailleurs de la pensée, la diversité des situations et les paradoxes de leur(s) statut(s) ; dans les modalités propres au travail de l'historien. Une histoire « des intellectuels » avant tout. L'étude est centrée sur l'Occident, avec des ouvertures nécessaires sur les doctrines venues du monde musulman, notamment du commentateur andalou d'Aristote, Averroès.
L'ouvrage se concentre essentiellement sur la période qui s'étale entre le XIIe et le XIVe siècle, en évoquant brièvement les problèmes des siècles précédents et en ouvrant sur le XVe siècle et le début de la « Renaissance », la naissance de l'humanisme.
Nous aurons ainsi l'occasion de découvrir, certains avec étonnement, un monde très éloigné des lieux communs méprisants qui ont cours habituellement sur la période du Moyen-Age, qui pâtit, jusque dans sa appellation même, de la malveillance accumulée des siècles suivants, à compter de la rupture entre les « penseurs » de la renaissance (les guillemets sont appropriés, nous le verrons) et les grands Docteurs scolastiques ; et, plus encore, avec Descartes et l'avènement du rationalisme moderne.
Le Moyen-âge, une période marquée par la soumission et l'observance irréfléchie ? Que nenni ! Dans le monde fumeux et bouillonnant de la Ville, qui concentre en son sein tumultueux au moins autant de vertus potentielles que de vices insoutenables, les débats et les querelles fusent en tout sens. Les débats ici évoqués sont essentiellement centrés, il est vrai, sur les questions religieuses ; c'est à dire que les hommes du temps sont beaucoup plus préoccupés par la question du salut, du sens de la vie et du monde, que par des questions d'ordre plus matérielles, techniques ou proprement politiques qui intéresseront d'avantage leurs successeurs. Mais il ne faut point considérer cela comme une limitation ou une sclérose, au moins sur le plan philosophique ; le religieux et les questions intellectuelles qu'il soulève englobe, par définition, à peu près toutes les choses de ce monde et de l'au delà.
Du XIe au XIIIe siècle, L’Église et ses représentants (ou du moins, certains ecclésiastiques haut placés) geignent de l'impossibilité de mettre main basse sur ces intellectuels frondeurs et insoumis, et elle finira pourtant par puiser, plus tard, dans les thèses de certains de ces esprits tapageurs pour affiner et parfaire son dogme. Les débats de ce temps, s'ils peuvent nous paraître lointains ou « dépassés » tant l’irréligiosité domine notre époque, sont pourtant d'une grande virulence et vécus alors comme urgents ; comment équilibrer la Foi et la Raison ? Le péché est-il une essence ou une absence ? Dieu veut-il que nous restions ignorants de son œuvre, de l'ordonnancement du monde concret, et que nous en restions à la seule Écriture ? Aristote, Platon, tout païens qu'ils sont, ont-ils pu tout de même approcher la vérité ? Et que penser des doctrinaires musulmans ou juifs ?
Beaucoup de réponses différentes, avec différents degrés de sérieux et de rigueur, et des attitudes qui, parfois, nous rappellent tendrement (ou amèrement, c'est selon) des postures bien connues dans notre monde actuel … Il serait malavisé de croire que tout n'a été inventé qu'après le XVIIIe siècle. Anarchistes, communistes, démocrates, « djihadistes » à la sauce chrétienne, centristes indécis, traditionalistes desséchés, libéraux cyniques … on retrouve un peu de ces parfums là, sous des formes différentes certes, mais avec ce même « fond », ces mêmes énergies initiatrices.
Nous découvrons aussi la diversité sociologique de ce milieu complexe et mouvant des travailleurs intellectuels, les maîtres et les étudiants. Au moins jusqu'à la fin du XIIIe siècle, la Science et la pensée ne constituent pas, à proprement parler un « privilège de classe », ou l'émanation d'une hiérarchie sociale qui assurerait sa cohérence par sa mainmise sur la production de concepts. La hiérarchie de l'époque, basée sur cette tripartition traditionnelle des rôles sociaux que nous connaissons bien, place à sa tête les bellatores qui ne sont légitimes que par leur compétence guerrière, autrement dit, que parce qu'ils sont en mesure de protéger les travailleurs et les hommes d'église contre les spoliations. Il fallut qu'ils soient de rudes guerriers, avant même d'être versés dans quelque culture religieuse ou littéraire, cette même culture qu'ils tendent à mépriser (non pas mépriser en tant que tel, nier sa valeur, mais plutôt la mépriser dans le cadre de leur identité de classe – ce n'est pas vraiment « une bonne chose » qu'un jeune noble susceptible d'hériter délaisse les armes pour se consacrer à l'étude des textes saints). Les hommes d’Église, à qui échoient le soin des âmes, ne sont en fait pas vraiment destinés à être des intellectuels : leur « monopole » relatif sur la culture et sur les Écritures n'a pas, en soi, de vocation au dépassement et à la contradiction. Il leur échoit bien d'avantage un travail de conservation et d'observance. Dans tout cela, où se trouvent donc nos explorateurs de la pensée ? Ils ont un statut des plus ambigus. Officiellement, ce sont des travailleurs, des artisans du concept, qui s'organisent en corporations comme le feraient des menuisiers ou des brasseurs.
Mais les intellectuels, pour une majorité d'entre eux, tendent à mépriser ces artisans et leur travail manuel, comme le faisaient en leur temps les grands philosophes grecs, qui associaient de manière plus ou moins définitive le travail à la condition servile. Ils se sentent investis d'une mission autrement plus digne et noble ; mais ils ne sont pas, pour autant, chargés de guider les âmes à la manière des Hommes d’Église. Leurs origines sociales sont disparates ; sur les bancs de l'université de Paris, au XIIIe siècle, se côtoient fils de paysans, cadets de la grande noblesse foncière, enfants d'artisans ou de bourgeois, petits nobles moribonds de province. Sans oublier les membres d'ordres mendiants, ecclésiastiques donc, qui s'immiscent petit à petit dans le monde des intellectuels, au point que certains des plus brillants d'entre eux (nous pensons notamment à Saint Thomas d'Aquin) seront des moines dominicains ou franciscains. A ce propos, notons qu'un certains nombres de mesures étaient mises en places pour aider les étudiants pauvres à vivre, soit en organisant la mendicité, soit par des systèmes de bourses, permettant ainsi cette véritable diversité sociale du milieu universitaire ; nous avons l'exemple de Robert Sorbon (fils de paysan en son état) et de l'organisation de son célèbre collège, dont hérite lointainement la Sorbonne moderne. Ainsi, ceux qu'on appelle désormais les « Clercs » forment en tant que corps social une « anomalie », dans ce monde d'organisation très traditionnelle. Plus encore que les Marchands - dont la fonction est, en définitive, dépendante de la fonction productrice, ce qui les rattache plus concrètement à l'ordre des laboratores, bien malgré leurs singularités -, ces Clercs se détachent de la masse des travailleurs, se rapprochent des oratores tout en étant, majoritairement, des laïcs, et parfois des anti-cléricaux notoires.
Mais ce monde des intellectuels finira par muter, pour diverses raisons, par devenir de plus en plus exclusif et renfermé sur lui-même, au point de voir émerger, au XIVe siècle, des espèces de « dynasties » d'intellectuels, simulacres de noblesse, allant jusqu'à utiliser des blasons, dont les enfants accèdent gratuitement aux universités, tandis que les autres sont tenus de payer. Ceci contribuant certainement, à coté d'autres facteurs, à une sclérose de la pensée, un tarissement des grands débats qui avaient pourtant fait la richesse des siècles précédents et fait émerger de véritable joyaux de la pensée humaine, et contribuant malheureusement à salir auprès des générations suivantes l'image de la philosophie médiévale.
Les Humanistes du XVème siècle, avant tout en quête de cette émulation perdue, telle qu'elle avait pu exister aux XIIème et XIIIème siècles, se tournent vers la rhétorique et vers la recherche du Beau, à défaut de pouvoir trouver la recherche du Vrai « excitante ». Pour parler sociologie, les humanistes sont avant tout des aristocrates, propriétaires fonciers, admirateurs inconditionnels des anciens Grecs qui considéraient l'oisiveté comme une bonification (cf l'idée du travail renvoyant à la condition servile), méfiants et dédaigneux du monde de la Ville et de ses tumultes, ils ne fréquentent point les Universités. Ils n'ont nullement cette culture du débat, de la discussion virile, telle qu'était celle de la scolastique originelle. Ils ont une conception du monde et de la religion profondément élitiste, parfois initiatique ou gnostique, en tout cas beaucoup moins universaliste qu'on a voulu le prétendre.
L'ouvrage dans sa globalité propose ainsi cette ouverture au monde intellectuel du moyen-âge, à sa complexité et à sa richesse, au delà des jugements un peu trop rapides que nous pourrions avoir spontanément sur la question.