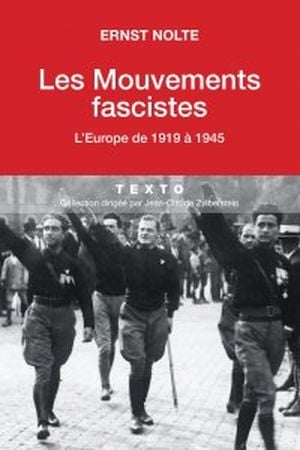Bien curieuse est cette ignorance qui entoure un phénomène pourtant aussi crucial dans la compréhension de l'histoire récente que le fascisme. L'évoquer, en tant que thème d'étude, de réflexion, en tout cas, sous un angle autre que moral ou mémoriel, est bien souvent déjà considéré comme un scandale en soi, un manque de civisme, voire un acte blasphématoire. Pourtant, parmi les objets historiques, il y en a sans doute peu qui ont autant fait couler d'encre que le fascisme, qui ont tant entraîné de querelles, à commencer sur la nature-même de l'objet, le fascisme ; et qui ont donné tant de thèses variées et contradictoires. Et ce dans l'ignorance la plus complète du grand public, comme il est convenu de l'appeler, qui se complaît bien souvent confortablement dans les vieilles analyses hallucinées de Staline datant des toutes récentes années 20 (je parle bien des années 1920) — ainsi, la thèse du fascisme comme phase de développement ultime du capitalisme, ou quelque chose de cet ordre.
Ernst Nolte, puisqu'il faut le présenter, est un éminent spécialiste allemand du fascisme et du totalitarisme, depuis longtemps reconnu pour la qualité de ses travaux — encore que quelques unes de ses positions concernant des aspects mémoriels strictement allemands en firent un objet de controverse obligeant le préfacier de la présente édition (Tallandier, « Texto », 2015) de se confondre en d'interminables excuses et justifications sur le bien-fondé de la réédition et de la lecture de cet ouvrage, pourtant classique, qui ne peut par ailleurs que se signaler par sa stricte et froide neutralité, sinon son aversion exprimée d'une façon qui paraît sincère pour les crimes commis par les fascistes et la nature oppressive des régimes totalitaires. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage est un des premiers de Nolte, et, dans l'historiographie du fascisme, un des plus anciens : il date de 1966.
L'ouvrage se décompose en deux parties. Tout d'abord, une histoire politique du fascisme tel qu'il a concrètement agi dans le cours de la « grande » histoire — celle des hommes d'Etat, des diplomates et des chefs de guerre. L'Italie et l'Allemagne nazie occupent donc naturellement l'essentiel du propos. Ensuite, un examen des mouvements dits fascistes à travers l'Europe, région par région.
La grande thèse originale, qu'il n'aura de cesse de développer par la suite, d'Ernst Nolte consiste en une observation qui aurait pu paraître fortuite : curieusement, les premiers mouvements fascistes naissent exactement en même temps qu'éclatent les diverses révolutions socialistes en Europe dès 1918 suite à l'exemple bolchévique — en Allemagne, en Italie, en Finlande et en Hongrie notamment. Ainsi Mussolini fonde son faisceau en 1919, au moment-même où les anarchistes italiens occupaient les usines de Lombardie et s'employaient à organiser la production selon leurs propres critères, tandis que l'Etat avait perdu tout pouvoir effectif. Hitler, quant à lui, est impliqué, en tant que simple garde, directement dans la répression de la révolution socialiste de Bavière. En Autriche, des groupes de défense s'armant sans demander l'avis de ce qui restait d'Etat se réunissent pour prévenir toute tentative révolutionnaire de façon préemptive — encore étaient-ils, bien qu'ils portassent dûment la chemise en guise d'uniforme, plutôt d'obédience sociale-démocrate ! Dans les pays baltes, des corps francs s'organisent pour lutter contre le bolchévisme et garantir l'indépendance de leurs nations jusqu'alors occupées par l'empire russe. En Finlande, une guerre civile éclate entre Blancs et Rouges, ces derniers difficilement écrasés au terme de combats meurtriers, ce qui incita le pays à suivre sagement une politique libérale et tolérante.
Bien plus tard, en 1934, la Phalange espagnole est créée en même temps, puis fusionnée avec elle, que la Junte d'Offensive Nationale-Syndicale (JONS), dans un contexte de tensions croissantes entre les différentes fractions de la gauche et de la droite au sein de la toute jeune Seconde République espagnole ayant succédé à la dictature « boulangiste » de Primo de Rivera. Ernst Nolte note par ailleurs le paradoxe de ce que le Front populaire espagnol se soit constitué en 1936 en réponse à la « montée du fascisme » alors que ce fascisme était pour ainsi dire inexistant jusqu'alors en Espagne, et très orienté à gauche, quoi qu'en même temps monarchiste. Franco aura clos très rapidement l'expérience fasciste espagnole en contraignant la JONS à fusionner avec leurs ennemis jurés, les Carlistes, mouvement catholique « en croisade contre l'athéisme » se recrutant essentiellement dans la paysannerie navarraise.
En bref, la thèse de Nolte consiste en ceci que le fascisme est d'abord né d'une réaction contre la peur d'une révolution de type bolchéviste, peur tangible ou complètement fantasmagorique, ce qu'il prend bien la peine de noter lorsque de tels mouvements apparaissent dans des pays où le communisme est à peu près inexistant, comme au Royaume-Uni. Pour autant, qu'est-ce qui distingue le fascisme d'une réaction antibolchévique qui venait tout aussi bien des démocrates que des conservateurs traditionnels ?
La réponse ne peut qu'être délicate tant le fascisme aborde des traits fondamentalement paradoxaux.
En premier lieu, le fascisme se veut à la fois révolutionnaire et conservateur. Il veut à la fois opérer de grandes transformations sociales tout en baignant dans le culte du passé, de la race, de la nation, des empires disparus. Ainsi le paradoxe d'un Mussolini prenant la pose pour les photographes ruisselant de sueur, pioche à la main, en train d'aider les paysans à l'assèchement d'un marécage. Et ce même Mussolini déclarant que, bientôt, « l'Italie ne sera plus qu'une immense usine et un immense chantier naval. » Le fascisme se caractérise le plus simplement par une opposition systématique à tout ce qui lui préexistait : le système des partis, le libéralisme, le socialisme, le conservatisme, la réaction, et, en règle générale, les églises (en prônant un athéisme militant — il faut noter à ce titre qu'en dépit des accords de Latran de 1929, signés dans un esprit de compromis, le pape publia une bulle appelant aux chrétiens à se désolidariser de « l'idolâtrie païenne de l'Etat » qu'était pour lui le fascisme). De fait, le fascisme ne peut qu'apparaître paradoxal, ou se mouvant de façon périlleuse et acrobatique sur une corde raide : rejetant le conservatisme de leurs pères, se revendiquant d'une nouvelle forme de conservatisme, et appelant aux grandes transformations modernisatrices de la société.
Il faut à ce titre évoquer un point qui suscite ô combien de dépit, d'indignation, de déni, d'explications laborieuses et souvent fort peu honnêtes de la part d'une part non-négligeable de nos concitoyens. Le fascisme fut indubitablement, pour partie du moins, de gauche. Nombre de ses chefs provenaient directement de la gauche : Mussolini, Doriot, Déat, Drieu la Rochelle, Georges Valois (mais Nolte voit plus en l'éphémère faisceau de Valois une tentative de pousser le fascisme vers la gauche), Oswald Mosley (dont le projet de relance économique par l'investissement public fut chaleureusement soutenu par Keynes lui-même !), Ramiro Ledesma Ramos, le fondateur de la Phalange espagnole qui mettait au programme rien de moins que la collectivisation de toutes les terres agricoles ! Force est néanmoins de constater que cette tendance de gauche fut souvent mise de côté dans les faits. Mais comme le note Nolte, « réduire la tendance de gauche ne voulait pas dire, même dans le cas de Hitler, la renier, tous les mouvements fascistes restèrent d'accord pour affirmer qu'ils n'étaient pas de simples partis de droite. » Il faut ici préciser que Hitler fit éliminer en 1923 la tendance socialiste, et même authentiquement anticapitaliste, du NSDAP représentée à Berlin. Néanmoins, la rhétorique populiste fasciste ne réduisait la critique du capitalisme qu'à la dénonciation de la « finance internationale contrôlée par les Juifs » (qui pourtant a sanctionné le Juif Léon Blum et financé l'antisémite Hitler qui impressionna tant l'opinion internationale par l'efficacité avec laquelle il soumit et anéantit le communisme en Allemagne — à croire, ironise Nolte, que la finance est plus soucieuse de ses profits que de considérations raciales), abandonnant de ce fait toute réflexion en profondeur des conditions réelles des forces productives et des rapports de classes. Cela étant dit, comme le souligne au passage Nolte, la tendance des Etats à prendre en charge l'amélioration des conditions de vie des masses était un phénomène d'ordre historique concernant tous les Etats modernes, de droite comme de gauche. En ce sens, le fascisme ne faisait pas exception et s'inscrivait parfaitement dans l'esprit de l'époque.
Et concernant le fascisme, cet esprit de l'époque, Nolte l'observe le plus superbement en la personnalité de Drieu la Rochelle :
Parmi les intellectuels ralliés [au mouvement de Doriot] il y eut Drieu la Rochelle qui incarne, peut-être de la façon la plus spectaculaire, l'essence du fascisme mouvant et insaisissable dans ses multiples prolongements. Ni son caractère ni la logique des choses ne l'amenèrent à Doriot, bien que son expérience de la guerre l'eût sans doute prédisposé à le rejoindre. Durant plus de dix ans, il prit fait et cause pour Genève [la SDN] et pour une France européenne, mais une convergence de motifs le rapprocha ensuite du fascisme : l'immobilisme de l'état de choses en France le rebutait ; le déploiement de forces totalitaires en Italie, en Allemagne et en Russie l'épouvantait ; il admirait l'élan juvénile de ces pays mais il répugnait à voir se répéter une guerre moderne que l'humanité ne pourrait supporter et qu'il fallait à tout prix remplacer par de nouvelles formes d'affirmations viriles. Ces mobiles présentent bien une petite analogie avec les motivations de Hitler ou de Codreanu [leader du fascisme roumain]. Mais en quoi Drieu la Rochelle leur ressemble-t-il, quand il dit : « Je ne me donne jamais à une cause, car il y en a d'autres. » Et pourtant c'est cela même qui confère à une déclaration que faisait ce même homme la valeur de « signe » caractéristique de cette époque : « La liberté est épuisée, l'homme doit tirer une force nouvelle de son obscur tréfonds originel. Voilà ce que je dis, moi, l'intellectuel, l'éternel anarchiste. »
Peut-être sera-t-il utile de préciser que l'un des slogans des fascistes italiens était « Me ne frego », à savoir, « Je m'en fous. »
Tout au long de l'ouvrage, Nolte opte pour une analyse de type structuraliste, cherchant d'abord à déterminer la composition sociale du pays, les idées qui y circulent, la nature de l'Etat et le niveau de développement de l'économie. Ce faisant, il semble louvoyer sans le dire avec les thèses marxistes toujours prédominantes voyant dans le fascisme un produit structurel du capitalisme, appartenant socialement à la petite-bourgeoisie ; acceptant le principe d'analyse de leur thèse, mais la démentant en montrant les innombrables cas où cette analyse ne fonctionne pas — et en insistant sur le large épouvantail social où se recrutaient les fascistes, faisant même des origines populaires des leaders fascistes une caractéristique du fascisme lui-même (seul, ou presque, le cas de Mosley échappe à cette observation). De fait, Nolte envisage les choses de façon plus concrète, en intégrant son analyse de l'essor, de la réussite ou de l'échec du fascisme dans chaque pays par rapport à la situation politique, sociale et économique de ce pays. Lors de son examen des différents mouvements fascistes, il note ainsi trois types de situations :
- Les pays ayant une ancienne et solide tradition démocratique et parlementaire où la population eût unanimement et d'emblée désapprouvé le fascisme qui fut rapidement, et sans grandes difficultés, interdit tout ou partie. Il s'agit de la Suisse, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, même lorsque celle-ci combattit aux côtés des Allemands lors de la Guerre de continuation, ce qui en fit le seul pays libéral combattant aux côtés de l'Axe.
- Au contraire, des pays « neufs » ou « en retard » subissant un régime de type féodal, monarchique ou autoritaire ; il s'agit principalement des nations nées de la Première guerre mondiale ayant rapidement abandonné leur première Constitution parlementaire pour imposer un régime autoritaire et stable : Hongrie, Bulgarie, Grèce, Lettonie, Estonie, Lituanie, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Autriche. L'enjeu était tout simplement d'éviter toute forme de concurrence avec le pouvoir en place. Le Portugal de Salazar entre aussi dans cette catégorie, mais plutôt en raison de l'aversion de ce dernier pour le fascisme et le totalitarisme.
- Et finalement, les pays démocratiques instables et fortement divisés où, grâce à la liberté d'opinion, de presse et au système des partis, le fascisme a pu prendre essor et séduire les masses tout en attaquant avec une violence inouïe successivement tout ce que détestaient les éléments contestataires de la population : la finance, les Juifs, les francs-maçons, le système des partis, les politiciens, le libéralisme, l'exploitation des travailleurs, la démocratie, etc. Ce qui fut particulièrement le cas de Hitler, maître illusionniste qu'untel voyait en champion de la classe ouvrière, un autre un fervent partisan de la restauration impériale, tel autre un nationaliste voulant imposer une vision unitaire de l'Etat, ou bien un champion de l'anticommunisme, rempart contre les hordes révolutionnaires menaçant les intérêts bourgeois.
En réalité, si le fascisme en Italie et en Allemagne a tout à fait joué le rôle de force armée de la bourgeoisie dans sa lutte contre le socialisme, car telle est la grille de lecture univoque du fascisme par les gauchistes, ceux qui croyaient manipuler furent eux-mêmes dupés — y compris les conservateurs allemands qui, du haut de leur mépris pour le racialisme bassement matérialiste des nazis, voyaient en eux une force armée susceptible de faire taire leurs opposants. Le fascisme s'imposa telle une chappe de plomb plongeant le pays dans la monotonie, l'uniformité, l'ennui, et, comme le dit si joliment l'auteur, reprenant la formule d'Ernst Jünger, dans l'exil intérieur. Quant à l'économie, elle fut dirigée peu à peu par l'Etat dans tous les secteurs, et ce de façon souvent bien absurde — il faudrait plutôt se référer au livre de Bernstein et Milza pour le cas italien. De fait, si une force sociale fut défavorisée par l'avènement du fascisme, ce fut bien la bourgeoisie, tant matériellement qu'idéologiquement.
Ainsi ce trait psychologique au cœur du fascisme d'après Nolte : la peur irrationnelle du bolchévisme, le souvenir des révolutions de 1917-1923 qui a terrorisé l'opinion bourgeoise durant tout l'entre-deux guerre, principal moteur de l'essor des partis fascistes et de leurs réussites dans la mesure où communiaient aussi bien démocrates que conservateurs dans l'unanime terreur de la révolution, moteur d'alliances hasardeuses dont ces derniers furent tôt ou tard les dupes et les victimes.
Quant à l'examen mouvement par mouvement de ce qui put être rapproché de près ou de loin du fascisme, Nolte pose les bases des éternelles controverses tâchant d'affirmer ou d'infirmer la qualité de fasciste de tel ou tel mouvement. En réalité, en dépit d'une volonté internationaliste affirmée par la tenue du Congrès international fasciste de Montreux de 1934, il y eut assez peu de cohésion entre les différents mouvements assimilés au fascisme, sinon quelques signes distinctifs : le salut romain, l'admiration pour Mussolini et Hitler, l'adoption de la chemise en guise d'uniforme, la constitution de formations paramilitaires, la haine pour tous les tenants de la politique courante... Le faisceau de Georges Valois, lui qui détenait auparavant de hautes fonctions dans l'Action Française, se singularise au contraire par son philosémitisme, sa façon de penser la France non point d'un point de vue unitaire, et donc totalitaire, mais du point de vue d'une pluralité d'églises et de nations, et ses positions sincèrement socialistes qui le conduisirent paradoxalement à adopter une attitude antifasciste, sévèrement critique du régime de Mussolini. Déat, quant à lui, ne voyait dans le triomphe de l'Allemagne nazie rien de moins que « la continuation et le couronnement de la Révolution de 1789 ». Doriot, lui, était inlassablement pacifiste. Quant au mouvement Rex mené par Léon Degrelle en Belgique, il se distingue par son absence d'organe paramilitaire, d'uniforme, ou d'actions violentes. En outre, c'était un mouvement fondé sur la foi catholique : « Rex » pour Christus Rex. Quisling, en Norvège, détonnait par son mépris pour la vie urbaine décadente, son refus de tout modernisme.
Bien plus singulier est le mouvement de Codreanu, en Roumanie, La légion de l'Archange saint Michel, plus communément nommée Garde de Fer en référence à son emblème grillagé qui, pourtant, était mis au second plan devant la « sainte image » sous laquelle la Légion était placée sous protection, et qui était toujours privilégiée dans les manifestations publiques. Son programme n'est pas moins déroutant : il s'agit des « quatre sillons de la charrue », la foi en Dieu, la foi en sa mission propre, l'amour mutuel... et le chant. La Garde de Fer fut l'unique autre formation fasciste à prendre le pouvoir par les urnes, ce qui convainquit par ailleurs le roi Carol de la nécessité de prendre les pleins pouvoirs et de dissoudre tous les partis, puis de faire assassiner Codreanu. Mais la Légion était si populaire que Carol ne put que se résoudre à abdiquer, laissant les pleins pouvoirs au général Antonescu, fondateur d'un Etat légionnaire nationaliste qu'il décrit lui-même comme « un mouvement d'insurrection anarchiste » ! Par opposition à tous les autres mouvements fascistes, la Légion se singularisait également par son hostilité à l'égard de l'Etat. Ainsi le mot de Codreanu justifiant le meurtre d'un préfet : c'était à ses yeux « le premier cas où quelqu'un s'avance le pistolet en main vers l'homme qui veut fouler aux pieds sa dignité d'homme et l'écorcher vif au nom de l'autorité suprême. » Mais le plus spectaculaire demeure l'importance de la foi orthodoxe qui constituait réellement le fondement du mouvement légionnaire, dont les membres se considéraient authentiquement comme de nouveaux croisés en croisade « contre les Juifs impies ». Par ailleurs, le serment prêté par les légionnaires impliquait « la volonté de vivre dans la pauvreté et tuer en [soi] tout désir de richesse matérielle »; de « mener une vie dure et sévère, excluant tout luxe et débauche. » Il stipulait en outre la volonté de « réprimer l'exploitation de l'homme par l'homme. » Antimodernisme, refus des progrès de la production matérielle, donc de l'industrie ; refus de l'exploitation de l'homme par l'homme — et donc, là aussi, de l'industrie. La foi chrétienne supplante ostensiblement les idéaux modernistes fascistes semblant en réalité inexistants. Pour autant que « tous les autres mouvements fascistes étaient jusqu'à un certain point des mouvements de rénovation éthique », ce trait acquiert un rôle central dans le mouvement légionnaire, quelque part comparable aux ordres monastiques militaires du Moyen Âge.
Néanmoins, souligne l'auteur,
La « mystique » de la Garde de Fer ne peut être dite chrétienne, bien que s'exprimant en formules chrétiennes, car son centre n'est pas le Dieu infini mais le « sang » bien concret de la nation. Codreanu dit : « Si la mystique chrétienne à son apogée (...) définit l'extase sacrée comme le contact direct de l'homme avec Dieu par un élan de l'humain au divin, la mystique de la race, la mystique du sang ne signifie rien d'autre que le contact direct de l'individu ou des masses enthousiastes avec l'éternel, avec le génie de la nation. »
Toutes remarques ne cessant de nourrir d'incessant débats, quoi que fort stimulants, sur la nature du fascisme, ayant donné lieu à des positions bien connues voulant voir le fascisme comme strictement italien ou refusant la qualité de fascisme au nazisme en raison de son antimodernisme théorique.
Puisqu'il faut bien conclure ce laborieux décorticage d'un ouvrage magnifié par un style concis, élégant dans sa rudesse, excellant dans sa capacité à transmettre quantités d'informations en peu de mots, je finirais par indiquer la perspective souterrainement hégélienne qui agit comme seconde interprétation historique du fascisme. Pour Nolte, le fascisme fut en quelque sorte une sorte d'épreuve, de crise, de ce qu'il appelle le « système libéral », se trouvant en réalité crise en raison des principes qu'il prône : tolérance, liberté de conscience, d'expression, d'organisation politique. Crise manifestée tout particulièrement en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, en Italie et en France, par les antagonismes irréconciliables engendrés par le système des partis. Sans doute, pour douteux personnage qu'il soit, Karl Popper eût-il établi l'analyse la plus juste et la plus machiavélique en son funeste ouvrage La société ouverte et ses ennemis : le parti de la tolérance ne peut triompher que par l'intolérance, à savoir, l'intolérance des idées dites extrémistes, c'est-à-dire à peu près toutes. Si l'on voulait raisonner en hégélien, nous pourrions analyser dans l'énergique et quotidienne lutte des pouvoirs établis de nos jours contre toutes formes de « fascismes », de « populismes » ou de « bolchévisme à la Chavez » l'étape de dépassement du système libéral des tensions nées de l'étape précédente, celle du fascisme — pour autant que ce dépassement ne soit pas rien d'autre que le suicide volontaire, quoi qu'inconscient, du libéralisme en ses conceptions fondamentales.
Néanmoins, il me semble important d'indiquer ce qui me paraît être un véritable angle mort dans l'ouvrage de Nolte : l'absence de la Première guerre mondiale, sinon pour le rôle joué par les déceptions en termes de gains territoriaux ayant motivé le proto-fascisme sous les auspices de l'écrivain, poète, esthète, aristocrate Gabriele d'Annunzio et l'aventure lyrique, romantique, sinon romanesque, de Fiume. Cet aspect a au contraire été analysé par l'historien italien Emilio Gentile, voyant dans le fascisme la poursuite d'un idéal, né dans la glaise des tranchées, de société sans classes, égalitaire dans le sens où elle ne serait hiérarchisée que par des valeurs acquises et non déterminées par un statut social quelconque ou la naissance : honneur, bravoure, courage, « Pugnal fra i denti, le bomba a mano ! » comme chantaient en refrain les Arditi de la Grande guerre ; en somme, l'expérience de la guerre comme fondement d'une rénovation morale de l'humanité balayant les anciennes corruptions du « monde d'avant » (puisqu'il était question de « la der des der ») — à voir l'excellent Capitaine Conan à ce sujet que, fidèle à son habitude, Tavernier met excellemment et fort subtilement en scène.
Mais différents objets d'étude, différentes sources, différentes conclusions. Ainsi s'écrit l'histoire.
A ce propos, je propose modestement de méditer la belle envolée lyrique, bien à la façon allemande, qui constitue le dernier paragraphe du livre :
Ce n'est pas l'affaire de la pensée scientifique de partager à la façon manichéenne les forces qui s'opposent dans le monde en deux groupes, l'un noir, l'autre blanc, ni d'attiser les passions au lieu de les éclairer. (...) Au cours du XXe siècle il n'est pas un terme qui ait autant servi d'arme que le mot de fascisme. Si la pensée scientifique parvient à transformer ce glaive en soc de charrue, la science aura accompli une des œuvres que la vie est en droit d'attendre d'elle.