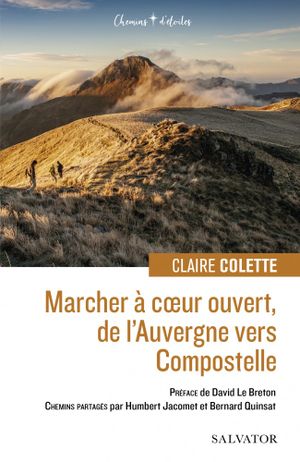Le résumé est dans le titre, je ne ferais pas mieux: Claire Colette raconte sa marche entre l'Auvergne et Compostelle.
Pour faire court : même si le livre a beaucoup de citations, j’ai eu une impression que l'auteur était là, qu’elle vous parle; sans chichi inutile sur la forme qui créerait de la distance (surtout à partir du chapitre 12, au beau titre: ‘la voie de l’espérance’).
Pour faire plus long, voilà la série de notes désordonnées que j'avais prises lors de la lecture:
__________ Un autre livre d'un pseudo amoureux de la marche et de la France est en tête des ventes, des critiques et des prix: "Le Chemin des estives" d'un sarcastique mais populaire Charles Wright.
Je lui ai préféré ce livre d'une Claire Colette que je ne connais pas mieux (comme Wright, je ne l'ai jamais vue en interview).
Mais son amour de la marche et La France m'ont paru plus sincères et beaux. Et ancien.
Elle, elle tente de marcher chaque année depuis au moins 12 ans, ce n'est pas juste pour le dit de l'avoir fait.
Et, elle, elle ne qualifie pas de "trou" certains lieux qu'elle traverse et elle ne se moque pas des tenues des Français qu'elle croise.
Je l'ai lu l'été dernier (2021).
Le livre qui m’avait fait le plus plaisir de retrouver dans le lot que j'avais apporté.
Tout en vaquant à mes occupations et en parlant à mes proches, je pensais au moment où j’allais retrouver cette balade.
Je me suis même mis à entendre la voix de l’auteur. Je ne lisais finalement plus avec ma voix intérieure.
Un livre qui ‘pulsait’, qui rayonnait, comme si je ne le tenais pas. (J’effacerai sans doute ces lignes tant je réalise qu’elles paraissent démentes...).
Peut-être pas le mieux écrit de tous les livres que j'ai lus récemment: pour le peu que je puisse en juger puisque j'écris en faisant des fautes qui ne me sautent pas toujours aux yeux à la première relecture mais parfois à mes suivantes.
C'est celui au moins de mon année 2021 que j'avais ressenti comme le plus sincère, volontaire, bienveillant.
J'ai senti (peut-être à tort) que la marche et sa démarche n'est pas qu'une occupation passagère dans un plan personnel et ambition plus larges comme pour d'autres marcheurs qui publient, complétant juste un cv ou un projet.
Pour elle, la marche est vraiment un amour du contact avec les autres, et pas seulement pour l'admiration des paysages ou le défi de franchir des obstacles.
Sa sincérité se ressent de suite ; l’enthousiasme rayonne ; la joie de partager son expérience ; elle nous apprend bien vite qu’elle essaye de marcher un mois sur douze et mentionne juste en passant sa santé. Très peu égocentrée: pas très autobiographique.
____________ "Une ode sensorielle à la vie":
(je croise cette expression dans un doc d'arte, très utile pour décrire ma lecture).
Comme l'auteur Claude Marthaler, que je découvrais le même été,, Claire Colette envisage les arbres comme des frères.
Je craignais au début d’avoir trop à faire à une sorte d'Animiste car même son sac à dos aussi devient quasiment une personne, un compagnon : cette personnification des objets m’a d'abord inquiété. Serait-ce l’effet de la solitude ?
PUIS je me suis rappelé qu'on le fait tous un peu...qui n'a pas parlé à sa voiture?
Puis j’ai craint un mini-publireportage sur une association (Colportage ?).
Puis j’ai craint d’être en train de croiser encore une fan de Boris Cyrulnik sur le « nous –supportons-de-moins-en-moins-l’épreuve » vouant un culte au « goût de l’effort ».
Par exemple, quand plus tard elle s’inquiète de trop couver ses petits enfants: « une surprotection qui peut empêcher les apprentissages et priver des épreuves à franchir » (sic) ;
ça m'avait rappelé un mariage où j'étais invité et où un prêtre, en d’autres mots, ne souhaitait pas une vie sans épreuves aux mariés car elles consolident le couple ?!
____________________Cette démarche de se mettre à la marche a été comme pour beaucoup suite à une crise et changement de décennie.
Liée aussi à la perte de « l’élan vital » dû à un père malade et ‘harceleur’ qui a impacté toute sa famille et les enfants, mais différemment.
Puis je découvre à la lecture une triste (très infondée) haine de soi qu’elle accuse de l’avoir rendue malade : en gros, elle passe de ‘je suis nulle’ à ‘j’ai créé ma maladie’…bref, que des opinions non scientifiques sur la culpabilisation. Je craignais alors encore la suite du livre (ce n'est que le début).
Mais le livre dépasse vite tout ça.
Mes doutes sont vite passés, pas de leçons de morale du tout dans ce livre, leçons volontaires ou involontaires, qu’on retrouve dans d’autres témoignages concernant la marche.
Son vocabulaire (à elle ; au contraire d’autres témoignages comme celui de ce [Charles Wright, quasi jet-set en comparaison][4] ),
ne trahira jamais, par acte manqué, une quelconque suffisance ou condescendance ou moquerie envers ceux qu’elle rencontre ou les paysages qui la tolèrent.
On sent qu’elle aimerait revenir. Qu’elle pourrait revenir.
Elle, elle serait bien accueillie à nouveau.
Elle ne décrit pas ces lieux comme des « trous » (sic), elle.
Elle ne 'brûle' pas les chemins et ponts qu’elle prend. Elle invite à les prendre. Elle ne les dénigre pas.
Elle est dans la lenteur, presque le hasard, peu de planification.
Ce n’est pas un ego trip . Ou vouloir gravir les plus hautes montagnes (comme chez Marthaler, par exemple).
Sa démarche à elle ne me semble pas une panoplie, ou une marotte passagère : elle le fait depuis des années. Son cv est fini.
Mieux accueilli parfois par les laïcs et croyants simples que les "managers":
Hélas, elle aussi mentionne un prêtre qui ne l’accueille pas très bien (selon elle ; p35);
même Charles Wright mentionne aussi un autre prêtre décevant: il dit même qu' « un prêtre du Congo Kinshasa est peu sensible à notre sort » alors qu'il a été lui-même aidé (p128 ).
Elle rencontrera aussi un frère décevant d’une communauté religieuse (p105).
Pour moi, ces hurluberlus sont minoritaires et pas mon expérience.
Comme 'votre' Charles Wright adoré, elle aura parfois un compagnon de marche, un temps : par exemple un conservateur du patrimoine passionné et passionnant mais qui ne tiendra pas le même coup.
________________ La fameuse théorie du 'Un-mal-pour-un-bien'?
Du rebondir face au problème, utiliser le problème comme énergie ou en découvrir l'effet et conséquence parfois positive?
Mais elle le dit mieux, elle tente l'« éloge du rien et de la faille » (p47).
Par exemple, ce qui est beau dans son cheminement, est que toutes ses déconvenues ou contrariétés se révèlent assez positives ; elles sont l’occasion d’une autre rencontre ou autre chemin encore bien, ou tout aussi bien.
Son namedropping à elle et ses multiples citations ne sont pas cuistres mais utiles et complémentaires.
La seule que j’ai trouvée un peu maladroite dans ce contexte, sont celles d’ Etty Hillesum (p70) : leurs deux situations sont vraiment trop aux antipodes pour que ce rapprochement ne me grince pas un peu aux oreilles.
_________________ Elle croise « une dame âgée » à qui elle, elle regrette de ne pas avoir parlée (p51) suite d’ailleurs à la description des lieux comme un beau plan cinématographique.
Sans doute que cette beauté et début l’auront retenu de parler à cette personne, à part un salut.
Charles Wright croisera aussi « une dame âgée » (p108) qui deviendra honteusement deux pages suivantes sous sa plume fielleuse, une « vieille bourgeoise hautaine » (sic).
L’auteure ici ne sombre pas dans le cynisme ou la moquerie, ni sur le paysage ni sur les personnes croisées, même les moins agréables. Elle communique sa communion avec la nature et réussit à la comparer à une prière et jubilation (p52)
_____________________ Comme Charles Wright et son compagnon se demanderont soudainement sans avoir la réponse certaine si Rimbaud et Charles de Foucauld se seraient croisés et connus (4 ans d’écart) ,
Claire Colette se demande soudainement pourquoi elle « a observé si peu de traces d’un passé médiéval en Belgique»???...
____________ Comme Claude Marthaler , Claire Colette semble proche de la théorie de Gaïa (et du peu que j’en connais) :
_ « nous sommes chacun beaux et lumineux (…il)
nous est demandé de nourrir cette part rayonnante de la vie plutôt que son ombre » (p63)
_ « …les religions ne me semblent pas être l’unique porte d’entrée menant au divin »
où elle surprend mais elle me fait découvrir l’impeccable citation clé du père Teilhard de Chardin:
« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine » (p68; Teilhard de Chardin).
_________________ Comme [Clément Osé dans sa 'Neige pour Suzanne' et tant d'autres...][10] , Claire Colette veut réduire sa dépendance au système économique, sa consommation globale et son empreinte écologique.
__________________ **J’aime que ce sont souvent des trinités de personnages qui l’accueilleront : 3 sœurs, 3 paysans p101 une gérante de gîte et un couple p107.**
Par exemple, l’échange avec trois bonnes sœurs donnerait des envies de dessin animé façon « Les Triplettes de la communauté St Joseph » .
________________ Comme SylvainTesson , Axel Kahn , Charles Wright ou Gaspard Koenig qui aussi marchèrent en France, elle remarque aussi comme eux, la désertification et rend hommage aux derniers petits commerces qui rassemblent parfois les services d’anciens mais différents: bar,épicier, poste, tabac...
________________ En autre film, elle me fait penser aussi à une scène de 'Rencontre du 3e type' (p108): quand elle raconte qu’à une période troublée de sa vie, elle ne se sentait que de dessiner et peindre qu’un volcan. Elle en recroise ici.
Dans le Spielberg, les appelés et informés sont poussés par une force intérieure à dessiner, ou peindre ou sculpter un volcan éteint, qui se révèle justement un lieu de rencontres, de leurs rencontres.
Sa rencontre avec des pluies diluviennes et lutte en montées glissantes (p114) m’a rappelé **Harrison Ford** en prof retournant à la nature avec sa famille dans [‘Mosquito Coast’ de Peter Weir][15] (déjà en 1986) : éprouvés par des pluies aussi.
Et sa prière à elle dans cette montagne et sa purée de pois brumeuse rappelle celle d’ Anthony Bajon dans le film de Cédric Kahn ‘La prière’, en montagne aussi, dans du très mauvais temps aussi où tout semble perdu ou mal parti…
Mais où un miracle se produit aussi. Aveuglée, elle aperçoit quand même subrepticement la bonne direction, qui s’est révélée un court instant, comme si un souffle l’avait révélée et dégagée, à travers la brume (p117)
Ce qui me rappelle une marche personnelle à La Salette , bien moins dangereuse, mais tout aussi miraculeuse.
Et pour en finir avec les comparaisons avec des films qui me sont venus, je dirais que le ton fait souvent penser [au ton et voix d’Agnès Varda (notamment dans ses docs)][18] :
« Marie numéro deux m’héberge ce soir. Une jeunesse saisissante éclaire cette femme de 78 ans. Les deux Marinettes sont de grands amies »
(ce qui me rappelle le doc de l’autre Agnès "Quelques veuves de Noirmoutier").
Au passage, on apprend que 2 ans plus tôt, Claire Colette a fait plusieurs kms et jours à dos d’âne avec son petit fils, rappelant le très récent succès du film ['Antoinette dans les Cévennes'.][20]
Marche où elle décrit comment un hêtre (et être ?) lui aurait soigné un mal de dos paralysant.
Dans le film, c'est une vétèrinaire ...magnétiseuse
**Cette retraitée de l’assistance sociale (p87) rappelle que l’amour sont des gestes et actes et pas que des mots et beaux principes empaquetés dans de belles citations (comme dans certains livres et témoignages…).**
J’appelle ces pages-là, ses pages 'Interstellar' de Nolan et ‘'Cinquième élément' de Besson; films où l’amour a un rôle clé et quasi de mécanique quantique et physique:
elle cite « l’amour n’est pas un sentiment mais la substance même de la création »
(Christiane Singer)
« il est la substance épurée du réel (…) désencombré de nos amours imaginaires »
(Christian Bobin)
comme donc dans Interstellar et le Le_Cinquième élément...