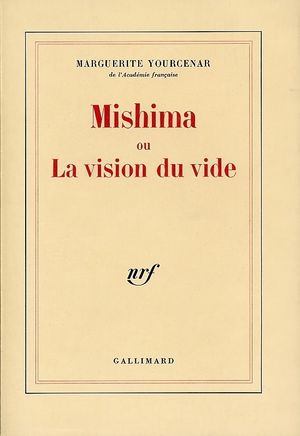Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2018/11/confession-d-un-masque-de-yukio-mishima/mishima-ou-la-vision-du-vide-de-marguerite-yourcenar.html
Critique commune à Confession d'un masque, de Yukio Mishima, et Mishima ou la vision du vide, de Marguerite Yourcenar.
DEUX AUTEURS À DISTANCE
Mishima Yukio, de tous les grands écrivains japonais du XXe siècle, et il y en a eu un paquet, est probablement celui qui exerce le plus de fascination – et pour partie pour de « mauvaises raisons » : sa mort histrionique, comme un événement de la vraie vie qu’on jugerait trop outré s’il figurait dans un roman. Il serait dommage, pourtant, que la mort de l’auteur – bon sang, on ne parle même plus de sa vie à ce stade – gomme par sa folle démesure son œuvre. Ou en tout cas le meilleur de son œuvre, car cet écrivain de génie ne rechignait pas à commettre de temps en temps une petite chose alimentaire – qu’importe, les romans, recueils ou pièces de théâtre brillants ne manquent assurément pas ; et, parmi ces titres majeurs, Confession d’un masque occupe une place particulière – celle d’un déclencheur, d’une certaine manière, car, si ce n’est pas le premier roman de Mishima (c'est le second, sauf erreur), c’est néanmoins celui qui, très vite, alors qu’il n’est âgé que de 24 ans, en fait d’ores et déjà une célébrité et un écrivain reconnu et apprécié, aussi bien par la critique que par le public. C’est aussi une œuvre qui contient en germe un certain nombre d’aspects qui resurgiront par la suite, dans la vie et dans la bibliographie de Mishima – et à bon droit car il s’agit d’emblée d’un texte relativement ambigu, dont je suppose qu’il faut le rattacher au courant très nippon du watakushi shôsetsu, ou « roman du moi », une forme d’autofiction où l’autobiographie de l’auteur ne se dissimule pas totalement sous le récit romanesque, à moins qu’il ne faille prendre les choses à l’envers, et dans tous les cas en se méfiant raisonnablement de ce que l’on nous dit.
Il était bien temps que je lise Confession d’un masque. Mais j’ai supposé que c’était peut-être aussi le bon moment pour lire un fameux petit ouvrage consacré à l’auteur, et œuvre d’une prestigieuse consœur française : Mishima ou la vision du vide, de Marguerite Yourcenar – un essai paru initialement en 1980, soit dix ans après le suicide de Mishima, et qui en traite, forcément, mais sans oublier l’œuvre derrière le fait-divers. Confession d’un masque, comme de juste, y joue un certain rôle – même si l’académicienne s’intéresse surtout ici à la tétralogie de « La Mer de la Fertilité ». C’est une lecture que je repoussais sans cesse – parce que j’avais le sentiment de ne pas avoir suffisamment lu Mishima (notamment ladite tétralogie, d’ailleurs), et, disons-le, parce que je n’avais rien lu de Yourcenar (les Nouvelles Orientales, c’est très récent pour moi…). Mais je me suis dit, à tort ou à raison, que ce serait le bon moment pour au moins une première lecture – dans l’idée d’y revenir peut-être plus tard, quand je connaîtrais mieux aussi bien Mishima que Yourcenar.
MISHIMA EN ACTEUR
Mais, tout d’abord, Confession d’un masque. Ce roman paraît donc en 1949 – et le jeune Mishima passe aussitôt du statut d’inconnu à celui de célébrité. Ce qui, au-delà des évidentes qualités proprement littéraires de ce volume, peut surprendre un tantinet : le thème en est passablement tabou, et l’époque... « compliquée » (le Japon vient de perdre la guerre et est encore occupé par les Américains). Ceci étant, le genre watakushi shôsetsu était semble-t-il porté sur les récits où les auteurs/narrateurs « avouaient » leurs « travers », ce qui va d’ailleurs bien avec l’idée d’une « confession ». En l’espèce, Mishima, via un narrateur parfois appelé Kochan, mais c’est un diminutif affectueux qui pouvait s’appliquer à son véritable nom, Mishima donc témoigne de son éveil à la sexualité, et plus exactement à l’homosexualité, teintée de fantasmes sadomasochistes (mais probablement masochistes avant tout), dans une société qui ne prise pas exactement ces tendances ; aussi, tout en faisant l’aveu de ses « mauvaises habitudes » (c’est-à-dire la masturbation), se sentait-il contraint de porter ce « masque » de « normalité » en société. Mais l’imposture ne pouvait probablement pas durer, ainsi que l’auteur/narrateur en témoigne, même à demi-mots, à la fin du roman ; pourtant, la question de l'homosexualité de Mishima demeurerait longtemps tabou...
Ici, je suis tenté de faire un rapprochement qui, peut-être, n’a pas lieu d’être, et ne fait que témoigner de ce que mes connaissances en matière de littérature japonaise sont bien trop parcellaires : l’année précédant la parution de Confession d’un masque, un autre grand roman japonais avait adopté un dispositif qui me paraît assez proche – La Déchéance d’un homme, de Dazai Osamu, un auteur presque systématiquement associé au « roman du moi ». Passons sur le fait que les deux auteurs se sont suicidés (pour Mishima, cela ne se produirait que 21 ans plus tard ; et quand on voit le nombre de grands écrivains japonais qui se sont suicidés au XXe siècle, de toute façon…), mais voici deux grands textes de la littérature nippone du XXe siècle, parus en l'espace d'une année, dans lesquels les auteurs, jeunes encore voire très jeunes, exposent leur propre vie, les indices ne manquent pas, mais surtout leurs penchants jugés (par d’autres, mais aussi par eux-mêmes) les plus « immoraux », avec ce qui relève peut-être parfois d’une forme de complaisance, mais confessent avant toute chose que la société dans laquelle ils vivaient leur imposait de porter un « masque » ; le terme même, sauf erreur, revient chez Dazai, quand il pose et justifie sa figure de bouffon. Les deux auteurs usent de ces sujets parfois limites pour en extraire la meilleure littérature, mais il y a assurément une part d’exhibitionnisme dans la démarche – peut-être ne faut-il pas cependant s’attarder trop longtemps sur ce terme méprisant, car l’exposition était en même temps sincère… Reste que le texte de Dazai constitue comme un préambule à sa mort, si celui de Mishima est davantage un préambule à une carrière – et à une vie ? Car, dans Confession d’un masque, on est tenté, le lecteur contemporain est tenté, de faire quelque chose qui était forcément impossible pour le lecteur japonais de 1949 : tirer des traits, dessiner des trajectoires, anticiper tout ce qui suivrait… et pour le coup jusqu’à la mort, oui. La figure du masque, soit du personnage, à vrai dire, n’en acquiert que davantage d’importance.
Le roman de Mishima s’ouvre sur des tableaux saisissants d’une enfance remémorée au prisme de fantasmes divers, généralement liés, d’abord à l’art, plus tard à la littérature. Il est intéressant, à ce propos, de constater combien les références avancées par l’auteur sont généralement européennes, bien plus fréquemment en tout cas que japonaises. Quoi qu’il en soit, dans ces pages vibrantes et d’une élégance chargée de perversité, l’auteur se livre à une auto-analyse exhaustive, traquant dans les moindres souvenirs, probablement idéalisés, les sources de son être adulte – sources qui ne peuvent que témoigner de ses « mauvais penchants ». Nous voyons ainsi le petit Kochan, élevé par sa grand-mère assez « spéciale », s’enthousiasmer pour de beaux chevaliers – un, tout particulièrement, dont les traits androgynes l’émeuvent, bien avant qu’ils soient en mesure d’exciter ses hormones, jusqu’à l’instant fatidique où la vérité lui apparaît : c’est en fait le portrait d’une femme, une certaine Jeanne d’Arc… et le charme est rompu. Mais les chevaliers peuvent avoir d’autres atouts aux yeux du petit Kochan – tout particulièrement celui qui, combattant un dragon, subit mille douleurs et mille morts : Kochan, ou plus exactement son être adulte se repenchant sur son enfance de sorte à la rendre plus romanesque (un masque parmi tant d’autres), perçoit bien que ce sont ces souffrances qui lui plaisent – et quand le conte s’autorise la fantaisie de ressusciter le héros et de lui donner l’occasion de vaincre, le petit lecteur se sent floué : il relit sans cesse l’histoire, mais en n’en conservant que les passages de souffrance et de mort – c’est le reste qu’il censure, en masquant les mots malheureusement positifs de sa petite main d’enfant.
L’éveil à la sexualité, bientôt, changera la donne – ou, non, l’éclaircira, au fil d’un récit qui se déroule comme naturellement de causes en conséquences. Le passage, très célèbre, et tellement fort, vaut bien d’être cité (pp. 42-45) :
Je commençai par tourner une page vers la fin du volume. Soudain apparut, à l’angle de la page suivante, une image dont je ne pus m’empêcher de croire qu’elle était là pour moi, à m’attendre.
C’était une reproduction du Saint Sébastien de Guido Reni, qui fait partie des collections du Palazzo Rosso, à Gênes.
Le tronc noir et légèrement oblique de l’arbre servant de poteau d’exécution se détachait sur un fond de forêt sombre et de ciel crépusculaire, ténébreux et lointain, dans le style de Titien. Un jeune homme d’une beauté remarquable était attaché nu au tronc d’arbre. Ses mains croisées étaient levées très haut et les courroies qui lui liaient les poignets étaient fixées à l’arbre. Aucun autre lien n’était visible et le seul vêtement qui couvrît la nudité du jeune homme était une grossière étoffe blanche nouée lâchement autour des reins.
Je crus deviner que le tableau représentait le martyre d’un chrétien. Mais comme il était l’œuvre d’un peintre épris de beauté, appartenant à l’école éclectique issue de la Renaissance, même cette image de la mort d’un saint chrétien dégageait une forte odeur de paganisme. Le corps du jeune homme – on aurait pu le comparer à celui d’Antinoüs, le bien-aimé d’Hadrien, dont la beauté a été si souvent immortalisée par la sculpture – ne montre aucune trace des épreuves du missionnaire ou de la décrépitude qu’on trouve dans les représentations d’autres saints ; au contraire, il n’y a là rien d’autre que le printemps de la jeunesse, rien que lumière, beauté et plaisir.
Son incomparable nudité blanche rayonne sur un fond de crépuscule. Ses bras musclés, les bras d’un garde prétorien accoutumé à bander l’arc et à manier l’épée, sont levés selon un angle gracieux et ses poignets liés sont croisés juste au-dessus de sa tête. Son visage est légèrement tourné vers le ciel et ses yeux grands ouverts contemplent avec une profonde sérénité la gloire céleste. Ce n’est pas la souffrance qui erre sur sa poitrine tendue, son ventre rigide, ses hanches légèrement torses, mais une lueur d’un mélancolique plaisir, pareil à la musique. N’étaient les flèches aux traits profondément enfoncés dans son aisselle gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un athlète romain se reposant, appuyé contre un arbre sombre, dans un jardin.
Les flèches ont mordu dans la jeune chair ferme et parfumée et vont consumer son corps au plus profond, par les flammes de la souffrance et de l’extase suprêmes. Mais il n’y a ni sang répandu, ni même cette multitude de flèches qu’on voit sur d’autres représentations du martyre de saint Sébastien. Deux flèches seulement projettent leur ombre tranquille et gracieuse sur la douceur de sa peau, comme l’ombre d’un arbuste tombant sur un escalier de marbre.
Mais c’est plus tard que toutes ces interprétations et ces observations me vinrent à l’esprit.
Ce jour-là, à l’instant même où je jetai les yeux sur cette image, tout mon être se mit à trembler d’une joie païenne. Mon sang bouillonnait, mes reins se gonflaient comme sous l’effet de la colère. La partie monstrueuse de ma personne qui était prête à éclater attendait que j’en fisse usage, avec une ardeur jusqu’alors inconnue, me reprochant mon ignorance, haletante d’indignation. Mes mains, tout à fait inconsciemment, commencèrent un geste qu’on ne leur avait jamais enseigné. Je sentis un je ne sais quoi secret et radieux bondir rapidement à l’attaque, venu d’au-dedans de moi. Soudain la chose jaillit, apportant un enivrement aveuglant.
Un moment s’écoula, puis, en proie à des sentiments de profonde tristesse, je portai mes regards autour du pupitre devant lequel j’étais assis. Un érable, en face de la fenêtre, jetait alentour un reflet brillant – sur la bouteille d’encre, sur mes livres de classe et mes cahiers, sur le dictionnaire et sur l’image de saint Sébastien. Il y avait un peu partout des taches d’un blanc de nuage – sur le titre imprimé en lettres d’or d’un manuel, sur le flanc de la bouteille d’encre, sur un angle du dictionnaire. Certains objets laissaient échapper des gouttes molles, comme du plomb, d’autres luisaient d’un reflet terne, comme les yeux d’un poisson mort. Par bonheur, un mouvement réflexe de ma main pour protéger l’image avait empêché que le livre ne fût souillé.
Ce fut ma première éjaculation. Ce fut aussi le début, maladroit et nullement prémédité, de mes « mauvaises habitudes ».
Cette épiphanie, car l’excitant martyre lui confère d’emblée quelque chose de sacré (et, à nos yeux de lecteurs, on y voit l’origine de ce qui est peut-être la plus célèbre photographie de Mishima), cette révélation, donc, n’est peut-être pas immédiatement vécue comme telle – notamment parce que, dans la société japonaise des années 1930 plus encore qu’aujourd’hui, outre que les « mauvaises habitudes » suscitent invraisemblablement la suspicion voire la colère, comme elles le font étrangement toujours, dans cette société, donc, les inclinations de Kochan sont inavouables. Le collège, le lycée, sont des manufactures de normalité – bien hypocrites cependant : les jeux des garçons sont comme de juste imprégnés d’un érotisme, et parfois (souvent) d’un homoérotisme à peine dissimulé, qu’il serait vain de nier. Et puis, bien sûr, il y a ces figures qui excitent les fantasmes : Omi, le voyou, plus âgé que les autres, dur, beau. J’ai envie de relever combien les amitiés et attirances scolaires, dans La Déchéance d’un homme et dans Confession d’un masque, peuvent se reprendre, se refléter, ou se répondre, parfois se contredire, mais, je crois dans un même mouvement. De manière plus assurée, il apparaît que Kochan/Mishima conservera toujours une attirance pour les voyous, les brutes, dont la fin du roman témoigne, comme l’arrivée au terme d’une démonstration mathématique pas si compliquée en fin de compte. Cette fascination pour le corps masculin, peut-être héritée de la statuaire ou de la peinture, trouvera enfin à s’incarner dans l’investissement maniaque de Mishima dans le culturisme : honteux de son corps frêle, celui de Kochan, celui qui s’est fait réformer pendant la guerre, il entendra se sculpter, se parfaire – comme un livre, comme une mort.
Mais il y a un entre-deux – qui peut étonner. De fait, Confession d’un masque progresse initialement comme le récit de la découverte par Kochan de son homosexualité, d’abord dans les livres, puis au collège et au lycée – sans pour autant nouer de véritables relations charnelles. Mais le propos, au-delà, n’est finalement pas celui de l’acceptation de son homosexualité, pas du moins avant les tout derniers paragraphes, et pas vraiment non plus celui des souffrances que l’impossibilité sociale de s’assumer ainsi susciterait : dans toute la seconde moitié du roman, c’est bien l’idée du « masque » qui domine – mais de manière justement dépassionnée. La quatrième de couverture parle d’un « récit torturé sur la frustration du désir » ; c’est pour partie vrai, et pourtant insuffisant, je pense – car le désir même frustré n’a pas forcément beaucoup de place dans ces pages. La tentative, même condamnée d’avance, de feindre la « normalité », notamment au travers d’une amourette sciemment plate car forcément vide avec une jeune femme du nom de Sonoko, donne bien davantage le sentiment d’une neutralité fade (si le style est tout sauf ça !), ni désir, ni véritable refoulement – une mauvaise pièce de théâtre, où les acteurs portent nécessairement des masques, et feignent des émotions qu’ils seraient bien en peine de ressentir… en pleine connaissance de cause.
Cet entre-deux, d’ailleurs, ne concerne pas que le désir sexuel – à moins qu’il ne faille y associer, et il faut probablement le faire, les fantasmes masochistes suscités dès l’enfance par ces contes revisités où le dragon triomphe du chevalier, et d’autres plus tardifs, comme ce festin cannibale aux accents sadiens, qui contamine les rêves inavouables de Kochan en pleine tourmente molle. D’une certaine manière, le Japon en guerre est comme une hyperbole de ces fantasmes – avec moins de grandiloquence, pourtant ? Car le jeune homme, guère investi dans ses études, ne vibre alors pour rien – son masque déteint sur absolument tout le reste, atténuant les contours jusqu’à les effacer. Le Mishima de la fin des années 1960, qui dirige une société paramilitaire, et loue l’empereur à la moindre occasion, jusque devant ces étudiants gauchistes qui, ceci mis à part, lui paraissent comme des frères, est aux antipodes du Kochan des années de guerre, décrit par le Mishima de 1949. Indifférent à la guerre, tout de même trop heureux, malgré ses poses, d’y échapper en raison d’un début de tuberculose (qui lui fera honte plus tard), le jeune homme ignore les batailles perdues, et les bombardements et leurs drames, comme si ce grand suicide du Japon militariste et nationaliste n’était pas assez masochiste pour véritablement l’exciter ; je suis tenté, ici, d’établir un parallèle avec Le Pavillon d’or. Et Kochan semble perpétuellement en attente – du mariage avec Sonoko, pourraient avancer certains, dont la principale intéressée ? Non : Kochan ne poussera pas la mascarade aussi loin. Il continuera d’attendre – et reprendra en fait la mascarade d’une manière plus mesquine encore, en s’accordant des rendez-vous volés avec une Sonoko mariée ; en dernier recours, c’est à ses côtés, dans cette atmosphère pesante de faux adultère, qu’il prendra finalement conscience de ce dont il a besoin – soit tout autre chose.
Le récit de Mishima est assurément d’une grande force – mais il est aussi surprenant, notamment en ce que la trame attendue d’une certaine manière est en définitive remisée de côté. La frustration du désir est bien là, mais relativement à l’arrière-plan, passé les chapitres de l’enfance et de l’adolescence (qui, je ne prétendrai pas le contraire, sont de loin ceux qui m’ont le plus séduit). Le roman, à part égale, évite tout pathos pour se réfugier dans une froideur et un détachement qui relèvent probablement pour partie de l’imposture, mais ils n’en dominent pas moins le ressenti dans la seconde moitié du roman. L’auteur a traqué dans l’enfance l’être perverti qu’il croit constitutif de sa personne adulte, mais, délibérément, le portrait de l’adulte est d’abord celui d’un être tout opposé, creux, ou vide – ce qui entre peut-être (ou peut-être pas, car la spiritualité y a une part absente de ce premier chef-d’œuvre) en résonance avec le titre de la lecture de Marguerite Yourcenar. En somme, le roman de Mishima souffle le chaud et le froid exactement là où on ne les attend pas, peut-être du fait d’un certain formatage de ce type de récit : le charnel est ici du domaine de l’enfance, et irrémédiablement associé à l’art au sens large ; la froideur est caractéristique d’un adulte qui ne ressent rien, même dans un monde qui s’écroule autour de lui (et ici aussi je suis tenté de lire Dazai en parallèle, chez qui c'est un symptôme marqué de la dépression).
Maintenant, l’atout essentiel de l’auteur, celui qui unit ces deux moments du récit et avec un brio indéniable, réside dans sa plume. Or, ici, il y a un problème – car Confession d’un masque, comme un certain nombre d’autres œuvres de Mishima, a pâti d’une double traduction : cette version française est traduite de l’anglais, par Renée Villoteau. Telle pratique est toujours problématique : si traduire est trahir, la trahison ne peut être que plus signifiante encore quand la traduction est au carré. J’ai cru comprendre qu’une nouvelle traduction, du japonais cette fois, serait prévue pour l’an prochain ? Quoi qu’il en soit, ce texte français en l’état est bien d’une grande beauté, d’une grande élégance aussi – je suppose que l’extrait cité plus haut en témoigne. En fait, il a même quelque chose de précieux, qui apparaît souvent en décalage avec les événements rapportés – tout particulièrement, en fait, quand le Kochan enfant puis adulte, sous la plume certes du jeune écrivain Mishima, fait étalage de ses connaissances et de ses goûts en peinture comme en poésie. Mais ce décalage, sans doute, fait partie du « masque » : la confession est censée révéler ce que le masque cachait, mais, à la publication du roman, Mishima porte toujours un masque – et il le fera jusqu’au jour fatidique du 25 novembre 1970 ; une succession de personnages, en fait, plutôt qu’un seul – en dépit des redondances de façade, des explorations répétées des mêmes thèmes, des mêmes obsessions. Reste que l’écrivain Mishima naît véritablement avec Confession d’un masque : il brille dès le départ. Il a 24 ans – il a déjà vécu plus de la moitié de sa vie ; mais bien d’autres livres suivront, pour confirmer son génie.
YOURCENAR EN MÉDITATION
L’essai de Marguerite Yourcenar Mishima ou la vision du vide paraît en 1980, soit dix ans après le suicide de l’écrivain japonais. En fait, à ce que j’ai cru comprendre, il paraît peu ou prou en même temps que la traduction française de L’Ange en décomposition (L’Ange pourrit, dans le texte de Yourcenar composé un peu avant) – ce roman étant le dernier de la tétralogie de « La Mer de la Fertilité », et le dernier de Mishima tout court, puisqu’il en a fameusement envoyé le manuscrit définitif à son éditeur au matin de son suicide. La mort de l’auteur joue forcément un certain rôle dans cette lecture, elle était déjà devenue l’événement primordial à mentionner avant toute critique, mais l’autrice entend malgré tout parler des livres de Mishima – des meilleurs seulement, car elle sait bien qu’une part non négligeable de sa production était alimentaire.
De fait, ce court essai repose sur des choix marqués, des œuvres qu’il faut étudier, de celles sur lesquelles on peut passer. Pour ce qui est des romans, Marguerite Yourcenar traite surtout, mais assez brièvement, de Confession d’un masque donc, du Tumulte des flots, du Pavillon d’or et d’Après le banquet, assez vite cependant pour chacun d’entre eux, et surtout, bien plus massivement, de la tétralogie de « La Mer de la Fertilité » : Neige de printemps, Chevaux échappés, Le Temple de l’aube et L’Ange en décomposition (donc). Quelques nouvelles sont évoquées rapidement, individuellement plutôt qu’au travers des recueils les compilant : « Patriotisme », éventuellement, encore que Yourcenar préfère s’attarder sur le film qu’en a tiré Mishima lui-même, Yûkoku, rites d’amour et de mort, qu’elle aime (vraiment) beaucoup ; je crois me souvenir qu’elle mentionne hâtivement « Onnagata », nouvelle qui entre d’ailleurs d’une certaine manière en résonance avec Confession d’un masque. Pour ce qui est du théâtre, elle évoque à peu près dans une égale mesure (étrangement ?) Cinq Nô modernes et Madame de Sade. Concernant les essais, enfin, Le Soleil et l’acier a droit à quelques lignes – pas tant que cela Le Japon moderne et l’éthique samouraï, ceci alors même que Marguerite Yourcenar ne manque pas de mentionner que Mishima Yukio avait lu avec délectation et une grande attention le Hagakure. Autant de choix légitimes, pour un essai de cette taille, qui n’avait certes pas la prétention de se montrer exhaustif.
Et il me faut sans doute témoigner ici de mes lacunes : des huit romans cités, je n’en ai lu que deux ; j’ai lu les deux nouvelles que j’ai mentionnées, et j’ai vu le film Yûkoku, mais, côté théâtre, je n’ai lu que Madame de Sade, et, côté essais, que Le Japon moderne et l’éthique samouraï. Clairement, cela m’interdit de porter un jugement bien assuré sur la valeur de la lecture de Marguerite Yourcenar…
Disons… que je lui fais confiance ? Je suppose qu’un grand écrivain n’est pas forcément un grand critique (ne parlons même pas de l’inverse), mais ce statut autorise peut-être tout de même quelques remarques qu’un plumitif ne pourrait pas se permettre. Car Marguerite Yourcenar apprécie à l’évidence l’œuvre de Mishima – son œuvre « artistique », du moins –, mais ne lui épargne pas pour autant ses critiques, y compris dans les livres qu’elle loue le plus.
L’exemple le plus frappant concerne probablement le bouddhisme – et est associé ici, surtout, à « La Mer de la Fertilité » (il aurait probablement pu l’être à peu près autant au Pavillon d’or, mais, concernant ce roman, Marguerite Yourcenar ne s’attarde guère). L’autrice reproche à Mishima d’avoir, en gros, « recopié des encyclopédies » (du Houellebecq avant l’heure, diraient les mauvaises langues – et j’aime bien Houellebecq par ailleurs) pour exposer un peu lourdement le substrat bouddhique de la tétralogie, qui joue sur la transmigration des âmes ; elle affirme que le bouddhisme n’intéressait guère Mishima, davantage porté sur le shintô, et qu’il se retrouvait ainsi dans la situation d’un écrivain français contemporain athée qui voudrait écrire à propos d’un séminariste... Mais elle lui reproche en même temps d’avoir contaminé cette représentation de la réincarnation, hautement intellectuelle, avec d’autres davantage populaires et relevant de la superstition, comme les grains de beauté qui se retrouvent de génération en génération, ou les personnages condamnés à périr au même âge que leur précédente incarnation… Elle y voyait des incompatibilités franches, et des faiblesses dans la composition. N’ayant pas lu ces romans, et ne sachant pas grand-chose du bouddhisme, je suis bien évidemment incapable d’en dire quoi que ce soit, mais j’avoue ne pas être certain, pour le coup, qu’une romancière française soit la mieux placée pour expliquer à un Japonais ce qu’est le bouddhisme… Bon, je n’en sais rien.
Ceci mis à part… Enfin, non : on ne peut pas vraiment le mettre à part, car c’est là le cœur de la tétralogie de « La Mer de la Fertilité », soit et de loin la principale œuvre disséquée ici ; par ailleurs, l’apposition de cette lecture et du récit des derniers instants de Mishima suscite chez l’autrice de nouvelles résonances bouddhiques, ou peut-être issues aussi d’autres spiritualités orientales (elle mentionne l’hindouisme, sauf erreur, mais je suppose que le taoïsme au moins y aurait également eu sa part) : c’est bien ainsi qu’elle peut parler de ce « vide » qui n’a pas les connotations que nous lui associons instinctivement en Occident – et dont je suppose qu’il s’accommode bien du concept très japonais (mais qui a bien des sources bouddhiques) de l’impermanence des choses. L’analyse serrée des quatre derniers romans de Mishima reflète forcément le récit de sa mort – et l’on se demande dès lors qu’elle était la part de préparation consciente dans tout cela, comme on se le demandait en lisant « Patriotisme » ou en regardant Yûkoku. Marguerite Yourcenar, cela dit, ne peut pas vraiment répondre à cette question : il y faudrait un biographe autrement mieux au fait des réalités de la vie de l’auteur et du Japon de son temps et même d’avant – j’ai, dans ma pile à lire, Mort et vie de Mishima, de Henry Scott-Stokes, et il me faudra bien lire cette biographie souvent citée.
Peut-être à vrai dire mon rapport à ce livre sera-t-il différent de celui concernant Mishima ou la vision du vide ? A fortiori, bien sûr, si je peux lire quelques autres Mishima d’ici-là… dont « La Mer de la Fertilité ». Car mes lacunes, en lisant l’essai de Marguerite Yourcenar, se sont révélées conformes à mes craintes : je n’en savais pas assez de Mishima, ou des œuvres de Mishima, pour appréhender au mieux la pertinence de l’essai.
Cela n’a pas été pour autant une lecture vaine – car il y a la belle plume de Marguerite Yourcenar. Son essai n’a rien d’une sécheresse universitaire ou journalistique : il a une valeur littéraire qui lui est propre, il est une œuvre littéraire. La beauté du style suffit, avec la construction réfléchie, à conférer à cette lecture quelque chose de romanesque. Peut-être y a-t-il alors une part de « masque », dans cette évocation d’un mort ? De fait, elle ne déparerait pas tant que cela dans une pièce de nô – voire dans un des Nô modernes de Mishima ? L’impact sur le lecteur, en tout cas, est certain.
Quoi qu’il en soit, ces deux livres, chacun bien sûr d’une manière qui lui est propre, incitent à lire davantage de Mishima – et je compte bien le faire.