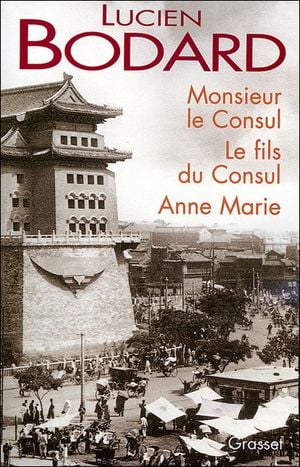Difficile de s’attaquer à cette trilogie aux fortes inspirations autobiographiques. Epopée romanesque de quelques 1000 pages, ces trois tomes sont aussi riches de détails que le rouleau de peinture chinoise célèbre Le long de la rivière pendant le Festival Qingming. On y découvre travers le regard d’un consul de France à Chengdu, dans celui de son fils puis de sa femme la Chine des années 1920. Aux prises avec les soubresauts d’une société féodale moribonde où le parti communiste est en train de tisser sa toile, la Chine d’alors inquiète autant qu’elle fascine la société coloniale de l’époque. Portée par une langue foisonnante d’adjectifs (oubliés), chaque ligne ou presque nous intime l’ordre d’ouvrir un dictionnaire. En recourant sans modération aux champs lexicaux de la misère et de la guerre mais aussi des plaisirs célestes, le récit nous emporte dans un tourbillon d’évènements décrits de façon quasi documentaires. L’épisode de la construction du chemin de fer au Yunnan est de ce point de vue parlant. On imagine cette armée de coolies dont le turn over est digne d’une usine de fornox travailler à main nues sur les pentes escarpées du Yunnan.
La Chine de la première République y est décrite comme une véritable pétaudière où le Consul de France essaie d’étendre la zone traditionnelle d’influence française située au Yunnan, province alors frontalière du Vietnam, sous domination française. On y découvre les jeux d’influence, les retournements d’alliances et autres chinoiseries militaires des seigneurs de guerre, qui tentent alors d’unifier le grand ouest chinois sous leur joug. Jouant avec les intérêts français contre les intérêts anglais et inversement, l’auteur nous offre un tableau politique aussi indéchiffrable que chaotique où missionnaires, colons français, mandarins et militaires s’affrontent ou s’allient au gré des saisons politiques.
En se mettant dans la peau de ses trois narrateurs, Lucien Bodard nous donne à voir un kaléidoscope de perceptions, d’illusions et de souvenirs de cette époque. Lucide ou plongé dans le brouillard de l’opium, le Consul tout pétri qu’il est de sa propre importance, donne une image peu glorieuse de la diplomatie française. Heureusement, cette autosuffisance s’estompe parfois au profit de qualités plus nobles, comme le devoir quand la situation atteint son climax de chaos ou de dangers. Mais les petits ou les grands accomplissements du Consul sont perçus par sa femme ou son fils comme des gesticulations anecdotiques, alors qu’ils présentent certains de ses accomplissements comme la construction du train au Yunnan comme de véritables succès diplomatiques. Le Consul de France c’est la France, et l’entourage d’Albert Bodard s’amuse beaucoup de ces élans patriotiques boursouflés de fierté personnelle. Dans la peau de Lucien, cette grandiloquence est ciselée et ridiculisée, une attitude de rejet du père encore renforcée par le dégout qu’inspire son père à sa mère, Anne Marie. Dans les yeux de l’enfant, la Chine et ses horreurs, des tortures aux scènes de purges collectives, est un jeu qui fait de lui un enfant plus chinois que français.
Un siècle après la fin des concessions, que reste-t-il de cette Chine humiliée, que peut nous dire ce roman sur la Chine d’aujourd’hui? On est parfois surpris après quelques années de vie en Chine de l’effet d’optique dont sont victimes les observateurs et les journalistes quand il parle de la Chine, aucun article de s’écrit aujourd’hui pour parler de Pékin sans une petite phrase sur le nuage de pollution, qui asphyxie la ville. L’auteur est-il aussi victime d’un même tropique ? Peut-on s’attacher à traiter d’un sujet aussi vaste et aussi opaque que la sinité sans en être victime? Bien qu’on puisse à première vue qualifier certains passages d’orientalistes, braqués sur une esthétisation de la misère et une magnification des rites et de la culture chinoise, je pense qu’au contraire l’auteur accède à une telle sinité qu’il voit et présente ce que l’Autre (l’étranger) ne perçoit pas derrière la puissance de l’honneur et de la face en Chine. On perçoit cette différence au deuxième tome, quand l’auteur et le narrateur se confondent, alors Lucien Bodard apparaît plus chinois que les chinois, et nous laisse apprécier toute la puissance d’une intériorisation de la culture pour un enfant baigné dans un environnement biculturel.
Je crois que ce que l’auteur saisit le mieux et qui résonne encore aujourd’hui, c’est ce sentiment de masse et de toutes ses implications politiques et sociales. Cette image d’une armée de coolies envoyé sur le front du chemin de fer au Yunnan, dont le turn over rivalise avec celui d’une usine de fornox est pour moi toujours parlante aujourd’hui. L’indifférence des masses, devant sa propre perte, l’idée d’un corps social privée de tête et annihilé par le colonialisme hier et par le capitalisme féroce et triomphant d’aujourd’hui. Masse corvéable qui transforme les paysages avec sa force de travail, masse qui se rebelle comme un seul homme pour décapiter le féodalisme et demain...?