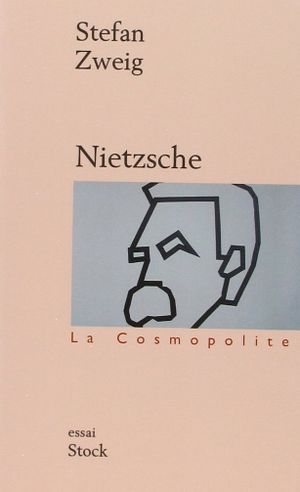Je ne connais pas assez Nietzsche, sinon de loin et par l'ouï-dire des commentaires et autres post-thuriféraires, pour me prononcer sur la justesse du portrait saisissant qu'en dresse Zweig - un portrait qui l'unit, si je ne me trompe, à Kleist et Hölderlin dans la fièvre commune d'une lutte avec le Béhémoth qui préside aux œuvres farouches.
Dans la percée d'une écriture aussi décidée que fulgurante, ce petit ouvrage va au cœur ardent de l'orage où se fut pris, en quête d'une vérité haute et pure plus que corps humain n'en peut supporter, l'ascète de Siels-Maria, stylite athée dont le chant fit conquête de l'insensé dont le nom est désespoir - au sens non pas de la perte irréfragable du plus haut idéal , mais d'une l'affirmation sans horizon d'attente, où ne peut que se perdre tout esprit encore en quête de quelque chose à dire ou d'une quelconque reconnaissance.
Fasciné par le Sud et les rouages subtils et météorologiques de son propre corps, Nietzsche largue les amarres en quittant philologie et Allemagne. Son œuvre jaillit comme sous la dictée du daimon l'action chez Socrate, dans l'exploration de ses propres rouages, dans la mise à nue toujours recommencée de ses propres roueries, sublime de clarté, d'exigence et, dans l'affirmation de soi, de déni fol - sans aucun des réconforts ambigus de la mystique. Ni abandon, ni réconfort : Nietzsche brule, se brule, explose et jaillit, impérissable dionysiaque que nulle démesure n'effraie - et il faut bien, pour l'hybris, un soi qui accepte la croix, ou le déchirement orphique.
L'esquisse détoure ici l'essence. Et c'est jouissance du lecteur. Je ne sais qui Zweig dépeint, de lui-même ou du plus poète des philosophes - si l'on accepte encore de voir en Nietzsche quelque chose de la philosophie, elle n'est plus celle des écoles. Ses pages témoignent d'une fascination assumée dans leur intransigeance décidée et la rigueur inquiète tant du propos et que de la construction. Plaisir rare.