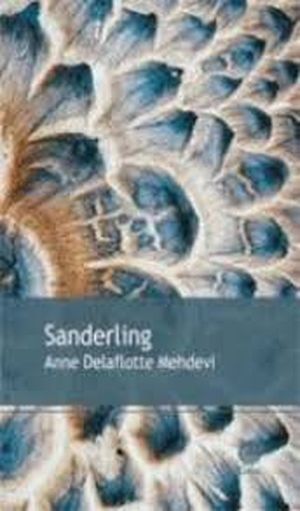Sanderling est un roman surprenant. Il débute comme un voyage introspectif : un paysan, après son divorce, trouve, après une tentative de suicide, une forme de paix intérieure à l’autre bout du monde, dans le froid du Groenland, à la rencontre des oiseaux sanderling, de grands migrateurs.
Et puis il revient au pays, et le roman devient une histoire de chair, et une histoire de terre ; il devient un récit du tissu social et historiel d’un petit morceau de la campagne française. Il parle de transition, et de renouveau ; il parle de passation ; il trouve les mots pour retranscrire les maux de ces hommes et de ces femmes, avec élégance, sans condescendance. C’est un beau récit, assuré et tranquille.
Et puis la catastrophe arrive : l’Islande explose, l’éruption est là, et l’Europe est ensevelie sous les cendres et les gaz, et le roman devient une histoire de survie. Il s’agit d’organiser la vie de tout ce petit monde, alors que la nourriture est une question cruciale, car les récoltes ne se font plus ; que le gouvernement disparaît et que l’ordre, en général, s’évanouit… Et tout autant que précédemment, le roman est un récit de personnages : de belles personnes, qui interagissent avec justesse mais sans heurts. On ne lui reprochera sincèrement que de s’accélérer sur les dernières dizaines de pages, se réduisant au passage à une simple narration d’évènements, là où le récit, et c’était là sa force, parvenait à se faire corps dans ce tissu de relations, passées, présentes, tumultueuses.
Il n’y a pas de génie dans Sanderling. C’est un bon travail, rondement mené. Mais les fils sont trop gros et la trame trop visible. Une bonne lecture, qui propose beaucoup – et c’est déjà bien faire – mais de laquelle on ne retire en fait pas grand’chose.