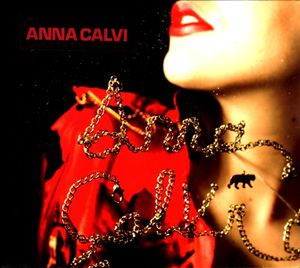Cher Brian Eno, Ces derniers temps, ton nom est sur toutes lèvres. Oui, tu as publié un album chez Warp, et ça fait un peu de bruit. Et MGMT t’a consacré une chanson. Mais si tout le monde te cite à tort et à travers, c’est pour ta soudaine passion pour cette Anna Calvi. Eh bien, crois-moi, avec un Brian, pas besoin de marketing viral ! Intrigués, on s’est tous précipités comme des moutons, et moi le premier, au concert de la jeune Anglaise. Faudra que tu m’expliques : c’était une blague, hein ? Ou une preuve par l’absurde qu’il ne suffit pas d’avoir de la voix pour écrire de bonnes chansons ? Merci, on le savait depuis un petit moment. Quelle purge ! Accompagnée d’un batteur bourrin et d’une amie à elle qui jonglait vainement entre un harmonium et quinze clochettes, la petite blonde renfrognée nous a servi des octaves au kilo. Pas facile.
Sans rire, Brian, t’étais où dans les années 90 ? T’en as pas souffert, de tous ces ersatz de Jeff Buckley qui ont allié vocalises inutiles et lourdeur pour faire genre, pour faire rock ? T’as pas l’impression que Suzanne & I, c’est une apprentie Scott Walker au karaoké du coin ? Toi, le non-musicien par excellence, tu supportes vraiment la débauche démonstrative de chant sur Blackout, Desire, et à peu près tout le reste ? Ou alors, bon esprit et enthousiaste, tu t’es enflammé pour la guitare hispanique de The Devil ? Car si c’est l’influence flamenco qui t’étonne, jette donc une oreille à Rome, qui l’a transcendée dans Flowers From Exile (2009). À moins que ce ne soit une de tes stratégies (forcément) obliques, farceur que tu es : épuisé à l’écoute de cette horreur, on ne peut que se plonger dans le calme de ton Music For Airports (1978) ou se défouler avec Here Come The Warm Jets (1973). Oui, c’est ça : tu voulais juste faire ton intéressant. C’est réussi. (magic)
Souvent, on a rêvé d’Anna Calvi. Comme, par exemple, quand on voyait sur scène PJ Harvey puis Jeff Buckley, en se disant que ça serait chouette qu’ils aient une fille. Anna Calvi, premier album de la frêle Anglaise, assouvit ce fantasme. Frêle ? Oui, dans la vie de tous les jours, où une timidité maladive n’empêche pourtant pas de pointer une personnalité majeure, au parcours et aux ambitions étonnants. Frêle, certainement pas sur scène où depuis un concert de début 2010, ce rock fugueur d’une beauté, d’une musicalité et d’une liberté terrassantes, nous a littéralement envoûtés. Entre blues terrien et émeute électrique, les chansons d’Anna Calvi la transportent visiblement elle aussi très loin, très haut – ceux qui l’ont vue au dernier Festival des Inrocks peuvent en témoigner. Des rockeurs de cette trempe, de cette audace, il n’en émerge que quelques-uns par décennie. Il suffit de parler à Anna pour mesurer à quel point elle est tout sauf une starlette catapultée par la grâce d’une seule chanson et d’un joli minois : travailleuse forcenée et boulimique de son, elle possède l’aplomb, la sagesse, les ambitions et la culture d’une pétroleuse taillée pour durer. On n’est donc pas étonné d’apprendre que la Londonienne possède déjà, avant même la sortie de son premier album, un fan-club des plus huppés. On y retrouve Brian Eno, qui se présente comme son “protecteur”, ou Nick Cave qui l’a choisie pour assurer les premières parties de son groupe Grinderman. Le rêve d’Anna Calvi – jouer à l’Olympia comme ses idoles Jeff Buckley et Edith Piaf – est désormais à portée de doigts, de fée. (inrocks)
Qui sont les véritables victimes d'une hype ? Le consommateur déçu par un artiste qu'on lui aura survendu, peut-être. Mais il lui restera toujours le droit et la liberté de se jurer que l'on ne l'y prendra plus. L'artiste alors, dont le talent encore balbutiant se révèle rarement à la hauteur des superlatifs le précédant ? Probablement. Mais pas toujours. Parfois la hype, impitoyable, sert de formidable parcours du combattant, d'obstacle franchissable aux seuls artistes dotés d'une force, d'une personnalité hors du commun. Anna Calvi, par exemple. Cette jeune Londonienne au charme vénéneux avait tout pour lasser avant même que son premier enregistrement ne voie le jour. Depuis plusieurs mois, son arrivée était annoncée comme celle du messie et son génie, proclamé d'emblée. De quoi irriter, se méfier, se bâtir des défenses. Et d'inutiles a priori qui, heureusement, s'effondrent le temps d'écouter son album en entier. Car si Anna Calvi rappelle bien sûr en de nombreux points son irréprochable aînée PJ Harvey, ce n'est pas parce que, comme d'autres, elle se contente de fidèlement l'imiter. Au-delà de telles intonations vocales (qui renvoient, comme chez PJ, à Chrissie Hynde et Patti Smith), d'un univers lyrique sombrement romantique, d'une musique aussi mélodramatique que dénuée d'inutiles effets, elle brille d'un charisme certain, d'une authentique personnalité, d'un univers déjà particulier. On comprend vite que Brian Eno ou Nick Cave, qui en ont vu d'autres, en soient tombés raides. Formée au violon et au classique (Debussy, Messiaen), Calvi a choisi de s'exprimer à la guitare, se forgeant un jeu sobre et intense, puissant et évocateur, qui conjugue le style du pionnier rock Duane Eddy avec la ferveur enfiévrée du flamenco, dont l'esthétique et la noirceur ont nourri l'imaginaire de l'Anglaise. Chez elle, dans ses chansons vibrantes et habitées, il est question d'extrême et d'absolu, de passion et de douleur. Noces de sang et amour à mort. Rien de tiède ici. Dieu merci. (HC)
On entend de partout de multiples jérémiades au sujet de ce disque. Fallait-il autant de discours, autant de comparaison, autant de haine aussi ? Ne pas l'aimer est une chose. Prendre des airs geignards en lui reprochant tous les maux de la terre dans des termes pleins de fiel est sûrement excessif et d'une rosserie stérile. On a l'impression qu'avec ce genre de disque la demi-mesure n'existe pas, qu'il faut en guise d'accroche être élogieux ou délateur sous prétexte d'une certaine indépendance "éditoriale". Vociférer sur la vacuité, cela peut en valoir la peine, y a de quoi s'amuser en ce moment dans l'actualité musicale. Mais là, un peu de mesure ! Il ne s'agit que d'un disque. D'un bon disque, rien de plus. Inutile dès lors d'exercer une sorte d'opprobre ou de bannissement.Cela étant dit, pour commencer, chose évidente, l'attaché de presse, une sorte de Marilyn tout droit sorti de "La carte et le Territoire" a dû faire un sacré boulot, nous laissant mijoter doucement, à petit feu depuis des mois. Chapeau !Nécessairement ce disque intrigue. Les premiers titres entendus ici et là auguraient déjà le calme et la tempête à la fois. "Jezebel" et "Moulinette" nous rappelaient qu'aujourd'hui rock et lyrisme étaient relégués dans les limbes des années 80-90. Un disque de cette espèce se détache naturellement du reste. Le charme de la demoiselle n'y est certainement pas pour rien dans toute cette agitation.Certes bourré d'écueils à commencer par cette intro trop démonstrative qu'est "Rider To The Sea", ce premier disque n'en est pas moins sémillant. "No More Words" l'un des sommets du disque avait toutes les qualités pour introduire l'album : ritournelle sixties, voix posée et magnifiquement libérée.Mais là où le bât blesse, c'est dans cette manière de vouloir chanter trop bas et d'élargir sa tessiture aux extrêmes. Cet effet assez désagréable produit une sorte de surenchère sur plusieurs titres. Ainsi "Desire" pourrait facilement se retrouver au générique de la finale de la Ligue des Champions tellement cela vire à une sorte de performance à la ferveur trop appuyée. Lui faut-il sûrement encore un peu de temps pour s'en défaire, l'apprivoiser pour la rendre plus spontanée. On est également tiraillé par le sentiment d'un manque patent de modestie, de bonhomie. "Devil" tourne à la performance larmoyante, sorte d'hymne "Piafien" sous la regard médusé de Buckley. On sait que la demoiselle est bourrée d'ambition et n'a pas froid aux yeux. De là à utiliser l'artillerie lourde... Elle nous offre ici un disque imparfait manquant souvent de maturité mais avec tout de même de grands titres tels que "First We Kiss" ou "Blackout" ainsi qu'une mise en avant de la guitare, dont elle joue à merveille, assez réussie sur toute la longueur du disque.
Oubliée dans quelques semaines Anna Calvi ? Beaucoup moins sûr. (popnews)
Voilà un album qui n'arrive pas en toute discrétion, c'est le moins qu'on puisse dire. Conséquence, certains, sur la foi d'un premier single, quelques morceaux disséminés ci et là et quelques concerts, vont l'accueillir à bras ouverts, conquis d'avance, tandis que d'autres vont au contraire se montrer circonspects devant la chose. Quelques précisions ne sont donc pas inutiles. On compare beaucoup Anna Calvi à PJ Harvey et Jeff Buckley. Les deux références ne sont pas fausses, et on retrouve sur le premier album de la londonienne çà et là des intonations de voix, ailleurs des accords de guitare, qui évoqueront l'un et l'autre. Cependant, de manière plus globale, si elle rappelle ces deux figures tutélaires, c'est avant tout par son aplomb, son assurance, sa liberté de ton et une capacité à repousser les genres. Ensuite, comme toujours, un avis sur un album ne vaut qu'après plusieurs écoutes, histoire de de se débarrasser de ses à priori, qu'ils soient négatifs ou positifs. Une première écoute ne suscite d'ailleurs aucune onde de choc. On louera la voix superbe d'Anna Calvi, son allant, mais on aura aussi le sentiment qu'elle en fait parfois un peu trop et que ses compositions n'ont rien de révolutionnaire. C'est donc petit à petit qu'on affine son jugement. Et qu'on commence par noter le recours à un jeu de guitare fait d'accords bluesy qui résonnent longuement, et dont le côté froid s'oppose à une voix chaleureuse, créant un contraste des plus saisissants. On est ensuite séduit par une capacité à attirer lentement l'auditeur dans ses filets, le langoureux No more words notamment étant un véritable chant de sirène. Puis c'est l'euphorie qui se dégage de Desire ou Suzanne and I qui nous épate. Et là, on prend conscience qu'en quatre morceaux, Anna Calvi a déjà brassé toute une palette d'ambiances sans aucune difficulté, sans contradiction. Surtout, si la base de ses morceaux est plutôt classique, elle en repousse à chaque fois les limites avec un chant ample et une verve musicale qui les emmène toujours ailleurs et en fait leur singularité. Parfois c'est la légèreté de la pop qui nous attend, à d'autres moments la profondeur du blues ou du flamenco. Sur The devil, on se laisse transpercer par la limpidité et la gravité du propos, puis sur Blackout, c'est le côté sucré, presque mutin qui nous séduit, rappelant un peu une Nancy Sinatra. Cette singularité, et c'est le plus important, fait de ce premier album un objet complètement hermétique aux tendances. Anna Calvi n'est pas la figure de proue d'un mouvement auquel la presse musicale s'empresserait de trouver un nom et que tout le monde aura oublié dans deux ans. A ce stade, on peut dire que ce début d'année a vu l'émergence d'une forte personnalité, qui a réussi à faire entendre sa sensibilité en s'inscrivant dans les traces de glorieux aînés. Evidemment, certains ne manqueront pas de la rabaisser, de nier cette singularité pour la ramener au rang d'ersatz. Mais à vrai dire, ce n'est pas très grave. (indiepoprock)