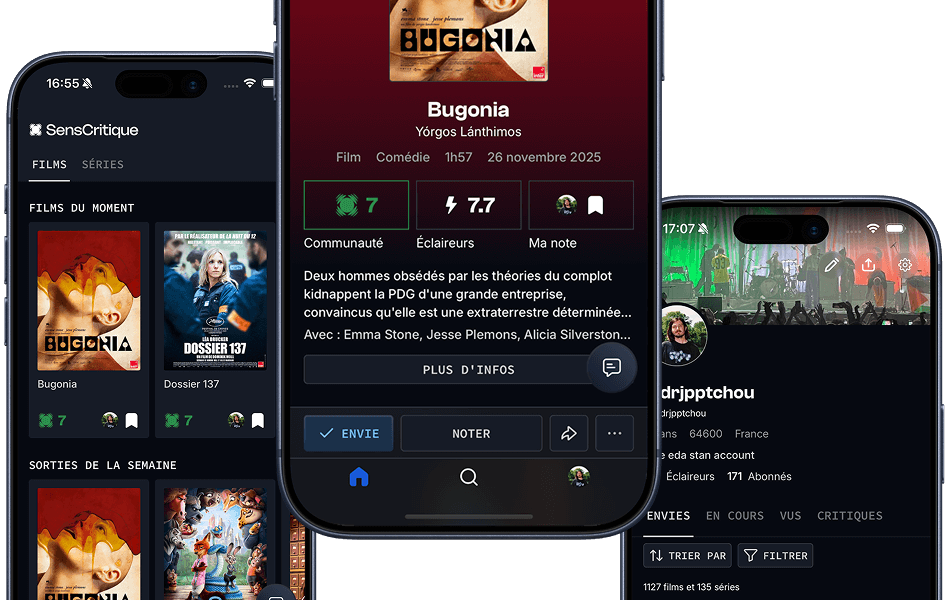Adaptation très libre du premier roman de Stephen King, Carrie au Bal du Diable est une référence du fantastique et de l’horreur aussi importante que Halloween de Carpenter. Le film est signé Brian De Palma et participe à son ascension juste après la comédie musicale Phantom of the Paradise, elle aussi devenue culte. Il se concentre autour de Carrie White, une adolescente de dix-sept ans cloîtrée, souffre-douleur de l’ensemble de son entourage, de ses camarades adaptées à sa mère dégénérée.
Présentant la revanche d’une opprimée, Carrie a clairement un côté démagogique, ou salutaire, selon ses prudences et exigences morales. C’est l’emblème final de la vengeance des victimes de la cour de récré, ou bien du lycée. De Palma en fait quelque chose de très beau et transparent, sans arrière-pensée. Il nous montre la cruauté de la jeunesse, avec l’éveil des chasseurs et la peine des innocents ; et la cruauté, par extension, de la vie exigeant de nous d’être compétitifs.
Au départ le degré d’ingénuité de Carrie (Sissy Spacek) est l’information la plus choquante. Que Carrie soit marginale ou excentrique n’est rien, mais qu’elle soit candide, si facile à avoir, si malmenée, bref si victime est extrêmement troublant. Naturellement l’envie de la remuer mais aussi de la soutenir de Miss Collins (Betty Buckley) est partagée, mais par-dessous tout c’est la compassion qu’on éprouve, comme rarement au cinéma, pour cette malheureuse. Carrie n’a aucun repère sain dans l’existence, aucun havre de paix. Tout ne peut qu’être trop lourd pour elle.
Finalement le film rejoint plutôt L’Ange de la Vengeance, où les acteurs de l’injustice mais aussi ceux qui se sont montrés complaisants sont punis de manière disproportionnée, bien que fondée. Et si au final, tout le monde (sauf le cavalier) participe à la grande humiliation de la soirée du lycée ; tout le long du film, les caractères sont nuancés, certains ont tenté d’approcher ou d’aider Carrie, même paradoxalement (de Mademoiselle Collins à la copine du cavalier, en passant par le directeur).
Si les accents kitsch du film sont indéniables et la prestation de John Travolta assez stérile, c’est aussi une merveille de mise en scène. Passons l’usage du split screen que son auteur regrette bien qu’il soit largement apprécié ; décidément, de Pulsions à Carrie, Brian De Palma est le cinéaste sachant employer les mécanismes les plus démonstratifs sans sombrer dans le ridicule et au contraire, en obtenant un résultat à la lisière du merveilleux. Ses ralentis sont des modèles.
Brian De Palma s’illustre également par son audace, par exemple en utilisant les profondeurs de champ à plusieurs reprises pour des représentations frontales, au sens littéral. Plusieurs scènes nous montrent ainsi un arrière-plan (relativement) à égalité avec le premier, où le personnage dominant et filmé en rapproché est rattrapé par un autre. De manière plus globale, l’érotisme contrarié et la solitude sont représentés de manière brillante, alliant la magie du conte au réalisme cru.
Pendant le film nous ressentons cet éveil à la vie si complexe à capter. La sacralisation du bal en est l’expression la plus claire. Alors que pour Carrie, tout dans le monde est gigantesque, pour les autres, tout est sujet d’expérience ou de conquête et finalement, tout est déjà banalisé. Sauf le bal. C’est le seul totem respecté et désiré unanimement (et presque un objet de transmission, une étape, comme le souligne l’intervention de Miss Collins) et donc où chacun se retrouve à ce niveau de transe virginale qui définit la condition de Carrie.
Grand Prix du festival d’Avoriaz en 1977, moment-clé du cinéma de l’épouvante, film remarquable sur l’adolescence, Carrie a connu une suite en 1997, un remake en 2013, une adaptation en comédie musicale et sa séquence du bal est l’une des plus connues et citées du cinéma, bien plus qu’elle n’est vue.
Avec Carrie nous rencontrons le De Palma déchirant, celui qui s’est également manifesté dans Blow Out et Obsession. Il en reste une autre image marquante, celle de Piper Laurie en mère tyrannique et surtout en mystique déviante. Une performance qui signait sa restauration après la traversée du désert, une décennie avant qu’elle n’incarne la redoutable Catherine Martell dans Twin Peaks.