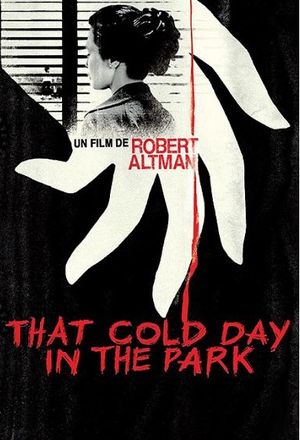Film d’intérieurs et de portraits, sociaux et individuels, That cold day in the park est un objet étrange, malsain et fascinant.
L’univers bourgeois dépeint dans la scène inaugurale est déjà étouffant : clos, écrasé par de courtes focales, il met en scène des vieillards auxquels Frances semble assimilée. Masquée par une rigueur aussi impeccable que pathétique, son regard se porte sur l’extérieur et ce jeune homme qu’elle finira par inviter afin qu’il se protège de la pluie et du froid.
Le duo improbable qui nait entre eux nous piège au départ par son originalité : elle, touchante de prévenance, lui, insolite et fantasque par son mutisme forcé.
Les indices que l’on glane progressivement et de façon toujours elliptiques, sont avant tout disséminés pour dire l’impénétrabilité des êtres : on s’amuse, on se séduit, on se repousse. En écho des tentatives de Frances d’obtenir une relation avec le jeune homme, son refus dégouté d’un vieux prétendant poussiéreux. En parallèle de la résistance de ce premier, sa relation ambiguë, voire incestueuse à sa sœur qui s’incruste dans la maison de son hôte.
Mais la chronique sociale (la bourgeoise et le faux bohème) ne dure qu’un temps : c’est du côté d’Hitchcock, voire du futur De Palma, en moins ostentatoire et plus feutré, que se dirige le récit.
Huis clos de plus en plus oppressant, celui-ci prend le dialogue pour principal sujet d’exploration : esseulée, Frances cherche dans l’audace de son initiative la récompense par le contact. Mais celui-ci se réduit à un monologue qu’écoute, apparemment amusé, le jeune homme qui pousse le jeu jusqu’à la droguer. Cet échange qui vire à la psychothérapie évoque fortement le Persona de Bergman, et ses dérives hystériques en deviennent attendues. La très belle scène de confession de Frances au jeune homme qu’elle croit sous la couverture en est le symptôme : nous sommes toujours seuls.
A bien y réfléchir, tout est dit dès le départ : l’oppressant enfermement, la solitude qui rend tape sur le système. L’attention démesurée de Frances (Sandy Dennis, grandiose) aux conversations qui l’entourent, son rapport aux serrures et son regard trop intense trahissent les bords du gouffre. Le jeu de rôle, les allées et venues du jeune homme, son rapport final à la prostituée indiquent aussi un désœuvrement mortifère.
L’étouffement croissant, méthodique est donc la grande réussite du film. Sa mise en scène clinique est le plus souvent efficace, même si on peut avoir quelques réserves sur le recours un peu trop systématique aux zooms et aux transitions par le flou.
Anxiogène, perturbant, ce film propose un regard singulier sur des thématiques qui obsèdent des cinéastes comme Antonioni ou Bergman, et font entrer encore un peu plus l’Europe dans le cinéma américain.