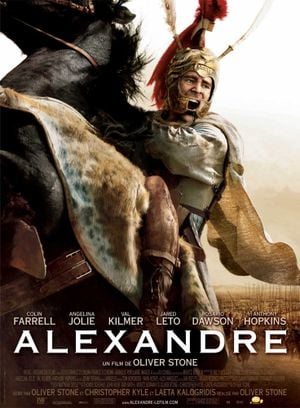Si Alexandre Le Grand est reconnu dans le monde entier pour avoir été l’un des plus grands conquérants de l’histoire, il fascine aussi pour le mystère qui l’entoure ; un mystère qui tient beaucoup à son ambivalence. Car le macédonien était capable d’autant de moments de grâce que de cruauté, tour à tour visionnaire et homme de son temps qu’il était. Ainsi livra t-il Persépolis - un des joyaux de l’empire Perse - aux flammes et au pillage alors qu’il épargnait Babylone, et faisait de nombre de ses anciens ennemis des collaborateurs précieux alors que, dans un instant de rage et de folie, il tuait l’un de ses plus fidèles et aimés généraux. Partant de là, il est donc assez surprenant, et heureux, de voir un film américain approcher le personnage sans sombrer dans l’hagiographie lénifiante ou le remodelage consensuel.
Il est en effet de coutume dans les films hollywoodiens d’aborder la grande histoire de façon assez libre, d’abord parce qu’elle est considérée comme une simple pourvoyeuse d’histoires, petites celles-ci, et ensuite parce qu’elle est souvent mêlée au mythe. Aussi, parce que leur vocation première est l’entertainment et non la véracité historique, les films « historiques » produits par Hollywood peuvent se permettre de faire preuve de largesses, d’anachronismes et parfois même de révisionnisme. Comme le disait John Ford dans L’homme qui tua Liberty Valance : « dans l’ouest, quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende ». Cette phrase, géniale clé de lecture des États-Unis, décrit aussi assez bien le mythe de Mégas Aléxandros, Alexandre Le Grand : ce mirage, ce voile impossible à percer qui a depuis bien des siècles recouvert la réalité de l’homme, Alexandre III de Macédoine.
Autant dire que le travail d’archéologie du mythe auquel se livre ici Oliver Stone tient de l’hybris, car sa finalité est une chimère. Impossible en effet d’exhumer le vrai Alexandre. Ses secrets résident avec lui au fond de son tombeau, et ce dernier a disparu des écrans radars depuis longtemps. Aussi, la belle audace, et en même temps l’humilité, d’Oliver Stone consiste à tenter de remonter le fleuve du mythe en sachant très bien qu’il n’en atteindra jamais la source. Et le spectateur, au risque de se noyer, devra se contenter du voyage en se raccrochant aux hypothèses toutes personnelles que lui lance le réalisateur en guise de bouées de sauvetages. Un parti pris aussi frustrant qu’admirable d’honnêteté.
**
Hybris alexandrine
**
Comme certains l’auront remarqué, l’admiration que porte Oliver Stone à la figure d’Alexandre Le Grand n’est pas une nouveauté. Son film n’est donc pas une œuvre de commande mais bien le projet personnel, et de longue date, d’un cinéaste par ailleurs connu pour l’intérêt qu’il porte à l’histoire et pour l’approche atypique qu’il en a. Ces facteurs réunis expliquent sans doute pourquoi Alexandre est une coproduction américano-européenne. L’ambition de Stone voulant faire autre chose qu’un produit standardisé certifié made in Hollywood n’a certainement pas été pour rassurer la Warner Bros qui aura investi très prudemment dans le projet. Celui-ci, sous nombre d’aspects anti-hollywoodien, aura en revanche attisé la curiosité de ses coproducteurs européens (français, anglais et allemands). Aussi, Alexandre est un objet d’autant plus étrange et paradoxal qu’il mêle ambition hollywoodienne et approche résolument non consensuelle.
Sa dimension hollywoodienne tient principalement à son ampleur qui n’est pas sans rappeler les films de l’âge d’or du péplum. Le film est d’ailleurs probablement le néo-péplum s’apparentant le plus ouvertement aux grands classiques d’alors, ne serait-ce que par son rendu par moments assez kitch (certaines images dignes d’un docu-fiction, la théâtralité des dialogues, le score de Vangelis qui oscille entre réelle inspiration et pompiérisme…). Il y a ici aussi cette même propension à la grandeur, voir même à la grandiloquence, que dans un Ben-Hur ou un Cléopâtre. Gigantisme des décors, immensité des espaces, tempête des passions, énormité des enjeux…, le réalisateur, comme à son habitude, ne fait pas dans la dentelle. Et l’excès qui caractérise nombre de ses films est ici reconduit pour le meilleur (les scènes de batailles, véritables boucheries furieuses et chaotiques ; les colères herculéennes d’Alexandre et de Philippe…) et pour le pire (les maladresses et fautes de goûts, un symbolisme animalier parfois assez lourd, l’idée d’un Alexandre en figure christique à l’issue de la dernière bataille…). Mais justement, c’est cette tendance à l’excès qui fait la spécificité du film, le fait sortir du rang, et se révèle particulièrement adapté à la figure qu’il décrit. Car on ne raconte pas la vie d’Alexandre Le Grand par le petit bout de la lorgnette - on n’est pas chez Stéphane Bern -, mais avec la même démesure qui caractérise l’homme et son mythe. C’est en tout cas le parti pris par le cinéaste : celui de laisser son film se faire contaminer par la folie des grandeurs de son personnage, jusqu’au baroque, jusqu’à ce que la caméra tremble sous l’impact des pas des éléphants, et que les images virent de couleur lorsque le rêve du roi s’effondre avec lui.
Aussi, le personnage est abordé par le biais de son ambivalence, de ses contradictions. Car, si son admiration pour le visionnaire transparaît de manière évidente, Oliver Stone traite avec autant d’égard du despote mégalo, du fou des dieux qui veut conquérir le monde, de l’ivrogne qui se prend pour le fils de Zeus-Amon. Et il en tire ses meilleures scènes, les plus contaminés par les délires alexandrins, les plus excessives, comme celle du meurtre presque fratricide de Cleithos : véritable tragédie grecque où la mise en scène déforme la réalité selon le regard paranoïaque d’un Colin Farrell hallucinant et halluciné. Le film dresse ainsi le portrait d’un personnage tout sauf unidimensionnel : un homme en conflit avec lui-même, dévoré par son ambition, écartelé entre ses rêves de gloire et ses démons intérieurs, et qui échappe finalement à notre compréhension. Et c’est justement dans cette façon de prendre en compte le caractère insaisissable de la personnalité d’Alexandre, en refusant de la réduire à un simple grand leader charismatique de plus comme on en voit tant par ailleurs, qu’Oliver Stone s’inscrit en brèche avec l’académisme (et notamment celui du très convenu Alexandre Le Grand de Robert Rossen). Là réside toute la spécificité d’un film qui, paradoxalement, transgresse l’histoire pour mieux la respecter.
**
Dans le dédale de l’histoire
**
En effet, dans une logique typiquement stonienne, le réalisateur dépeint l’incroyable parcours du conquérant en privilégiant une théorie tout à fait hypothétique. Mais dans le même mouvement, et selon une approche finalement très respectueuse de l’histoire, il tient compte des limites de celle-ci et les intègrent à son film. Ainsi, d’un côté Oliver Stone soulève des questions et fait des conjectures toutes personnelles, et de l’autre il reconnaît l’impossibilité qu’il y a à apporter des réponses définitives compte tenu des lacunes des sources historiques.
Le problème des sources est même le premier point soulevé par le film puisqu’il débute une quarantaine d’années après la mort d’Alexandre - entre-aperçue en ouverture - à Alexandrie où Ptolémée - derrière lequel se cache en fait Oliver Stone -, devenu premier pharaon de l’Égypte Lagide, entame le récit de la vie du conquérant dont il fut l’un des compagnons d’armes. Le récit du film est donc présenté comme une reconstitution forcément subjective et elliptique de la vie d’Alexandre (comment faire autrement ?). Car c’est le produit de la mémoire, des questionnements, des présomptions et des regrets d’un vieil homme faisant retour sur des évènements auxquels il a participé il y a de ça bien longtemps. Le point de vue par lequel le film est présenté n’est donc pas omniscient mais extérieur, et probablement déformé par le temps qui s’est écoulé entre les faits et leur récit. Le film procède ainsi - à la manière du générique de Game of Thrones - par une succession de zooms sur des moments spécifiquement choisis de la vie d’Alexandre que le réalisateur met en image en les agençant selon l’ordre qui lui convient. A ce titre le montage de la version Revisited se révèle effectivement bien mieux pensé que la version cinéma. Puisqu’à chaque épisode de la geste du macédonien vient répondre une scène - allongée donc enrichie - de son passé comme pour lui donner un sens, l’éclairer d’une meilleure compréhension.
Et Oliver Stone de se montrer tout aussi habile lorsqu’il s’agit d’aborder les questions laissées sans réponses. Par qui Philippe II, le père d’Alexandre, a-t-il réellement été tué ? Pausanias, son amant et meurtrier, a-t-il agit seul ? Ou était-ce un complot ourdis par les Perses - ce qui servirait bien la « propagande d’état » macédonienne ? Ou par Olympias ? Ou encore par Alexandre lui-même ? Et pourquoi Alexandre a-t-il épousé Roxane ? Par pur intérêt (une alliance stratégique) ? Pour servir sa cause (le brassage des peuples) ? Ou bien était-ce par amour véritable ? Et surtout, comment Alexandre est-il mort ? De maladie ? De ses excès ? Ou bien empoisonné ? Mais alors par qui ? L’un de ses généraux ? Les Perses ? Sa femme ?...
Autant de questions auxquelles Oliver Stone n’apporte pas de réponses tranchées, se contentant de faire coexister de multiples pistes et hypothèses dont aucune n’est plus que seulement probable. Le réalisateur laisse ainsi planer le doute en déployant des prodiges d’ambigüité. Et certains propos de Ptolémée se révèlent à double sens : « la vérité, c’est… que c’est nous qui l’avons tué » dit-t-il, avant de rajouter « par notre silence nous avons consenti, parce que… parce que nous étions à bout ». Mais le silence entre ces deux phrases permet au doute de s’immiscer. De même, lors de la dernière conversation entre Philippe et Alexandre, il est perceptible dans le jeu de Colin Farrell que le fils a conscience que c’est la dernière fois qu’il parle à son père. Peut-être parce que c’est lui qui a commandité le meurtre ? Ou alors parce qu’il soupçonne quelqu’un d’autre ? Il regarde en effet avec méfiance le futur assassin de son père derrière l’épaule de celui-ci. Et lorsque Philipe se retourne, le régicide a disparu, laissant apparaître Olympias, derrière, au milieu de la foule, et exactement au point de convergence de toutes les lignes de fuite de l’image, qui semblent alors la pointer du doigt. Le lien de cause à effet entre Olympias et le meurtre du roi est ainsi suggéré par le simple effacement du corps de l’assassin devant son potentiel commanditaire. Et Oliver Stone de procéder de la sorte à chaque fois qu’il aborde un point sujet à caution.
Mais s’il prend soin, pour toutes ses questions, de maintenir Alexandre dans le même nuage de poussière que celui recouvrant la bataille de Gaugamèles, il avance en revanche une seule et unique théorie pour expliquer son incroyable épopée. Charge au spectateur de lui accorder crédit ne serait-ce que le temps du film.
Le postulat du réalisateur est donc le suivant : l’odyssée d’Alexandre serait le produit de son déchirement entre deux figures parentales aussi écrasantes qu’antagonistes, et dont l’héritage aurait déterminé cette fulgurance digne d’Achille. En effet, lorsqu’Olympias lui raconte dans son enfance qu’il est le fils de Zeus, Philippe lui révèle quant à lui le sort funeste de tous ces héros punis par les dieux (Achille, Héraclès, Œdipe, Prométhée…). L’une le destine au plus grand des destins tandis que l’autre l’avertit du fardeau qu’est le pouvoir. L’une le traite en dieu vivant, l’autre lui rappelle le prix de l’hybris. Le film explique ainsi la dualité d’un homme écartelé entre un rêve qui le pousse toujours plus loin, représenté par cet aigle qui le guide, et la réalité bien concrète des guerres et des hommes, que lui enseigne son père dans cette caverne aux mythes. Cette caverne qui est aussi celle de Platon, et d’où une part d’Alexandre semble ne jamais être sortie, prisonnier de son rêve chimérique d’égaler les exploits d’Achille, et condamné à connaître le même sort tragique. Oliver Stone fait ainsi le portrait d’un visionnaire qui, à vouloir voir trop loin se sera aveuglé. Parce que les dieux nous punissent toujours par là où l’on faute. La course au mythe est donc décrite à la fois comme le moteur et le boulet d’Alexandre, ce qui le pousse vers les plus hauts sommets (le désir de surpasser Héraclès), et dans le même temps ce qui le détruit de l’intérieur, comme un poison que sa mère aura instillé en lui dès le plus jeune âge. Aussi, comme le fait remarquer Robert Hospyan (1), cet aigle qui suit Alexandre est peut être aussi un oiseau de « mauvais augure […] renvoyant à l’aigle qui dévora, jour après jour, le foie de Prométhée ». Et Ptolémée de résumer la chose ainsi : « de tout temps les hommes s’élèvent et retombent… s’élèvent et retombent… », de l’hybris à la némésis.
Ceci étant, au regard du contexte dans lequel le film est produit, il est aussi tentant d’y voir un discours sur les États-Unis et leur rapport au monde en ce début de XXIe siècle.
**
Alexandre, Pax Americana : même combat ?
**
Sans même parler du film en lui-même, les similarités entre l’épopée des macédoniens entre 333 et 323 av. J.C et les interventions américaines au Moyen-Orient après 2001 apparaissent de façon assez évidente. D’abord parce qu’elles se situent globalement dans la même région du monde - plus ou moins entre l’Irak et l’Afghanistan actuels -, et ensuite parce qu’elles connaissent des destins semblables, depuis les victoires fulgurantes des débuts jusqu’à l’essoufflement et les remises en cause qui suivirent. En outre, dans les deux cas, ce qui pousse pour un temps à aller de l’avant, c’est la traque d’un homme désigné comme l’ennemi absolu : le roi des rois Darius III pour les uns, l’ennemi public n°1 Ben Laden pour les autres. Pour autant, dire qu’Alexandre fait ouvertement référence aux interventions américaines en Afghanistan et en Irak peut paraître abusif. Car le réalisateur ne semble pas chercher à citer explicitement ou implicitement ces guerres ou leur contexte particulier, contrairement aux deux autres péplums le précédant et le suivant de prés : Troie, qui fait une relecture du récit de l’Iliade en y injectant quelques unes des caractéristiques propres à la seconde guerre du Golfe (notamment le faux prétexte à son déclenchement), et 300, qui joue à fond la carte du péril « moyen-orientalo-terroriste ». Alexandre, quant à lui, est probablement plus à placer dans la lignée de Voyage au bout de l’enfer, Rambo, Platoon, Né un 4 juillet et plus récemment American Sniper.
Dans tous ces films plus ou moins critiques par rapport aux guerres américaines, les inquiétudes des réalisateurs vont avant tout aux soldats partis à l’étranger pour « défendre - par l’attaque - la patrie et la liberté », et dont on a peur qu’ils n’en reviennent pas, ou alors traumatisés. En revanche, aucun des ces films ne s’intéresse aux victimes étrangères de l’impérialisme américain. Oliver Stone procède ici de la même façon. Dans son film, si la guerre est bien présentée comme une horreur insupportable, la distribution du rôle de victime semble n’être attribuée qu’aux conquérants. Ces conquérants dont le film adopte le point de vue, en prenant soin de ne jamais les dépeindre en envahisseurs, et en laissant aux perses est autres populations non grecques l’éternel rôle de l’Autre : celui de l’étranger mystérieux autrefois dévolu aux amérindiens. Aussi, des épisodes tels que les sièges de Tyr et Gaza, où Alexandre s’est comporté en chef de guerre impitoyable, perpétrant massacres, crucifixions, asservissements et autres joyeusetés, il n’est pas fait mention. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’aborder les aspects négatifs de la conquête alexandrine, le réalisateur se garde bien de mettre en image les épisodes qui risqueraient de remettre en cause son bien fondé. Il s’agirait plutôt de montrer la façon dont le souverain aimé par ses hommes se transforme bientôt en tyran à leurs yeux. De fait, ce sur quoi le film se focalise, c’est la tension entre le roi qui en veut trop et ses hommes qui n’en peuvent plus, le fossé croissant entre le rêve de conquête et la réalité des soldats.
Et l’on serait tenté de voir dans ce schéma la projection d’un débat bien américain : celui de l’attitude à adopter face au monde extérieur. En effet, cette tension qui, bientôt, coupe Alexandre de ses hommes, peut être vue comme un reflet du débat autour duquel s’articule la politique étrangère des États-Unis depuis le début du XXe siècle. Faut-il s’ingérer dans les affaires du monde, et - pourquoi pas ? - le conquérir pour lui apporter sa démocratie (et par la même occasion assurer ses intérêts économiques) ? Ou ne vaudrait-il mieux pas rester chez soi, et ne pas risquer de sacrifier ses boys dans des guerres inutiles et couteuses à l’autre bout du globe ? Mais alors, quid de la Destinée Manifeste ? Les américains ne doivent-ils pas suivre les indications de leur « grande prophétesse », leur pythie de Delphes à eux, celle qui leur a révélé leur « mission » vis-à-vis du monde ? Les États-Unis ne sont-ils pas cette cité sur la colline devant « éclairer » le monde. Quelle voie choisir ? Oliver Stone semble se poser cette question depuis des années. Une hésitation qui s’incarnait déjà dans le Ron Kovic de Né un 4 juillet, rejeton de l’air Kennedy qui payait chèrement sa croyance en la mission de phare du monde des États-Unis. Et le réalisateur semble ici toujours aussi indécis.
Car s’il montre un Alexandre qui s’autodétruit et inflige les pires souffrances à ses compagnons d’armes en pourchassant son rêve, il n’en demeure pas moins qu’Oliver Stone semble partager la mélancolie de Ptolémée pour ce même rêve. Et de fait, tel qu’il est décrit dans le film, ce dernier est tout à fait assimilable à la Destiné Manifeste. Pour preuve, dans une scène à Babylone, Alexandre et Héphaïstion parlent d’eux-mêmes en libérateurs et en civilisateurs, et des perses en tant que non-civilisés. Mais voilà, le discours apparaît moins simple par la suite. Lorsqu’Alexandre annonce à ses généraux son projet de mariage avec une « princesse barbare », il évoque ces mêmes peuples qu’il vient de soumettre non plus comme des peuples inférieurs et non-civilisés, mais avec beaucoup d’estime eu égard à leur ancienneté. Et en l’espace de quelque scènes, le film passe ainsi de Né un 4 juillet à Entre ciel et terre : du centrage sur le conquérant à l’ouverture à l’Autre. Alors que faut-il voir dans ce mouvement ? La seule évolution de la pensée d’Alexandre depuis les préceptes gréco-centrés d’Aristote jusqu’à son idéal de fusion des peuples et cultures grecques et asiatiques ? Ou bien s’agit-il aussi de l’ambigüité d’Oliver Stone, qui projette sur le projet alexandrin une croyance douteuse dans le bien fondé de la Destinée Manifeste en tant que moyen pour les États-Unis de s’ouvrir au monde ? Le discours, s’il existe, demeure opaque. Et ce ne sont pas ces paroles de Ptolémée qui l’éclairciront : « ils nous épuisent ces rêveurs…, qu’ils meurent donc avant de nous avoir tué, eux et leurs maudites chimères. »
Voilà donc un film qui, jusqu’au bout, soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Un film qui interroge le passé, avance des théories, et laisse le spectateur se perdre dans les méandres brumeux et incertains de l’histoire. Fallait-il en attendre moins de la part de l’auteur de JFK ? L’histoire n’est pas une science exacte, encore moins une somme de connaissances figées dans le marbre. C’est une éternelle enquête sur les traces à moitié effacées d’une vérité qui se dérobe. Oliver Stone l’a bien compris, c’est ce qui fait toute la valeur de son Alexandre, film stonien pur jus derrière lequel se devine encore une fois la figure de son auteur, passionné et excessif. Et si la fortune du box office n’a cette fois pas souri au cinéaste, ce n’est pourtant pas faute d’avoir manqué d’audace. Tant pis pour Virgile…
Sources : (1) critiques de Robert Hospyan (http://www.filmdeculte.com/cinema/film/Alexandre-994.html) et Xavier Collet (http://www.critikat.com/dvd-livres/dvd/alexandre.html).