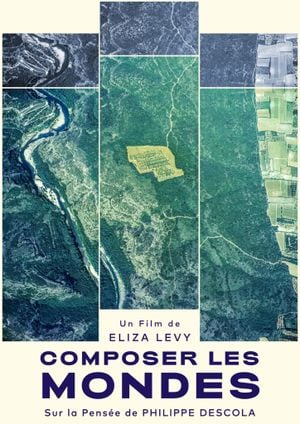Que se passe t-il dès que l’on pense le mot nature ?
Un espèce de tout, assez informe, vient d’être englobée, annihilant toute distinction, tout contact avec le nombre infini d’entité se cachant dorénavant derrière. La conceptualisation de ce mot, propre à notre société occidentale, serait à l’origine de la véritable rupture de l’homme moderne vis à vis de son environnement.
C’est en tout cas ce qu’affirme dans ce documentaire et en guise d’introduction, Philippe Descola, anthropologue, après avoir observé et comparé cette manière unique et proprement occidentale de se représenter le monde.
Avec ce regard, s’affirme l’idée que nos villes, donc nos lieux de vie, sont ou tendent insidieusement à être aseptisées de toutes interactions avec l’existant. De fait, les quelques vestiges d’êtres vivants primitifs sont parqués et méticuleusement sélectionnés : ils font désormais offices de simples décors, évoluant en vase clos, lui même contenu dans notre propre prison bien cimenté.
Ce sera par l’image et par le son qu’Eliza Levy, réalisatrice de « composer les mondes » tentera de raviver les connexions, en jouant avec nos souvenirs. Bien loin des somptueux espaces grandeur nature habituellement invoqués, c’est par la petite fenêtre, à l’échelle du regard qu’elle cherche simplement à nous saisir, à nous remémorer l’indicible : au détour d’un ruisseau bourdonnant, du frémissement des arbres transpercés par des rayons déclinants, de la rencontre extatique avec l’animal sauvage, du curieux regard placide, presque innocent, de quelques ruminants et de la complicité indicible, grégaire, des éleveurs avec leur bêtes. Toute cette multitude de contacts que l’on a perdus et qui enrichissait notre quotidien.
Mais le constat amer de cette séparation, n’est pas seulement d’ordre esthétique, idéologique, il a une application réelle : celle de ne plus mesurer ce qu’implique une interaction vraie avec le milieu ambiant. En découle soit une réticence, une peur, à l’idée de devoir évoluer hors de nos conditions in vitro, soit une méconnaissance et donc une mésestimation de ce qu’implique une juste interaction avec cet ordre qui nous est devenu étranger. Car au delà de notre bien être direct, la conséquence principale est la dégradation progressive de ce dernier face à l’indifférence délétère de nos habitudes sociétales.
Ici, le documentaire d’Eliza Levy choisit judicieusement de nous montrer sous un nouvel angle (autre que celui asséné par les chaines d’infos durant cette période) l’expérience ZADiste de Notre Dame des Landes. On y découvre l’origine et les motivations profondes de ce combat acharné, terreaux fertile pour tenter finalement de composer dans et avec ce monde. Dans un juste équilibre.
Car renouer avec cet ordre, ce n’est pas renouer avec cette nature constituant le dehors, que l’on effleure timidement lors d’un week end à l’arraché. Cette nouvelle interaction se fera avec son lot de complicité, d’entente et de partage, mais aussi de désaccords et d’adversité. Sa réalisation nécessitera un autre langage et donc une autre intelligence, si tant est que l’on veuille bien se résoudre à sortir consciemment du mythe de la productivité et bien reconsidérer la pauvreté de notre mode de vie hors sol ou a défaut, constater la dégradation croissante de ce qui constitue notre lieu de vie par nos actes inconsidérés.
PS : En rajout annexe, après une lecture tardive du livre "Raviver les braises du vivant" de Baptiste Morizot, quelques passages éloquents qui viennent étayer et surtout enchérir le propos de cette critique : "Ce ne sont pas les humains en général qui sont en cause, mais la dérive d’une forme économique et politique tardive, d’un métabolisme social ravageur, d’un rapport au monde particulier, qui s’est érigé en norme et en Progrès : quelque chose comme un extractivisme productiviste financiarisé, élargissant les logiques marchandes à tout ce qui devrait en être exclu, et incapable de toute sobriété.(...) Il ne s’agit pas de défendre le vivant parce qu’il est utile pour nous en services quantifiables, ni parce qu’il est vulnérable et appelle notre compassion (...) cela révèle une ignorance que l’on prétend chérir (...) ; mais pour ses puissances mêmes, ces puissances qui nous ont façonnés, tissés à toutes les autres formes de vie, et qui nous perfusent de vie chaque jour encore. Le vivant est notre milieu donateur, il est les instruments qui nous sculptent, nous nourrissent, nous maltraite, nous font jubiler, il fourmille de puissance avec qui négocier : il n’est pas un bébé phoque violenté sur internet, dont la figure active les instinct néoténiques d’attendrissement et d’apitoiement.