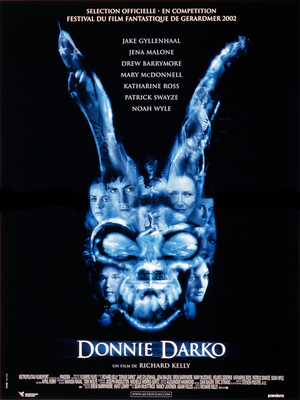Une route en lacets surplombant la ville, un corps inerte, un habillage sonore discrètement anxiogène : si l’on n’avait vérifié la chronologie des sorties, on aurait pu penser à une citation de Mulholland Drive, qui sort deux semaines auparavant aux États-Unis.
De fait, le premier long métrage de Richard Kelly va se superposer sur deux genres, deux atmosphères complémentaires : le film fantastique et le high school movie. Du second, il emprunte le portrait traditionnel d’une tranche d’âge, souvent ingrate, celle de la cellule familiale et des émotions vives propres à cette période de transition. Lyrique, au gré de séquences clipesques (ralentis, accélérés, plans obliques) et sous le joug d’une BO imparable (au premier rang de laquelle figure la splendeur The Killing Moon d’Echo & the Bunnymen) le récit nous plonge avec conviction dans les élans adolescents, comme le faisait Virgin Suicides de Sofia Coppola.
Sans se cantonner aux plus jeunes, Kelly prend soin de croquer l’ensemble d’une communauté, souvent sous l’angle de la satire : une Amérique puritaine qui voudrait interdire certains livres, obsédée par l’apparence et la compétition, notamment par l’organisation du spectacle juvénile. Les adultes se scindent en deux groupes : les fanatiques, morbides et gourous en puissance (la prof de gym et le télévangéliste qui se révélera pédophile) et les indécis, : les parents de Donnie, plutôt tolérants, et ce couple d’enseignants qui semblent avoir l’âge de leurs élèves et se soumettre malgré eux à l’institution. L’une est éjectée pour le programme littéraire qu’elle propose, l’autre choisit de se taire quant aux théories pas très catholiques sur le voyage dans le temps.
Au sein de ce carcan, doublé de la violence traditionnelle des rackets et des humiliations, Donnie est l’électron libre, celui qui vandalise et qui fait bouger les lignes. Mais, et c’est là l’un des intérêts du récit, son attitude iconoclaste ne lui appartient pas. « They made me do it », écrit-il sous l’un de ses forfaits, pantin de force étranges qui vont faire dévier, dans tous les sens du terme, la trajectoire des événements.
Kelly met ici en place un univers qu’il ne quittera pas, de la folie de Southland Tales à la fable The Box : un mélange de fantastique de lyrisme, quelques accrocs à une explication finale, notamment due aux voyages dans le temps.
Il faut reconnaitre que dans cette convergence vers une fin du monde annoncée (une véritable obsession chez Kelly, présente dans tous ses films), les questions sont bien souvent plus savoureuses que la résolution ; la schizophrénie de Donnie, les apparitions de la créature mettent en place un univers proche de Twin Peaks, tandis que les correspondances avec la scène attendue appauvrissent un peu le propos.
Mais la situation finale, sacrifice permettant à la fille aimée de vivre au prix de l’annulation de leur amour, parvient à atteindre la tragédie ambitionnée.
Sur cette impasse, où seul le spectateur sait ce qui est perdu, on retrouve l’émotion nostalgique du dénouement d’Eternal Sunshine of the Spotless mind. Un mélange de fulgurances, de marques oniriques mêlant l’effroi à l’épiphanie : ce qui nous reste, en somme, de l’adolescence.
Analyses, contexte de création et commentaires d'extrait dans la vidéo du Ciné-Club :
https://youtu.be/EMXbvbfsnc4?si=nAwwDmwX9knPnwyc