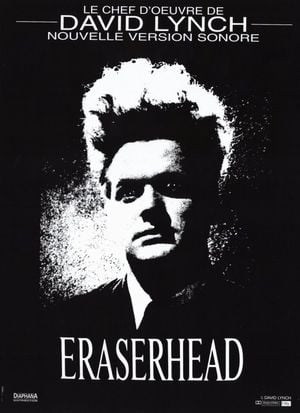Véritable balade onirique dans le macabre, le méticuleux Eraserhead se veut mystique, impalpable, presque douloureux. Le « soleil noir » de Lynch irradie maladivement, gratte le nerf optique et fait grincer la langue jusqu’au mutisme gêné. Le premier long format du réalisateur est sans aucun doute une porte ouverte à l’indicible, au « voyage au centre de la tête », ce que titrait il y a trente ans le Canard Enchainé.
En 1973, Emil Michel Cioran envoyait avec brio « Avoir commis tous les crimes, hormis celui d’être père » dans De l’inconvénient d’être né. Quelques années plus tard, David Lynch prenait le relais et personnifiait littéralement le principe en images. Ode à la terreur paternelle, à l’ostracisme et l’enfermement, Eraserhead n’est ni plus ni moins que la représentation de l’incarcération du père par l’enfant monstrueux.
Eraserhead, dans une beauté épouvantable, est cathartique, conflictuel. Henry, à la fois juge et bourreau, en donnant vie se donne pire que la mort : il s’envoie de lui-même en cellule, ici une chambre miteuse à la fenêtre emmurée et au radiateur comme des barreaux. Hymne poétique à la séparation et la fracture, Lynch coupe des photos en deux, paralyse son protagoniste au centre de femmes hystériques, le presse dans un univers insécure jusqu’à la décapitation. Dissocié de son identité, soustrait à la seule condition de père, le réalisateur désarticule, assassine doucement avec une rigueur chirurgical le grand timide à la chevelure abondante.
Imprégnée de la réflexion freudienne, l’oeuvre, pire qu’un ouvrage de psychanalyse, transpire l’Oedipe et le seul désir de tuer le père dans un malaise sans fin. Incursion cisaillante dans ce climat étouffant dont Lynch à le secret, Eraserhead dégorge d’une symbolique criarde, calculée à son paroxysme. Ayant pour parti-pris de dépeindre l’irréel, la logique réalisationelle se veut efficace, dans une agression douce et passionnée. Le sol devient une flaque de boue dans laquelle on s’enfonce comme dans un sable mouvant, les murs menacent, les femmes sont pithiatiques, les bourdonnements sourds deviennent les voix chuchotantes et poisseuses du cauchemar. Le bébé, dont nous ne saurons jamais par quel miracle ou malheur existe, devient alors à la fois le maitre de cérémonie et le roi d’un univers indécent, cruel, usant de ses pleurs comme d’un sceptre et de son apparence terrifiante comme d’un poignard brûlant. Le noir et blanc devient la combinaison saillante et humiliante d’un prisonnier, une poudre acide et corrosive déconstruisant une réalité sans nuances, manichéenne. Croulant sous le culte de l’extrême et de la binarité, Henry n’a que deux choix : tuer ou être tué.
Métaphorique, glaçant, le film se transforme en une séance d’hypnose dont les bruits sourds deviennent les tictacs inquiétants d’un sommeil dont on craint de s’enfoncer trop profondément, jusqu’à la folie, au sans retour. C’est un tunnel noir et exiguë dans lequel la lumière blanche se mute en pétrole laiteux, prêt à nous ensevelir jusqu’à l’étourdissement, la panique puis la syncope. En effet, c’est lorsque les crédits arrivent enfin, héros libérateurs, que l’on peut aisément affirmer qu’Eraserhead pèse lourd sur notre dos comme ce rocher bouillant sur celui d’Henry Spencer ou de Sisyphe, dans une boucle sans fin et la continuité naturelle de The Amputee.
Valentin Rapilly.