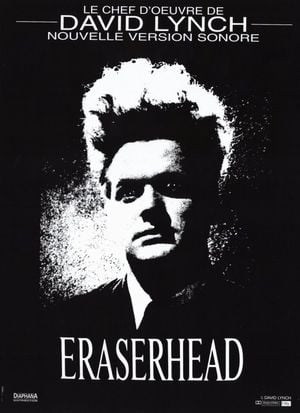Eraserhead n'existe pas pour te faire du bien, n'est jamais là pour te caresser dans le sens du poil, ne te mène que peu ou prou au fond de son épineuse réflexion glissée dans les méandres d'une forme granuleuse, étrange et archaïque. Eraserhead est de ces œuvres d'art qu'on contemple bouche bée, les bras tombants et le palpitant à tout rompre. Ça passe ou ça casse, tu trépasses, tu te brises contre la pellicule de la réalité ou tu joues la défensive, tu choisis la survie et tu hais...profondément. Lynch accouche d'un morveux, d'une créature d'une sublime horreur. À toi d'y voir ce que tes yeux et ton encéphale auront choisi de croire...
Henry est un imprimeur en vacances, disponible physiquement, occupé psychiquement par la somme de tous ses délires. Enfermé dans ces derniers...nous sommes, il est, il restera. La faible clarté dans l'ombre épaisse est une conquête le présentant à ses géniteurs, une bonne façon de prendre Henry au piège d'une paternalité qu'il ne peut reconnaître tant l'être potentiel de leur potentielle union s'avère être l'être le moins être des êtres. Un substrat de vie qu'il est, une horreur sans nom, sans mots qui vient plonger le héros dans un rôle impossible à assumer seul. Notre histoire suivra le basculement d'un monde : une décompensation brutale, sèche et terrifiante.
J'ai chaud, je suis vidé, la séance restaurée dans ce cinéma de quartier m'a détruit et laisse mes pensées s'échapper en un milliard de petits morceaux.
Eraserhead, le film le plus expérimental de David Lynch est également l'un de ses plus formidables. Il enfourne sa patte d'expert de cinéaste à l'angoisse grinçante et nous livre le cauchemar d'une dévorante psychose. Entre l'ombre d'un noir profond et un sublime gris en teintes marquées, notre vision violée de sombre s'augmente d'une atmosphère éthérée, explosive comme un champignon nucléaire, de sonorités crispantes à te ravir le dernier de tes souffles et te paralyser face au spectre de la mort.
Kubrick a dit avoir fait regarder ce film à ses acteurs avant de jouer dans Shining, une bonne façon selon lui de s'imprégner du climat horrifique. A voir le résultat, on ne peut que coller à cette vision de la folie que choisit d'exprimer le maître en reprenant bien une goutte de l'essence poétique d'un Lynch enfiévré par sa libre pensée.
Et à pensée libre, artistique dirons-nous car il s'agit de cela dans le postulat de chaque film entendant apporter autre chose qu'un fond et une forme, il y a interprétation multiple. Tâchons d'en exprimer une quitte à ce qu'elle se confronte/s'oppose aux réflexions d'autrui, qu'importe.
Tout se jouerait à mon sens à des niveaux toujours plus chauds d'un délire à tendance schizophrénique, l'appartement d'Henry symbolisant un monde interne décrépis, austère, secoué de visions d'un paradis perdu (la danseuse aux bajoues comme une American Beauty dégradée) où ne résonne seulement que les cris de l'enfant monstrueux. Ce dernier incarnerait le mauvais objet interne, la pensée néfaste, le symptôme visible, celui qui hurle, suinte, dégueule et prend aux tripes. Il est le fruit d'un amour sans pulsions, une descendance qui fait presque un avec Henry, quitte à le remplacer et grimper sur ses épaules. La voisine, elle, est cette pulsion oubliée, elle est cette volupté féminine au regard enfiévrant. Elle est l'objet du désir, à la fois sombre et sur qui tout l'être tend à se couler, s'enfoncer quitte à être englouti.
Il ne m'a pas paru insensé une fois le film terminé et le difficile retour à la réalité effectué d'entendre que l'ami Lynch ne devait certainement pas être dans la méconnaissance des théories psychanalytiques tant il a su représenter avec brio l'inconscient d'un sujet en pleine décompensation psychotique : un moi se déliant du monde extérieur. Si dans les premiers temps, Henry est montré comme un sujet du quotidien, vacant entre la maison, les routes et son amourette, peu à peu il est contraint de rompre avec le monde externe, pris par l'interne et les piaillements de son enfant-symptôme. Ne trouvant guère de solutions pour tenir au peu de réalité qui lui reste, Henry est dévoré, gommé par la pensée interne. C'est la mort du réel, l'achèvement du film.
S'il s'avère être une véritable épreuve de visionnage, Eraserhead saura plonger le spectateur investi dans sa toile pour ne l'y lâcher que difficilement, les ridules de l'étrange continuant de faire écho, de marquer dans l'après coup. Âmes sensibles s'abstenir.