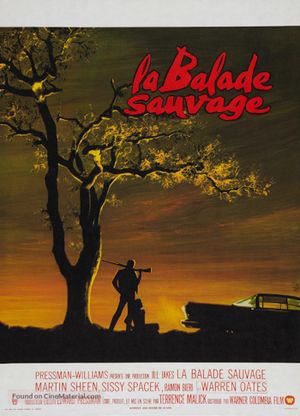Alors que le film approche de ses cinquante ans, Badlands reste d'une incroyable modernité encore actuellement. Une modernité qui se retrouve dans le jeu sur les points de vue ou la façon qu'a Terrence Malick de contourner les genres pour créer une œuvre inclassable et unique.
Et pourtant, a priori, nous sommes en terrain connu : la cavale du couple infernal. Cinq ans après le légendaire Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, on voit très bien dans quoi on s'engage (et ce d'autant plus que, a la fin du générique, Malick adresse ses remerciements à Penn). Donc, road movie, crimes, histoire d'amour et jeunesse incandescente. Et, avec tout cela, une volonté d'aller constamment à l'encontre de toute idée reçue. Comme Kit, son personnage principal, le film reste impénétrable, imprévisible et, de ce fait, déroutant. Et terriblement attachant.
Qui c'est, ce Kit ? L'une des grandes réussites du film, c'est justement de nous laisser à l'extérieur de ce personnage. Racontée par Holly bien après les événements, l'histoire porte constamment la marque de la subjectivité de sa narratrice. Du coup, les autres personnages nous sont forcément étrangers, nous ne pouvons les voir que de l'extérieur. Et c'est flagrant avec Kit, qui reste un mystère, et rien que cela est déjà très novateur. On peut juste faire quelques suppositions, découlant de son comportement et de ses propos.
Kit est ce qu'il conviendrait d'appeler « un gosse en perte de repères ». Que sait-on de sa famille ? D'éventuels parents ? Kit ne semble rien avoir qui le relie à la société (pas même de logement). C'est un personnage totalement dévalorisé qui cherche « un peu d'air » et semble inadapté à tout, en décalage. Pour se donner un peu de valeur, il va plonger dans le cinéma, les représentations qu'il se fait de la virilité : James Dean, peut-être John Wayne. Mais en réalité, s'il ressemble à un personnage de fiction, ce serait sans doute Holden Caulfield, le protagoniste du formidable roman de Salinger Catcher in the rye. Sauf que Caulfield avait une famille chez qui revenir, une famille avec une bonne situation sociale. Kit, lui, semble ne pouvoir se rattacher à rien.
Du coup, peut-on s'étonner qu'il développe une conception, on va dire : « personnelle » de la vie sociale ? Lorsqu'il propose à un collègue de manger du cadavre d'un chien, il n'a pas l'air de plaisanter. Lorsqu'il tue, il ne semble pas ressentir de remords. Comme si la morale était atrophiée.
Il faut dire que la mort est partout autour de lui. Dès les premières scènes, elle est présente dans cette petite ville délabrée, entre les cadavres d'animaux dans les rues, les maisons en ruines, les terrains vagues pourris et les panneaux qui finissent de rouiller dans le jardin du père de Holly. Le monde dans lequel se déroule l'histoire est un monde violent. Une violence sociale pour ce gosse livré à lui-même. Violence du père qui tue le chien pour punir Holly.
Là où le personnage est vraiment déroutant, c'est que, bien qu'on le voie tuer froidement à plusieurs reprise, bien que l'on connaisse sa dangerosité (d'autant plus importante qu'on n'est pas sûr qu'il en prenne conscience lui-même), on ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie à son égard. Il y a en Kit quelque chose qui relève du gamin paumé. Le spectateur va ainsi être confronté à une impossibilité de juger qui est, d'emblée, déstabilisante : nous ne pouvons ni rejeter le personnage, ni adhérer à lui.
Les images du film semblent conserver une attitude de neutralité par rapport à ce qui est montré. Du coup, si les mots que l'on entend raconter l'histoire sont ceux de Holly, je me suis dit, parfois, que les images, ces images paisibles refusant de sombrer dans le pathos ou le spectaculaire, ces images distanciées, paraissent être celles de la nature elle-même. Une nature qui ne s'intéresse que peu aux affaires humaines, une nature pour qui les questions de morale n'existent pas (la morale est une invention humain), une nature qui se contrefiche des destinées humaines. La nature prendra d'ailleurs un part de plus en plus importante au fil du film, depuis la nature viciée par l'humain au début jusqu'à la nature libre et vierge à la fin. Une nature qui n'est pourtant jamais totalement libérée de l'humain : les chasseurs de primes qui surgissent des hautes herbes, des poteau qui délimitent les champs et des routes qui traversent les grandes plaines. Une route que, bizarrement, Kit ne quittera pas, lui qui pourtant professait de sortir des sentiers battus...
Ce côté déstabilisant va se diffuser à tout le film. Bien malin celui qui peut classer un tel film. Badlands lorgne du côté du western (Kit qui se fait cowboy, les grands espaces, etc.), du polar, du road movie... Et ce, toujours en se tenant à distance de chacun de ces genres.
Il y a surtout un aspect désabusé qui pointe son nez derrière tout cela. Il est possible de voir la critique d'une Amérique telle qu'elle se présente dans les œuvres d'art, et qui ne correspond pas à la réalité. Une faillite de la représentation de l'Amérique. Les cowboys, ça n'a rien à voir avec John Wayne. Et vivre au sein de la nature, dans la réalité, ça ne se déroule pas comme chez Tom Sawyer. Et même l'amour est désabusé, comme blasé. L'amour physique est expédié d'un revers de main.
Il reste donc ce couple. L'amour et le respect mutuels forment comme une bulle qui coupe ces personnages du reste du monde. Sauf que...
Sauf que tout cela est raconté longtemps après coup, une fois la fièvre retombée, par une femme mature (et non plus une ado rêveuse) qui sait comment tout cela s'est terminé. Cela contribue encore plus à cet aspect de désenchantement, à cette impossibilité d'adhérer à ce projet de vie loin du monde, et finalement à ce couple voué à l'échec. Connaître la fin dès le début ne confère même pas la moindre impression de tragédie. Juste d'inanité, de vacuité de ce qui se déroule. Une histoire qui ne mène nulle part. Un symbole d'une cruelle absurdité dans laquelle se démènent deux pauvres personnages.
[8,5]