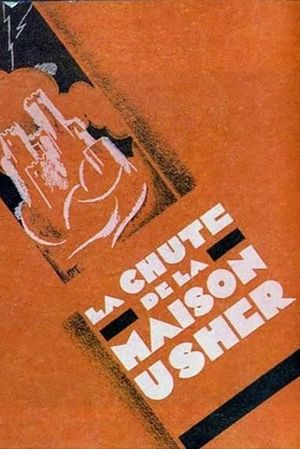Fier représentant de l’avant-garde française des années 20, Epstein est un novateur qui fait feu de tout bois, commençant par théoriser sur les mérites propres au cinéma avant de s’y essayer, que ce soit dans le documentaire ou la fiction. Adapter Poe est pour lui l’occasion rêvée de prouver que cet art nouveau est le vecteur d’une poésie propre : la nouvelle, par son atmosphère unique et les thématiques qu’elle aborde (l’art, la vibration de lieux insolites, la mort et l’inspiration), sera le terreau idéal pour mettre en forme un langage aussi muet qu’expressif.
Le fantastique et le cinéma primitif font décidemment bon ménage : alors que les expressionnistes se ravissent des mythes (Murnau et Faust ou Nosferatu, Lang et les Nibelungen, Wiene et Caligari), et juste avant que Dreyer ne s’y essaie lui-même (Vampyr, en 32), Epstein permet à la France et son courant impressionniste d’apporter sa pierre à l’édifice, et le moins qu’on puisse dire est qu’elle sera fondatrice. Le cinéaste sait exploiter chaque élément à sa disposition pour installer son ambiance, dans ce qui relève aujourd’hui du topos, mais est alors à inventer : les forêts profondes, la brume sur les marais et la maison de pierre sont ainsi dotées d’une force évocatrice remarquable, avant même que le récit ne prenne son essor.
Mais c’est surtout dans les intérieurs que le registre fantastique trouvera sa pleine puissance. Par leur démesure, ils réduisent les personnages à de frêles silhouettes en proie à des forces invisibles. Pour doter la maison d’une existence propre, Epstein a l’idée géniale de recouvrir la plupart des murs de tentures, instaurant une porosité, une épaisseur qui se meut au gré de courants d’air qui semblent figurer une respiration. On voit s’instaurer ici de multiples idées qui infuseront dans toutes les expériences visuelles à venir, de la surdimension chez Welles dans Citizen Kane à la loge du Twin Peaks de David Lynch, et jusqu’au langage du film d’épouvante impliquant des visions subjectives, comme le cadre au sol suivant un souffle balayant les feuilles mortes, les gros plans sur les visages, voire des caméras embarquées suivant une femme portée ou le visage en proie à la démence d’un protagoniste.
Mais la peur n’est de loin pas le motif unique du récit, et c’est la raison pour laquelle le film parvient à atteindre une vibration plus fascinante encore. Epstein accorde une place prépondérante aux gestes et à l’action concrète, qui se distille en deux temps : la peinture, tout d’abord, qui donne en vigueur à la toile ce que le modèle perd en vie, et l’enterrement, par cette obsession à montrer les clous entrer dans le cercueil de celle qui, selon l’artiste, est restée vivante du fait même qu’elle a pris les proportions d’une œuvre d’art. Le jeu des surimpressions (les bougies, par exemple, qui accompagnent le cortège funéraire à l’extérieur), des gros plans (le bestiaire des hiboux ou crapauds) rendent chaque séquence épaisse d’une autre réalité, dans une gradation qui va mêler la destruction et l’apogée de ces cohabitations surnaturelles. Le feu, la fumée, et les visions presque fantaisistes de la demeure réduite à une maquette devant une voute céleste ponctuée d’étoiles peintes portent à leur paroxysme la poésie cinématographique imaginée par le réalisateur.
Habile position que celle de son surplomb : au-dessus du créateur fou, il aura su orchestrer la splendide tempête des éléments, des matières et des sens qu’est cette création par le chaos.
(8.5/10)