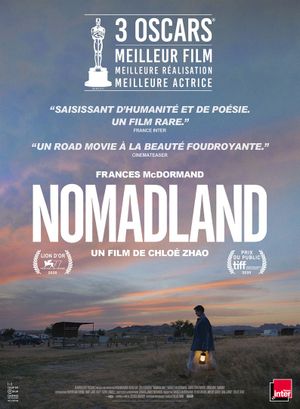Alors que Chloé Zhao s’attachait jusqu’ici à des communautés plutôt circonscrites pour évoquer l’identité ou la précarité, son nouveau film prend une ampleur à l’échelle nationale : la femme incarnée par Frances McDormand, icone cinégénique de la normalité américaine, fait ici non seulement le deuil de son mari et de son emploi, mais d’une ville entière rayée de la carte pour motif économique. En réponse à la désormais lointaine conquête de l’Ouest se dessine désormais un effacement du territoire, faisant fi des populations au profit de fortunes immatérielles que symbolise parfaitement l’entrepôt d’Amazon pour lequel elle travaille lors des pics de consommation de fin d’année.
Nomadland suit donc un itinéraire dans lequel le délestage a été contraint : une vie sur la route, dans un van, où la solitude prime, et l’individu renonce à envisager une reconstruction. Une sorte de présent continuel qui rappelle un peu celui de Mona dans Sans toit ni loi de Varda, avec cet air revêche qui refuse de retrouver ce que les autres considèrent comme la normalité (une chambre, un lit, une famille), mâtiné d’une version vermeille d’Into the Wild dans une odyssée qui va traverser différents états, des Badlands aux forêts de Sequoia géants dans un best of un peu trop National Geographic par moments.
Chloé Zhao ne perd pas pour autant de vue son point de vue : rester à hauteur de visage, coller à l’expérience des individus rencontrés, dans une perspective très documentaire. Faces burinées de l’Amérique populaire, qui racontent leur vie en commentant leurs tatouages ou au coin du feu d’un camp de vans, c’est la réunion des prolétaires anonymes qui s’épaulent un temps et inventent, à la marge, un maillage social qui n’a jamais existé pour eux. Nul misérabilisme ou discours idéologique ne vient empeser cette galerie de portraits : à la manière de sa protagoniste qui ne fait que passer, mais sait écouter et donner la parole, la cinéaste fait exister ses personnages et donne un pâle coup de projecteur sur ceux qui restent traditionnellement dans l’ombre. Une communauté qui existe réellement en Amérique, et dont un grand nombre de d’individus jouent ici leur propre rôle. La musique, au départ absente, s’invite progressivement au voyage, et ménage quelques belles séquences très photographiques sur les différents jobs alimentaires auxquels s’adonne Fern.
La sècheresse du personnage enrichit tout ce qui pouvait conduire à un simple brûlot social victimaire. Tour à tour asociale (pour sa sœur, qui lui dit qu’elle aurait aimé pouvoir compter sur elle, pour un compagnon de route qui n’arrive pas à la sédentariser), accompagnante d’une voisine en phase terminale aussi coriace qu’elle, elle peut aussi, au détour d’une conversation, prendre la posture de la mère lorsqu’elle croise un sans-abri qui pourrait être son fils, et s’enquiert de l’inquiétude de ses parents.
Fidèle à son traitement, Zhao ne s’embourbe pas dans une démonstration qui viserait à faire proprement évoluer le récit ou les protagonistes. Si la closure advient tout de même par un retour à la maison vide et un adieu fait aux reliques du passé, l’horizon vide de l’autre côté de la frêle barrière du jardin abandonné n’annonce pas forcément des jours meilleurs. La femme qui le contemple sait néanmoins que le traverser ne sera plus une fuite, mais l’exercice de sa liberté.
(6.5/10)