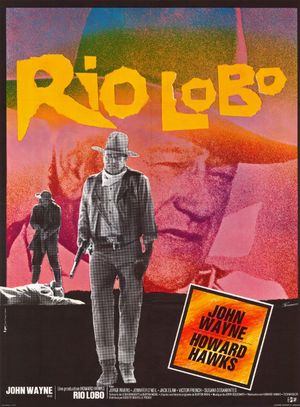Dernier volet d’une trilogie mettant en scène John Wayne, Rio Lobo en constitue certainement le plus méconnu et le moins apprécié, à tort. Le film cultive l’ellipse de sorte à embrasser une époque peu représentée dans le cinéma américain, ce moment de transition entre la fin de la guerre de Sécession et le retour des soldats sur leur terre respective après plusieurs années de séparation. Le motif du retour mute ici en quête de vengeance, que le cinéaste démultiplie avec intelligence : la première est celle du colonel Cord McNally suite au décès de son ami ; la deuxième devient celle d’une femme, Shasta Delaney, dont l’employeur a été abattu sans autre forme de procès ; la troisième est également féminine et implique Amelita, défigurée pour ne pas avoir collaboré avec l’ennemi.
Dit autrement, ces trois personnages, unis par une trajectoire similaire, dessinent une boucle partant de la trahison pour y revenir en passant par l’abus de pouvoir. Howard Hawks oppose à ces deux vices un sens vif de la camaraderie perçue comme la formation d’une famille recomposée à partir d’antagonismes : Nordistes et Sudistes se lient d’amitié, hommes et femmes s’associent, le Mexique et la France s’incarnent en Pierre Cordona. Le métissage a toujours occupé une place centrale dans l’œuvre du cinéaste américain, empruntant aussi bien aux individus qu’aux animaux leur offrant une métaphore – pensons par exemple à Bringing up Baby (1938) ou à Hatari ! (1962). La mise en scène virtuose immortalise chacune des séquences d’action, mention spéciale à l’attaque du train, se révèle aussi muable que les personnages qu’elle figure ; surtout, il y a là, une fois encore, une attention portée à la répartie et aux bons mots vectrice d’une authenticité humaine rare dans le genre du western. Une œuvre superbe, portée par la partition tout aussi hybride de Jerry Goldsmith.