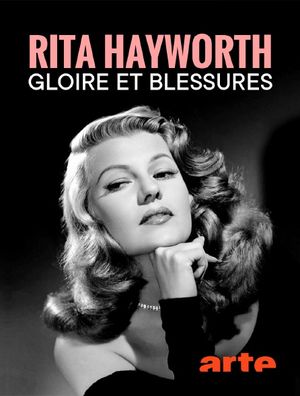« Les hommes que j’ai connus sont tombés amoureux de Gilda mais se sont réveillés avec moi.»
Un propos qui, s’il relève en grande partie de la boutade, révèle néanmoins chez Rita Hayworth, une lucidité rafraîchissante et un sens certain de l’auto-dérision.
À aucun moment en effet, y compris au faîte de sa gloire, l’actrice ne s’illusionna sur son réel pouvoir de séduction : celui qui ne devait rien au maquillage, à la coiffure, aux tenues vaporeuses et suggestives, bref, à tout cet art consommé de l’érotisme au cinéma, dont elle n’était pas dupe.
Sans doute est-ce aussi l’une des raisons qui m’a fait m’intéresser plus avant à la star flamboyante que je découvrais dans des films mythiques, où, pulpeuse séductrice aux courbes parfaites, elle évoluait avec une grâce souveraine au côté de Fred Astaire ou de Gene Kelly, ses partenaires privilégiés dans L’Amour vient en dansant ou La reine de Broadway.
Vamp, elle l’était jusqu’au bout des ongles, mais avec quelle classe !
Il faut avoir vu Gilda, moulée dans un fourreau de satin, retirer langoureusement ses longs gants noirs, chantant, enjôleuse et féline, Put the blame on Mame !
Une scène entrée au panthéon du cinéma où l’érotisme suggéré de ce strip tease allusif atteint des sommets de sensualité à une époque où le code Hays faisait sa loi dans les films d’amour hollywoodiens.
Sorti en 1947, Gilda vaudra à son actrice d’être sacrée Déesse de l’Amour par les GI américains, qui, galvanisés par la splendide rousse, n’avaient pas hésité, en pleine guerre contre les Nazis, à placarder l’image de la belle sur les calandres des camions militaires, les cockpits des avions de chasse, sans parler des photos, amoureusement rangées dans leurs portefeuilles, d’une bombe aux formes de rêve , prototype de l’idéal de beauté américain.
Qui aurait pu reconnaître, alors, dans cette créature divine, au sourire radieux et à l’opulente chevelure de feu cascadant en boucles fauves sur ses épaules, la jeune Margarita Carmen Cansino dont le front, jugé un peu trop bas, les cheveux un peu trop bruns et le visage un peu trop rond, attestaient de façon indubitable l’ascendance espagnole…
Hollywood allait gommer sans états d’âme ces « défauts », transformant la jeune femme timide et complexée par son manque d’éducation, en un sex symbol américain des années 1940, mais à quel prix !
« Les hommes m’ont toujours manipulée » ne peut que constater Rita avec amertume, des hommes en effet, qui, ayant décelé tout son potentiel, n’auront de cesse de l’exploiter pour leur profit personnel.
Son père tout d’abord : danseur mondain d’origine sévillane, il la retire de l’école, faisant de la fillette de 12 ans, extraordinairement douée pour la danse, sa partenaire attitrée sur scène, avant de la mettre dans son lit.
Alors, en désespoir de cause et à seule fin d’échapper à son géniteur incestueux, la jeune femme de 19 ans convole avec un soi-disant « homme d’affaires » : Ed Judson spécialiste de transactions louches et d’arnaques juteuses, qui voit en sa jeune épouse son laissez-passer pour Hollywood, l’incitant à « coucher pour réussir ».
Et c’est Harry Cohn, puissant magnat, de la Columbia, qui la prend en mains, mais ulcéré de se voir repoussé , il lui mènera la vie dure sur les plateaux, ne pardonnant jamais à l’actrice, bien que dépendante de lui, d’avoir osé refuser ses avances.
Margarita passe au « calibreur à beauté », instrument démoniaque qui permet de calculer puis de corriger la symétrie du visage des actrices, molaires arrachées pour creuser l’ovale, (Marlene Dietrich y aura également recours), implantation des cheveux redessinée à l’électrolyse-« il faut souffrir pour être belle » prend alors tout son sens-
une torture à la limite du supportable : Margarita Carmen Cansino a fait long feu mais Rita Hayworth, Déesse de l’Amour est née !
Beauté voluptueuse qui, d’un battement de cil, met tous les hommes à ses pieds, à commencer par Orson Welles : tombé amoureux fou de Rita pour avoir vu sa photo dénudée en couverture d’un magazine, il épouse l’actrice en 1943 ; éprise du génial réalisateur, éperdue d’admiration, Rita est heureuse.
Mais c’était sans compter sur son terrible complexe d’infériorité qui ne tarde pas à réactiver ses blessures secrètes.
Fragilisée par une enfance flétrie, Rita est d’abord une femme qui a désespérément envie d’aimer, de fonder une famille, d’être heureuse tout simplement, bien loin du personnage de la vamp incendiaire qui provoque les hommes et les embrase pour mieux les rejeter, aussi, dans sa vie de couple, les infidélités d’un mari, aimant mais volage, lui sont-elles insupportables.
Dans le film de Charles Vidor, où elle est censée camper une femme désirable et cruelle qui ne vit que pour son plaisir, affleure, presque à son insu, une envie d’aimer absolument bouleversante, où Gilda disparaît au profit de Rita dans les scènes passionnées avec Glenn Ford : on oublie sa beauté pour ne plus voir que son jeu de femme malheureuse en quête d’amour.
Un manque qui la poursuivra toute sa vie, alors même que dévastée par son divorce d’avec Orson Welles, le seul homme qu’elle ait jamais aimé, elle tentera de se reconstruire, épousant en 1949 le charmant mais virevoltant Prince Ali Khan, rencontré en Europe, papillon butinant chaque jolie fleur croisée au détour d’un chemin : des tendances polygames qui blessent profondément la femme déjà meurtrie par sa séparation précédente, devenue mère de deux petites filles.
Quatre ans plus tard, Rita , de retour aux Etats Unis, reprend sa carrière cinématographique mais une union malencontreuse va lui faire toucher le fond : son quatrième mari, chanteur et acteur argentin plus ou moins raté, l’entraîne dans ses délires alcoolisés et ses dérapages incontrôlés.
Des épreuves qui ne laisseront pas de la marquer physiquement : au fil des ans la femme perd son statut de Déesse, assumant désormais ses rides et ses imperfections à l‘écran, elle révèle ainsi la profondeur d’un jeu tout en intériorité : moins belle mais infiniment plus émouvante, Rita joue les rôles de sa vie, une vie avec laquelle elle ne trichera plus, jusqu’à ce que l’Alzheimer, qui ne dit pas encore son nom, l’emporte, hagarde et désespérément seule, en 1987.
Portrait sensible et touchant d’une icône de la beauté, qui derrière son sourire éclatant, cachait de profondes blessures ainsi qu’en témoigneront sa deuxième fille, Yasmin Aga Khan , son dernier manager ou sa journaliste de prédilection, ceux et celles qui n’ont jamais oublié la star de légende, la comédienne et la danseuse éblouissante dont ils parlent encore avec des trémolos dans la voix, mais célèbrent surtout le courage d’une femme qui voulait être aimée pour ce qu’elle était, avant tout.
Et l’on mesure alors d’autant plus ce que fut la tragédie d’une vie qui s’est prématurément arrêtée à 67 ans.