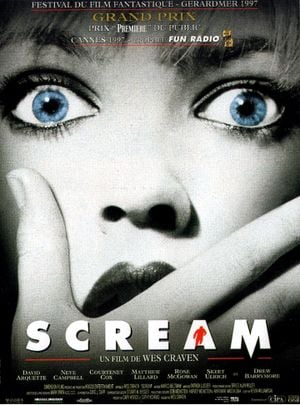Le hic avec Scary Movie, c'est qu'en parodiant Scream, il parodie une parodie ce qui, forcément, conjure vers une caricature grotesque et grasse d'un genre qu'avait déjà fait renaître Wes Craven en 1996, avec d'avantage de pertinence et de subtilité. Car Scream, tout en s'érigeant en slasher paroxystique, joue double-jeu et n'hésite pas à se moquer implicitement du genre pour mieux le sublimer. Wes Craven sait de quoi il parle et il en profite -il s'auto-cite (Les Griffes de la nuit)- pour employer les codes inhérents au genre, qu'il connaît par cœur, et donc habilement les réutiliser, donnant lieu à un film source d'inspiration pour une multitude d'autres qui suivront, tout en leur conférant une perspective parallèle discernable au second degré : Scream c'est à la fois un film-hommage, et un renouveau jouant sur plusieurs niveaux (Un peu comme Breakfast Club l'avait été pour le teen-movie). Tour de force.
La scène d'introduction en elle-même, maîtrisée de bout-en-bout, est anthologique et annonce les deux dimensions avec lesquelles jouera le métrage par la suite : Casey Backer (Drew Barrymore, délectable) est harcelée par un anonyme au bout du fil qui, poncif horrifique archi-connu désormais et qui aura tôt fait de nous terrifier nous-mêmes au moindre coup de téléphone tardif, l'interroge sur ses connaissances en matière de films d'horreur ("What is your favorite horror movie ?") avant que celle-ci ne réalise qu'elle est espionnée et que son correspondant observe ses moindres faits et gestes. L'adolescente se confond en deux entités (la victime innocente que nous pourrions être nous aussi ? ou le personnage cible typique du film ?), notamment parce qu'elle se retrouve dans une situation qui pourrait être la nôtre : cette situation est on ne peut plus réaliste et évince totalement la notion de fiction, dans laquelle on se persuade qu'elle ne peut entrer, puisque le tueur cite ouvertement des œuvres fictives comme modèles (Halloween, Vendredi 13).
De la sorte, Scream permet une mise abîme sous-jacente où l'histoire racontée (des lycéens deviennent les proies sérielles d'un Ghostface) raconte en même temps celle du genre dans lequel elle est ancrée (le slasher, son historique, sa construction, ses règles) : summum du genre, le film s'amuse avec des codes tels que le tueur masqué, la victime virginale, le jump-scare, la pléiade de seconds-rôles tous suspectés à un moment ou un autre -jusqu'à la révélation finale prenant à revers-... et emploie des tactiques spécifiques pour les orienter vers une portée satirique où elles seront progressivement déconstruites puis réhabilitées.
Le film regorge ainsi d'une multitude de références cinématographiques qui s'accumulent délicieusement les unes derrières les autres et où les grands noms noms de l'horreur, mais pas que, sont cités (Basic Instinct, John Carpenter, Psychose, Prom Night, L'Exorciste, Evil Dead, I spit on your grave, Le silence des agneaux, Carrie, les rôles de screaming-girl de Jamie Lee Curtis...), redoublant l'impression de rupture du quatrième mur, qu'on énumère nos peurs pour mieux les retourner contre nous : nous sommes pris à partie, et quand le tueur interroge ses victimes, c'est aussi nous qu'il interroge. Scream s'amuse de nos attentes par rapport aux événements qui parsèment l'intrigue en nous les annonçant quelques minutes auparavant (la scène du vidéo-club où les personnages discutent de la manière dont pourrait éventuellement procéder l'assassin).
Les personnages deviennent les spectateurs de leur propre film et sont plus ou moins conscients du rôle qu'ils y jouent. Ils connaissent les films d'horreurs sur le bout des doigts et savent, entre autres, quelles sont les stratégies à adopter s'ils veulent s'en sortir (rester vierge, ne pas monter à l'étage de la maison s'ils sont poursuivis, ne jamais dire "I'll be right back." ou demander "Who's there"). Dans leur monde à eux, il n'y a pas besoin d'avoir subi un traumatisme d'enfance pour massacrer sans remords d'innocents camarades, il leur suffit de s'inspirer de leurs films favoris : méta, Scream l'est certainement, et ses personnages sont déconnectés d'une réalité moribonde à laquelle ils échappent tragiquement (et pourtant si burlesquement, parfois) en se renfermant dans un univers alimenté par les fictions qu'ils avalent depuis toujours, convaincus que tout cela n'est qu'un jeu dont ils tirent les ficelles.