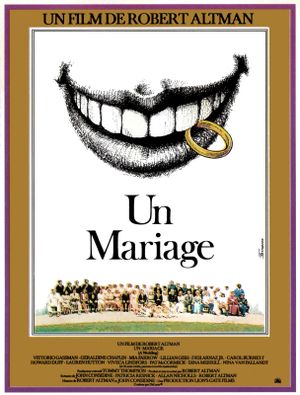Après Nashville sorti trois ans plus tôt, Un mariage reprend le concept du film choral cher à Altman, et qu’il portera à son sommet avec Short Cuts. L’ambition est plus modeste dans l’écriture, puisque le récit se limite à 24 heures d’un mariage au cours duquel la réunion de deux familles va permettre son lot d’intrigues secondaires. En grande partie improvisé par les comédiens sur un canevas relativement convenu (adultère, révélations de grossesse ou coming out, règlements de compte…), le panorama familial va installer une gradation accumulant les catastrophes, dans un jeu de massacre dont est coutumier le réalisateur.
Le début a beau jouer d’une solennité pompière, la petite tâche invisible remarquée par la maîtresse de cérémonie (Geraldine Chaplin, névrotique à souhait) sur la robe de la mariée donne le ton : rien ne pourra coller au paraître kitsch et grotesque qu’on prend pour du prestige.
Le premier véritable plaisir octroyé par le film intervient peu après la cérémonie, lorsque l’on filme la grand-mère alitée, occasionnant des retrouvailles très émouvantes avec une Lillian Gish de 82 ans, qui s’amuse avec malice de ce rôle éphémère, puisque sa mort va devenir l’un des grands ressorts de la comédie à venir.
L’aisance d’Altman à gérer la collectivité est toujours aussi manifeste : chaque personnage dissémine son caractère dans des retours récurrents qui affinent des portraits pour la plupart à charge, entre un médecin pervers et alcoolique, un patriarche émigré (Vittorio Gassman, qu’on retrouve aussi avec plaisir dans cet exil), une nymphomane lunaire et mutique (Mia Farrow), une candidate à l’adultère ou des sœurs en compétition. S’ajoute aux élites endimanchées quelques domestiques, une équipe de bras cassés à la sécurité et de vidéastes chargés d’immortaliser les événements, pour une dose supplémentaire de satire. Cette approche en abyme se prolonge dans les discours des personnages, qui, comme conscients de leur artificialité, font souvent référence à des films : une sexagénaire parle de ses premières règles en évoquant l’ouverture traumatique de Carrie, on convoque Jennifer Jones et ses belles dents, on appelle le père du marié Corleone au lieu de Corelli… chacun tente, vainement, de s’inventer une existence (voir la façon dont chacun raconte avoir été témoin de la mort de la grand-mère) ou d’insuffler une part romanesque à sa morne existence, bien conscient d’appartenir à une époque où la libéralisation des mœurs offre toutes les permissivités : échangisme, pétard au petit matin, alcool coulant à flot ou conseil de famille pour envisager un avortement ponctuent ainsi les ors d’un mariage célébré en grande pompe.
Le drame de l’aube, qui semble un temps citer le dénouement du Mépris, ajoutera à cette ambivalence de ton : alors qu’on pense avoir convergé, avec une certaine logique, vers la tragédie pure, le twist narratif sacrifiant des personnages d’arrière-plan permet un soulagement qui pourra pérenniser l’obscène médiocrité du groupe.
Reste cette statue noire aux yeux blancs contemplant, avec un effarement troublant qui double clairement celui du cinéaste, la valse vaine de ces pantins éphémères.