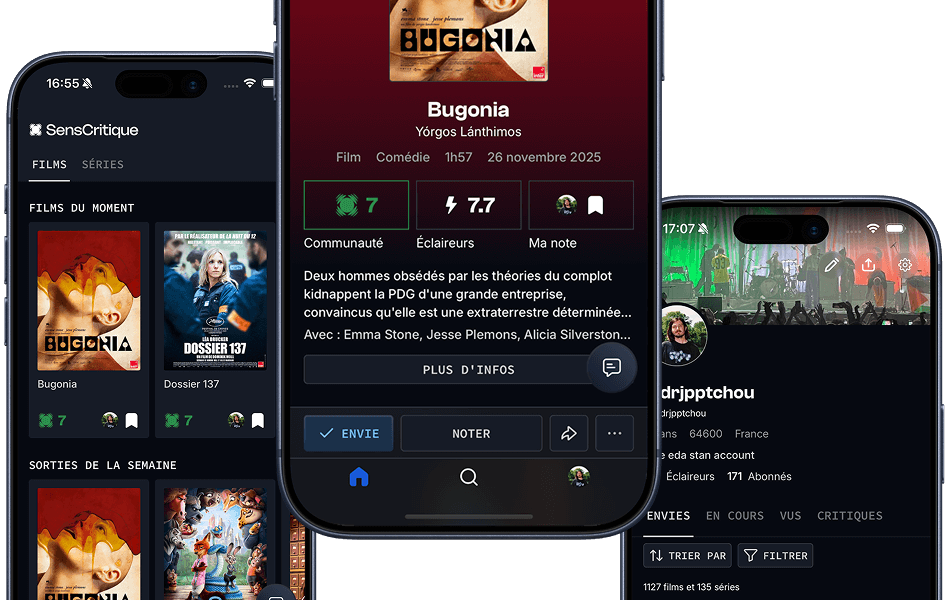Source : http://shin.over-blog.org/virtual-revolution.html
Virtual Revolution : Il y a encore une semaine, je n’avais jamais entendu parler de ce film. Pas une ligne dans les médias, pas un mot sur les réseaux sociaux (ou presque). Rien. Et puis, j’ai vu sa très belle affiche dans le métro, et j’ai commencé à m’intéresser au projet. Ce personnage central comme perdu au milieu d’un environnement urbain hostile gargantuesque et cette myriade de sélections en festivals m’a tout de suite rappelé l’affiche de The Raid (qui n’appartient pas vraiment au même genre, mais que j’avais adoré). Je me suis donc dit que cela sentait bon la bonne petite production SF indépendante pleine de promesses sortie de je ne sais où. Et si le film s’avère effectivement être "une petite production SF indépendante pleine de promesses", Virtual Revolution ne sort pas franchement de "je ne sais où". Tourné à 90 % par une équipe française (techniciens et acteurs), le premier long-métrage réalisé par le très frenchy Guy-Roger Duvert est tout ce qu’il y a de plus français. Attendez ! Ne fuyez pas tout de suite, pauvres fous ! Oui, c’est un film de SF à petit budget. Oui, c’est français. Et OUI, c’est très bien quand même. Preuve s’il en est que la France est aussi un pays où la science-fiction a sa place et où les bons films de genre existent. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes, cette précision devrait être inutile. Mais la réalité n’étant pas le titre d’un roman de Aldous Huxley, et il faut bien admettre que "cinéma français" rime davantage à l’esprit des spectateurs avec "comédie populaire" ou "drame social" qu'avec "film de genre". Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi.
La science-fiction, puisque c’est de ça dont il s’agit ici, est une notion riche et difficile à définir précisément. Selon le Larousse, il s’agit d’un « genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espace-temps fictifs (souvent futurs), impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes ». Même si elle s’en inspire, la science-fiction n’est donc pas une stricte représentation de la réalité puisqu’elle repose sur des hypothèses (« et si… ») relevant aussi bien de l’anticipation – les utopies (sociétés imaginaires idéales et sans défaut) ; ou au contraire les dystopies (régies par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste) – que de la réécriture historique – les uchronies (reconstruction fictive de l'histoire, relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire). À la différence du fantastique au sens large qui peut intégrer des éléments magiques ou surnaturelles, la science-fiction s’appuie toutefois sur des faits plausibles et "réalistes" (cela « aurait pu, ou pourrait, arriver »). Et ce, même si les frontières sont parfois minces : où ranger le soap-opera (Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica) dans tout ça ? Si la science-fiction est aujourd’hui largement associée à la culture anglo-américaine, ce genre est pourtant intimement lié à notre pays. Il y a eu Georges Méliès, il y a eu Jules Verne, mais même avant cela. Il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine...
En effet, dès le XVIIe siècle, le français Savinien Cyrano de Bergerac (mentionné par Jules Verne au début De la terre à la lune) avec L’Histoire comique des États et Empires de la Lune (publié en 1662) ou encore Fontenelle avec L’Entretien sur la Pluralité des Mondes (1686) évoquent déjà l’exploration spatiale et la question de peuples extraterrestres. Avec l’avènement du grand siècle des lumières, d’autres œuvres viendront enrichir le patrimoine français : les utopies décrites dans Voyages et aventures de Jacques Massé (1714) de Simon Tyssot de Patot, Lettres persanes (1721) de Montesquieu, La Colonie (1750) de Marivaux, les voyageurs galactiques du Micromégas (1752) de Voltaire, le Paris fantasmé de L’An 2440, rêve s’il en fut jamais de Louis-Sébastien Mercier (premier roman d’anticipation de l’histoire d’où proviendrait d’ailleurs l’expression « s’en moquer comme de l’an 40 »). Le XIXe siècle fut encore plus emblématique avec des œuvres comme le roman uchronique Napoléon et la conquête du monde (1836) de Louis Geoffroy, L’Eve future (1886) de Auguste de Villiers de l’Isle-Adam (où il est question du premier androïde conçu par un Thomas Edison fictionnalisé), et surtout l’incroyable production littéraire du père fondateur – avec l’anglais H.G. Wells – de la science-fiction moderne, Jules Verne : Voyage au centre de la terre (1864), De la terre à la lune (1865), Vingt mille lieues sous les mers (1870), Le Château des Carpathes (1892), etc.
Et le cinéma dans tout ça ? C’est justement à un français, Georges Méliès, que nous devons le premier film de science-fiction au monde avec Le Voyage dans la lune (1902). Les salles de l’hexagone verront ensuite arriver des œuvres comme Paris qui dort (1925) de René Clair, La Fin du monde (1931) de Abel Gance ou encore Le Monde tremblera (1939) de Richard Pottier. Dans le même temps, les librairies françaises verront débarquer la saga Fantômas (à partir de 1911) de Pierre Souvestre et Marcel Allan (qui finira par voyager dans l’espace), ainsi que Nous autres (1920) du russe Evgueni Zamiatine ; une dystopie – la première de l’histoire – interdite en Russie qui fut d’abord publiée à Paris – à une époque où l’on défendait donc encore la création de genre chez nous – dont la trame préfigure déjà les grands classiques du genre comme Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley et 1984 de George Orwell. L’œuvre de Zamiatine sera d'ailleurs indirectement citée dans la récente bande-dessinée française La Brigade Chimérique (véritable hommage aux premiers superhéros) avec son URSS dominée par un régime de savants fous appelés « Nous autres ». Avec la seconde-guerre mondiale, le genre devient plus sombre et pessimiste, comme en témoignera les romans de l’autre grand nom de la littérature SF française, René Barjavel : Ravage (1943), Le Voyageur imprudent (1943), La Nuit des temps (1968). Il devient surtout de plus en plus rare dans nos contrées. La censure frappe alors fortement les œuvres destinées à la jeunesse, tandis qu’elle prend un essor considérable aux États-Unis avec le développement des revues pulp et des comics, et l’apparition des serials et ses héros comme Flash Gordon et Buck Rogers.
Ce n’est vraiment qu’à partir des années 1960 que la science-fiction connaîtra un nouvel âge d’or en France : qu’il s’agisse de littérature avec La Saga d’Argyre (1960-1964) de Gérard Klein, La Planète des singes (1963) de Pierre Boulle, Les Hommes-machines contre Gandahar (1969) de Jean-Pierre Andrevon ; de cinéma avec Les Yeux sans visage (1960) de Georges Franju (1960), La Jetée (1962) de Chris Marker, Alphaville (1965) de Jean-Luc Godard, Fahrenheit 451 (1966) de François Truffaut, Playtime (1967) de Jacques Tati ; ou encore de bande-dessinée avec Barbarella (1964) de Jean-Claude Forest – adapté en 1968 par Roger Vadim avec l’inoubliable Jane Fonda de le rôle-titre – , Valérian et Laureline (à partir de 1967) de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières – source d’inspiration majeure de l’esthétique du Star Wars de George Lucas. À partir de 1975 débute surtout la publication du mythique Métal Hurlant initié par Jean-Pierre Dionnet ; formidable dénicheur de talents (Philippe Druillet, Moebius, Alejandro Jodorowsky, Hugo Pratt, Enki Bilal, Jacques Tardi...) qui aura aussi clairement impacté l’univers visuel cinématographique de l’époque. Mad Max, Alien, B**lade Runner**, Nausicaa ou Akira sont autant d'enfants indirectes de Métal Hurlant. Le père du mouvement cyberpunk, le romancier William Gibson, cite d'ailleurs le magazine français comme influence majeure.
Si la décennie 1980 semble d’abord prometteuse pour la SF à la française avec des films comme La Mort en direct (1980) de Bertrand Tavernier, Le Bunker de la dernière rafale (1981) de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, Le Voyageur imprudent (1982) de Pierre Tchernia, Le Prix du danger (1983) de Yves Boisset, ou Le Dernier combat (1983) de Luc Besson, la production nationale versera trop rapidement dans la grandiloquence kitsch (propre à l’époque) avec des œuvres nanardesques comme Diesel (1985) de Robert Kramer ou l’inénarrable Terminus (1987) de Pierre-William Glenn avec Johnny Hallyday. C’est surtout du côté de l’animation que la France saura faire la différence. Tout d’abord grâce à René Laloux : La Planète sauvage (1973), Les Maîtres du temps (1981), Gandahar (1987). Mais aussi via les séries jeunesse telles que Ulysse 31 (1981), Jayce et les Conquérants de la lumière (1985) de Jean Chalopin, Il était une fois l’Espace (1982) de Alain Barillé, ou encore Les Mondes engloutis (1985) de Nina Wolmark. Les années 1990 voient aussi arriver une nouvelle génération d’auteurs français tels que Bernard Werber (Les Fourmis en 1991), Pierre Bordage (Les Guerriers du silence dès 1993), Maurice Dantec (Les Racines du mal en 1995), ainsi que la consécration internationale de cinéastes majeures via La Cité des enfants perdus (1995) de Jeunet & Caro et Le Cinquième Élement (1997) de Besson. Tout laissait à croire que les années 2000, avec ses révolutions technologiques majeures – propices à tous les possibles cinématographiques – allait pouvoir être une période clé pour le genre en France. Mais c’est exactement l’inverse qui se produisit.
Des longs-métrages de science-fiction, il y en eut pourtant un certain nombre durant cette période, parfois même de très ambitieux : comme le chaotique Babylon A.D. (2008) de Matthieu Kassovitz adapté du génial Maurice Dantec ou l’improbable ratage Dante 01 (2008) du vétéran Marc Caro. Pendant une douzaine d’années, les productions SF françaises semblèrent n’être qu’une suite de flops incessants : Peut-être de Cédric Klapisch (1999), Furia de Alexandre Aja, Atomic Circus (2004) de Didier et Thierry Poiraud, Immortelle (ad vitam) de Enki Bilal, Renaissance (2006) de Christian Volckman, Chrysalis (2007) de Julien Leclerq, Eden Log de Franck Vestiel, Steak de Quentin Dupieux, Mutants (2009) de David Morlet, 8th Wonderland (2010) de Alberny & Mach, Prodigies (2011) de Antoine Charreyron... Alors quoi ? La France est donc à présent condamnée aux seules comédies populaires ou aux drames sociaux ? Le problème c’est que le cinéma n’est pas seulement un art, mais c’est aussi et avant tout un business. Les succès faramineux de films comme Bienvenue chez les Ch’tis, Intouchables, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? ou encore Les Nouvelles aventures d’Aladin pourraient ainsi légitimement donner raison aux producteurs. Mais ça serait quand même un peu vite oublier les innombrables casseroles du genre : Des gens qui s'embrassent avec Kad Mérad, Eyjafjallajökull avec Dany Boon, Le Marquis avec Franck Dubosc, Olé avec Gad Elmaleh, Turf avec Alain Chabat et Edouard Baer… Autant de comédies extrêmement chères avec des vedettes surpayées – souvent plusieurs dizaines de millions d’euros – qui auront fait perdre un max d’argent aux studios.
Bien sûr, le genre comique fait intrinsèquement partie de notre culture. Ne sommes-nous pas la patrie de Molière et de Louis de Funès après tout ? Mais, à l'évidence, la science-fiction aussi. Détail amusant : bon nombre de succès populaires dans lesquels joua notre Fufu national sont tintés de SF : Fantômas, Hibernatus, Le Gendarme et les Extra-terrestres, La Soupe aux choux… Même s’il s’agissait avant tout de comédies. Malheureusement, pour la majorité des producteurs français, la science-fiction n'a pas sa place dans le cinéma hexagonal. Pourtant, contrairement à cette fausse croyance actuelle, les spectateurs français ne sont pas du tout hermétiques au genre. Il suffit de regarder l’enthousiasme que suscite en France chaque nouvel épisode de Star Wars ou Avengers. Même des petites productions non hollywoodiennes trouvent leur place dans nos salles : les espagnols Eva et Les Derniers Jours, les britanniques Ex-Machina et Under the Skin, ou encore les sud-coréens Train to Busan et Snowpiercer (adapté d’une BD française !). Le véritable problème, c'est surtout que la science-fiction ne fait pas partie de la culture des "décisionnaires" du secteur en France. Cela ne les intéresse pas, et ils ne prennent donc pas la peine d’investir et de communiquer dessus. Parfait contre-exemple de cette tendance, Luc Besson est – au-delà de la qualité des œuvres produites par son studio EuropaCorp – la preuve vivante qu'un film de science-fiction français peut avoir du succès. Le demi milliard de recettes de Lucy montre bien qu'il existe un public pour le cinéma de genre hexagonal. Besson y croît d'ailleurs tellement qu'il n'hésite pas à investir près de 170 millions d'euros pour son prochain Valérian. Et pendant que les critiques s'amusent de la pauvreté scénaristique d'un Banlieue 13, Martin Campbell n’hésite pas à s’inspirer largement de la mise en scène nerveuse de Pierre Morel pour son amorce de Casino Royale (qui sera lui largement encensé).
D'ici quelques années, j'ose à espérer que les vieux décisionnaires français (et leurs idées toutes faites sur la question) seront progressivement remplacés par des gens de ma génération nourrie – à l'instar d'un Besson – de Star Wars, des productions Spielberg et autres super-héros, et que les choses finiront par évoluer. Pour tout vous dire, je commence un peu à perdre patience d'attendre cette lente évolution. Une véritable révolution s'impose ! Et c'est pour cela qu'il me semble important de soutenir une initiative aussi courageuse et ambitieuse que le bien-nommé Virtual Revolution. Pour mener à bien son projet fou, le réalisateur Guy-Roger Duvert aura dû batailler sec contre tout un système. Ayant commencé dans le milieu en tant que compositeur de films, le cinéaste commence à se faire connaître grâce à son deuxième court-métrage Cassandra (2004) qui rencontre un grand succès dans les festivals. Pourtant, malgré plus de 105 sélections et 58 prix remportés (un record dans le genre), ce court axé heroic fantasy ne lui permet pas de monter son projet de long qui lui tient à cœur. Ne trouvons aucun soutien des producteurs du milieu, Guy-Roger Duvert décide donc de s’autofinancer ; investissant l'intégralité de ses économies, empruntant à ses proches, et s'endettant même pour quelques centaines de milliers d'euros encore. L'aspect positif, lorsqu'il n'est possible de ne compter que sur soi-même, c'est que (même si cela demande un investissement massif et beaucoup de sacrifices) cela permet aussi de garder un contrôle total de son œuvre. À la fois producteur, réalisateur, scénariste et compositeur de Virtual Revolution, Guy-Roger Duvert a surtout eu l'intelligence filmique d'un John Carpenter en titillant l'intelligence du spectateur avec un script bien pensé plutôt qu'en essayant de le noyer sous un déluge d'effets spéciaux mal maîtrisés (le budget ne l'aurait de toute manière pas permis sous peine d'aboutir à un résultat complètement nanardesque).
L'histoire de Virtual Revolution prend donc place dans le Paris de 2047 et met en scène une société futuriste où 75% de la population passe l'essentiel de son existence connecté à des mondes alternatifs numériques. L'humanité se retrouve donc scindée entre une majorité de « connectés », qui vivent reclus chez eux branchés à des casque de réalité virtuelle, et une minorité d'individus ayant fait le choix de continuer à vivre parmi les « vivants ». Au milieu, il y a Nash. « Hybride » naviguant entre les deux mondes, notre héros est une sorte de détective privé chargé par l'industrie vidéoludique de traquer et d'éliminer les rebelles qui ont infiltrés ces univers fictifs en ligne pour mettre définitivement un terme à ce système, n'hésitant pas à tuer pour arriver à leurs fins. Guy-Roger Duvert a eu l'idée du film en lisant un article de 2005 à propos de EverQuest II, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG ) se déroulant dans un univers heroic fantasy à la Warcraft. 25 % des joueurs affirmaient alors accorder davantage d'importance à leur vie virtuelle dans le jeu qu'à leur vie réelle. Sachant qu'il ne s'agissait alors que d'un simple jeu-vidéo archaïque avec interface souris-clavier sur écran 2D, il est légitime de penser que ce nombre grimpera en flèche le jour où le réalisme des jeux-vidéos sera équivalent au réel et où la technologie permettra une immersion totale. Avec l'arrivée sur le marché vidéoludique des casques de réalité virtuelle dès 2016, tels que l'Oculus Rift et le PlayStation VR, Virtual Revolution semble plus prophétique que jamais. Le jour où la technologie ne permettra plus de distinguer le réel du virtuel, pas juste visuellement mais aussi au niveau du ressenti, il y a effectivement fort à parier que la Virtual Reality se traduise de fait par une Virtual Revolution.
Évidemment, pour qu'un tel monde futuriste puisse avoir l'air aussi réel qu'une possible réalité à nos yeux, cela nécessite un travail esthétique des plus solides ; sous peine de virer à un résultat totalement ringard. Or, comment faire un film aussi ambitieux qu'un blockbuster hollywoodien à 150 millions de dollars lorsque le budget investi équivaut à peine à celui d'un épisode de Joséphine Ange-Gardien ? Armé de son petit million d'euros, c'est précisément ce que Guy-Roger Duvert est parvenu à démontrer en compensant ce manque évident de moyens par une ingéniosité de chaque instant, une créativité bouillonnante et un talent hors-norme. La grande force de Virtual Revolution réside ainsi dans le fait qu'il n'essaie jamais d'en faire trop. Bien conscient de limites imposées par son manque de budget, le cinéaste a su faire les choix stratégiques et les sacrifices nécessaires pour mener à bien son projet. Cela se ressent parfois dans l'écriture de quelques passages et dans certains partis pris de mise en scène (notamment avec ces séquences dialoguées un peu statiques), mais jamais au point d'altérer véritablement l'immersion du spectateur. Et si Guy-Roger Duvert a été contraint de privilégier la qualité à la quantité (mais est-ce vraiment un mal après tout ?), il faut aussi saluer le travail incroyable réalisé par les techniciens. Des costumes confectionnés par Mathilde Fontaine et Rosalida Medina (qui s'adaptent aux caractéristiques des différents personnages et univers de manière recherchée et variée) en passant par la photographie de Cyril Bron (parvenu à doter d'une identité visuelle unique chacun des mondes), jusqu'aux effets spéciaux supervisés par Matt Hoffman (omniprésents sans être indigestes), le résultat est tout bonnement remarquable. Surtout s'agissant d'un film dont le budget est 150 fois inférieur à celui d'un Transformers.
Évoquant Game of Thrones et les univers fantastiques de Tolkien sublimés par Peter Jackson (avec un clin d’œil évident à Assassin's Creed), le monde "heroic fantasy" – qui peut se voir comme un prolongement du précédent court-métrage de Guy-Roger Duvert, Cassandra – surprend d'entrée avec ce plan (bref mais intense) sur un dragon médiéval du plus bel effet et ses décors naturels sublimés par une utilisation savante des jeux de lumières. L'autre monde "post-apocalyptique" n'est pas en reste avec son ambiance à cheval entre le Robocop de Paul Verhoeven – notamment lors du passage avec ce robot géant évoquant le fameux ED-209 – et les films de Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie). Certains regretteront sans doute le côté résolument guerrier et barbare des deux seuls mondes virtuels présentés (entretenant ainsi indirectement la sempiternelle critique sur la violence des jeux-vidéo) ; et il est exact que c'est une vision un peu réductrice (Les Sims en est un bon contre-exemple). Mais s'agissant d'un film de 90 minutes, des choix s'imposaient ; et force de constater que des jeux comme *Warcraf***t ou ***Deux Ex* sont assez représentatifs des préférences de joueurs en ligne. Le Paris futuriste de 2047 n'est pas en reste non plus avec ses ruelles sombres et poisseuses, sa pluie incessante et ses immeubles imposants qui lui confèrent une ambiance ténébreuse et pesante à la Blade Runner ; dont l'influence est évidente (et totalement assumée par Guy-Roger Duvert). En même temps, quelle meilleure inspiration que Ridley Scott – le grand maître du Tech Noir (avec le James Cameron de Terminator*, dont le nightclub a donné son nom au genre)* – pour mettre en images cette histoire entre science-fiction et film noir ? De manière plus générale, le long-métrage évoque toute l'imagerie cyberpunk initiée par William Gibson (auteur du roman fondateur Neuromancien, et de Johnny Mnemonic) : Ghost in the Shell, Avalon, eXistenZ, Total Recall ou encore Strange Days.
Bien qu'il s’inscrive au sein d’un univers ultra-référencé, le film de Guy-Roger Duvert parvient toutefois à faire preuve d’originalité par rapport à ses modèles. Contrairement à Matrix ou Passé Virtuel, les protagonistes de Virtual Revolution ne sont donc pas manipulés par une entité supérieure (humaine ou robotique). Au contraire, c'est en leur âme et conscience que les individus se connectent continuellement aux réseaux de ce Paris futuriste. Lorsque le réel devient trop morose, grande est la tentation de s'évader vers ces nouveaux paradis artificiels. Le héros du film se réfugie d'ailleurs régulièrement dans ce monde médiéval idyllique afin de retrouver sens à son existence et source d'épanouissement ; ce que ne semble plus lui apporter une réalité imparfaite et frustrante. Cette fuite vers le virtuel – même si le plus grand nombre semble s'en satisfaire (75 % des gens ici) – n'en demeure pas moins une sorte d'asservissement volontaire du peuple. Et quel meilleur système de contrôle des masses que celui qu'elles s'imposent elles-mêmes ? Bien conscient de ce fait, les élites dirigeantes ont d'ailleurs ici mis en place un revenu universel – un sujet de plus en plus d'actualité – qui encourage cette auto-dépendance des humains envers les nouvelles technologies ; n'ayant même plus besoin de travailler pour subvenir à leur besoin vitaux, quitte à ressembler aux obèses assistés du tristement prophétique Wall-E. Avec la robotisation croissante d'un certain nombre de métiers, la place omniprésente prise par les réseaux sociaux dans nos vies – terribles images de ces gens qui partagent la même table mais ont tous les yeux rivés sur leur écran – et la façon dont un simple jeu-vidéo – l'addictif Pokémon GO par exemple – peut pousser notre génération hyper connectée à des actes insensés, la situation décrite ici est vraiment loin d'être farfelue. En restant connecté au virtuel, le peuple se déconnecte progressivement d'une réalité que les puissants peuvent alors diriger à leur guise ; sans révolte ni violence. Ou presque.
Car si la majorité de la population se conforme bien volontiers à ce système d'auto-contrôle, Virtual Revolution montre également le point de vue de ces rebelles prêts à tout pour "libérer" les personnes connectées. Si le combat de ces résistants contre l'oppression insidieuse du gouvernement et des multinationales apparaît légitime par bien des aspects, il questionne toutefois sur la notion de libre-arbitre. En libérant de leurs chaînes virtuelles des connectés contre leur gré, ces hackers extrémistes – dont les pratiques radicales évoquent des mouvements comme No Border – ne portent-ils pas effectivement atteinte à la volonté-même de ces gens ? En d'autres termes : peut-on légitimement forcer quelqu'un à être libre ? Refusant tout manichéisme primaire, Guy-Roger Duvert a le bon goût de ne pas prendre véritablement parti et de laisser le spectateur seul juge. Un non-choix intelligent qui évite donc d'imposer une vision, forcément réductrice, tout en encourageant à la réflexion et à l'échange (comme en témoignèrent les après-séances passionnées avec l'équipe du film auxquelles j’eus la chance de participer). Bien que philosophiquement et politiquement très riche, Virtual Revolution n'a pourtant pas d'autre prétention que d'être avant toute chose un divertissement ludique et amusant. Le long-métrage n'hésite d'ailleurs jamais à prendre le recul nécessaire et jouer la carte du second degré salvateur comme le montrent cette consultation impromptue de mails (qui aura bien amusée la salle), cette allusion ironique de Nash sur le fait qu'il n'y a désormais plus personne dehors pour le surprendre en train d'entrer par effraction dans un immeuble, ces clins-d'œil amusants à notre culture populaire (la fameuse « Rue Michel Colucci » !), ou encore cette réplique irrésistible du héros – sorte d'aveu complice du cinéaste aux spectateurs des propres limites de son film – après un interminable (bien que nécessaire) discours qu'il qualifie avec sarcasme de « monologue passionnant ». Même si elle repose sur des mécaniques connues du cinéma de genre (le héros badass, le sidekick comique, le badguy volubile, la femme sexy et mystérieuse), l'écriture de Virtual Revolution reste d'une redoutable efficacité et parvient le plus souvent à faire oublier le manque de moyens engagés.
Au même titre que les archétypes cinématographiques utilisés par le cinéaste, l'emploi de sonorités familières – *la musique lors des passages parisiens rappelle le travail de Vangelis su*r Blade Runner – place instantanément le spectateur en territoire "connu", facilitant ainsi son immersion dans les différents mondes (réel ou virtuels). Englobante sans être agressive, la bande-originale de Guy-Roger Duvert concoure à donner une ambiance distinctive aux différents univers du film, magnifiés par la direction artistique de Marc Azagury. C'est notamment le cas lors des passages à Paris avec ces appartement où la vie semble avoir désertée les lieux (murs délabrés et baignoire inutilisée depuis longtemps), et ces rues désertes hantées d'âmes fantomatiques et de vaisseaux automatiques – au design rappelant Le Cinquième Élément – qui approvisionnent inlassablement les buildings high-tech des multinationales. Le faible nombre de figurants employé à l’écran trahit l’absence de moyens, mais cela est rarement préjudiciable au film puisqu’il est indiqué que la majorité des humains restent cloîtrés chez eux. Principalement tourné dans des décors naturels en région parisienne (un seul jour de tournage en studio sur trente), Virtual Revolution permet ainsi au spectateur de découvrir la capitale sous un nouveau jour. Un Paris à venir revisité, mais aisément reconnaissable, et particulièrement mis en valeur (comme en témoigne le passage à la Mairie du 18e arrondissement). Et ce, malgré quelques ajouts numériques d’immeubles futuristes gigantesques un peu extravagants pour 2047 ; une entorse à la vraisemblance qui s’explique sans doute par un désir d’esthétisme (le travail sur l’image est un aspect important du film). L’utilisation stylisée de la slow-motion n’est d’ailleurs pas sans rappeler Le Pacte des loups ; ce qui n’a rien d’étonnant puisque Gil De Murger a coordonné les cascades des deux films. Sophistiquées et aériennes, les chorégraphies des mondes virtuels tranchent assez radicalement avec la violence sèche et brute des combats dans le réel.
À l’instar du corps-à-corps sauvage entre le héros et ce tueur à gage implacable évoquant un John Locke (LOST) sous amphétamines qu’interprète l’imposant Pascal Gilles, professeur d’arts martiaux (ceinture noire taekwondo et karaté) et spécialiste du pencak-silat ; utilisé dans la saga indonésienne The Raid et le Taken de Pierre Morel. Face à lui, Mike Dopud est tout aussi convaincant dans la peau de Nash. Il faut dire que l’acteur canadien – aperçu dans les séries Stargate Universe et Battlestar Galactica – est aussi un athlète émérite (professionnel dans la Canadian Football League) et un cascadeur reconnu (X-Men 2, 300, Watchmen). Ce qui se ressent à l’écran et apporte une crédibilité formelle à leurs confrontations. Au-delà de son physique impressionnant, Mike Dopud allie charisme et sensibilité – quelque part entre le Mickey Rourke de Sin City et celui de L’Année du Dragon – pour donner corps à ce détective taciturne mais déterminé, qui porte l’essentiel de l’intrigue sur ses solides épaules. Son timbre éraillé donne du cachet aux passages en voix-off – dans la grande tradition du polar noir vintage façon Assurance sur la mort – et le mordant de ses répliques teintées d’un humour tranchant est plutôt appréciable ; notamment lors de ces joutes verbales savoureuses avec son acolyte Morel. Ce hacker surdoué est incarné par l’épatant Maximilien Poullein qui réussit à donner une réelle consistance un rôle pas si évident : celui de faire-valoir du héros. Le comédien français parvient à doser suffisamment son jeu pour rendre son personnage drôle et attachant sans jamais donner l’impression d’en faire trop. Un second rôle idéal et marquant qui n’est pas sans évoquer Steve Buscemi ou Giovanni Ribisi, et vole régulièrement la vedette dans ce tandem dans la pure lignée des buddy movies à l’ancienne (48 heures, Le Dernier Samaritain, La Manière forte).
Les fans de la mythique série V seront également ravis de revoir la légendaire Diana. Bien qu’assez peu présente, la froideur implacable et le pouvoir de séduction de l’américaine Jane Badler demeurent toujours aussi saisissants. Dans le rôle de l’ambigu et inquiétant Stilson, Jochen Hägele est impeccable. Après avoir campé un officier nazi mémorable dans House of Time de Jonathan Helpert (autre film de SF français sorti trop confidentiellement début 2016), l’acteur allemand parvient une fois encore à créer un personnage au charme déstabilisant qui évoquent certaines prestations névrosées de Gary Oldman ou de Tchéky Karyo (Léon et Dobermann en tête). Résolument international, le casting de Virtual Revolution comprend aussi l’anglo-australienne Kaya Blocksage (vue dans Catacombes et la série Clem) en leader activiste, le mannequin suédois Petra Silander en fantasme geek ultra sexy, l’athlète franco-américain Emilien De Falco, ou encore les français Zoe Corraface et Vincent Ceus (aux regards – bleus et verts – inoubliables). Logique internationale toujours, Guy-Roger Duvert a donc tourné son film dans la langue de Shakespeare. Il n’existe donc pas de version française à proprement parlé, mais seulement une version anglaise sous-titrée. Si certains allergiques à la "lecture" pourront être rebuté par cet aspect, notamment lors de certains longs dialogues explicatifs, ce choix commercial – un film en anglais se vendra nécessairement mieux à l’étranger – s’avère également être assez pertinent d’un point de vue "acting". Tout le monde ne partagera sans doute pas ce point, mais j’ai personnellement toujours trouvé l’anglais plus musical et naturel à l’oreille que le français, plus littéraire et académique (donnant parfois une impression que les acteurs récitent une pièce de théâtre). Pour un long-métrage résolument SF, avec les réticences habituelles opposées au cinéma de genre français, le choix de l’anglais paraît donc d’autant plus évident.
En dépit de toutes ses qualités intrinsèques et de ce parti pris anglophone plus "vendeur", Virtual Revolution a tout de même eu énormément de mal à être distribué ; y compris après avoir fait ses preuves dans nombre de festivals (raflant près une vingtaine de prix). C’est en démarchant directement les salles que Guy-Roger Duvert et son équipe sont parvenus à convaincre certains exploitants ; tels que le Lucernaire et le Publicis – qui furent les premiers à soutenir le projet (rejoints ensuite par le Studio Galande) – sur Paris, ou encore quelques patrons du réseau CGR en Province. Un choix payant puisque, lors de la première journée de démarrage sur Paris le 12 octobre 2016, le ratio entrées par copie fut nettement plus important que celui de plus gros films comme L’Odyssée avec Lambert Wilson ou encore Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Le bouche-à-oreille très positif aidant, Virtual Revolution a également vu son nombre de salles augmenter en seconde semaine. Mais ne disposant que du public pour exister au sein d’un système où les films sont devenus des produits de consommation rapide, il convient aux spectateurs de continuer à soutenir cette initiative hexagonale courageuse, et à montrer aux gros producteurs français qu’il existe une véritable demande pour ce genre de films. Bien qu'il ne soit pas dénué de quelques faiblesses formelles essentiellement imputables à un budget limité (qui encourage à une certaine indulgence), Virtual Revolution n'en demeure pas moins un sacré bon divertissement, inventif et audacieux, qui mérite vraiment d'être soutenu ; et qui laisse aussi rêveur quant aux possibilités à venir avec davantage de moyens. Premier essai très prometteur, Virtual Revolution constitue en l'espèce une base solide de réflexion sur la réalité virtuelle et notre relation contrariée, entre fascination et crainte, vis-à-vis des nouvelles technologies. Et j'espère sincèrement que, le succès aidant, Guy-Roger Duvert pourra mener à bien son projet de série télévisée et de bande-dessinée dérivées du films afin d'approfondir cet univers riche ouvrant bien des perspectives : quid des autres mondes virtuels proposés ou de la survie de l'espèce dans une société où les gens font passer leur plaisir personnel avant le plus fondamental intérêt communautaire ?