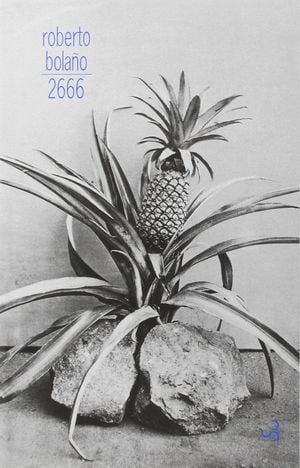On sort des gros livres, comme d'un long compagnonnage, avec le pincement au cœur de la fin des complicités affectives.
2666 est un livre-culte. De quelque 1 400 pages. Qui, mis en scène au théâtre il y a quelques années, a donné matière à une pièce de près de 11 heures. Un livre si peu lu que ses rares lecteurs entretiennent entre eux la complicité de qui a triomphé d'une même épreuve !
Il s'agit du livre posthume d'un auteur chilien, exilé en Espagne, au Mexique et ailleurs, mort en 2003, à l'âge de 50 ans, dont les Editions de l'Olivier ont entrepris de publier les Oeuvres complètes.
2666 a été salué à sa sortie en 2004 comme le « premier chef d'oeuvre du XXIème siècle » par des prix prestigieux, notamment au Chili et en Espagne. Patti Smith, Philippe Djian, Virginie Despentes en raffolent. Fallait bien aller y voir un peu et le confinement était propice.
Cinq récits que l'on croit dispersés mais qui composent en réalité un cercle parfait qui embrasse une multitude de thèmes, certains accessoires, d'autres plus importants, autour de la figure de l'écrivain, de l'écriture et du Mal.
Quatre universitaires européens, un Français, une Anglaise, un Espagnol et un Italien, que réunit une passion commune pour un écrivain allemand, avec une œuvre mais sans biographie, Benno von Archimboldi, courent de colloque en colloque, sympathisent, se font l'amour. Trois d'entre eux partent à la recherche de l'écrivain et se rendent au Mexique où il aurait vécu. Nous voilà à Santa Teresa, ville imaginaire, frontalière des Etats-Unis mais sœur jumelle de la vraie Cuidad Juarez où ont été perpétrés entre 1993 et 2003 plus de 4 000 meurtres de femmes.
Ils y rencontrent Amalfitano, professeur venu s'installer avec sa fille dans cette ville « qui contenait tout ce qu'il y a d'orphelin dans le monde » ou, pour mieux dire, en citant l'épigraphe baudelairienne du roman, « une oasis d'horreur dans un océan d'ennui ». Amalfitano commence à entendre des voix et, en un geste terriblement ready-made, suspend un livre sur une corde à linge « pour voir s'il apprend deux ou trois choses sur la vie réelle ».
Un jeune journaliste afro-américain , Fate, arrive à son tour à Santa Teresa pour suivre un match de boxe, mais les crimes de femmes non élucidés lui paraissent un meilleur sujet. Il y travaille contre l'avis de sa rédaction, rencontre la fille du professeur Amalfitano, les deux vivent leur histoire d'amour mais la pression locale d'une police corrompue et des narco-trafiquants les force à partir. Fate et Rosa sont les figures saines et positives de 2066. « Géant perdu au milieu d'une forêt brûlée » le couple fuit le brasier du Mal.
La partie la plus importante du livre, le cœur de 2666, s'intitule « La partie des crimes ». 117 crimes (je les ai comptés) contre des femmes, dont on retrouve les corps mutilés dans le désert, décrits par le menu, avec méticulosité, comme autant de notices nécrologiques qui restituent les vies fauchées des victimes, des ouvrières exilées dans des usines sous zone-franche (les maquiladoras) que le voisin américain finance en deçà de la frontière pour éviter l'immigration latino sur son sol. Les crimes sont le fait d'un tueur en série, ou de plusieurs sans doute, mais s'y mêlent aussi des crimes conjugaux, dont on ne retrouve pas plus les auteurs que l'on n'identifie les sérial killers. Le nombre inouï de ces crimes qui en rend le mobile indistinct (domestique ou pervers), entre égale impuissance à en appréhender les auteurs, indolence ou corruption de la police mexicaine, indifférence de l'opinion, ou volonté des narco-trafiquants qu'il en soit ainsi, justifie le concept de « féminicide », qu'ordinairement je n'aime guère (un crime restant un crime même s'il ne rime pas en « cide ») mais auquel l'écriture, l'intelligence, le style comme détaché de Bolano confèrent, ici, une puissance de vérité singulière.
Le Mal, ce sont aussi les atrocités de la Seconde Guerre mondiale : des soldats roumains qui se débandent devant l'avance de l'armée russe non sans avoir crucifié leur général pour le punir d'avoir préféré à l'exercice de son commandement le silence du recueillement face à la défaite ; et puis la confession, dans un camp de prisonniers allemands, d'un responsable de main d'oeuvre du Reich, installé en Pologne, auquel on envoie, par erreur, un convoi de cinq cents Juifs grecs, initialement destiné à Auschwitz, et dont il doit faire son affaire. Il raconte ça comme un logisticien convaincu qu'il a réglé le problème au mieux et après avoir pris toutes les précautions attendues d'un bureaucrate responsable : passer quelques coups de téléphone pour tenter de recueillir des ordres de la hiérarchie, peser les solutions alternatives, ne pas en trouver de conformes à « la loi » ; décider enfin. Ces pages-là sont les plus saisissantes sur le génocide que j'ai lues depuis Primo Levi et Hannah Arendt.
Et puis il y a le reste, bien sûr, tout le reste qui est certes abondant mais se lit avec plaisir et même gourmandise tant l'écriture est fluide et le propos cocasse ou intelligent : les digressions, les fausses pistes, les considérations sur l'écriture, le mythe de Sisyphe, Kafka, Melville, Flaubert ou Courbet, le sort des écrivains soviétiques durant les purges, un imaginaire asile psychiatrique d'écrivains français oubliés, les rapports entre un éditeur et ses auteurs ou le goût des lecteurs pour les oeuvres mineures.
A l'un de ses personnages, Roberto Bolano fait dire « Quel triste paradoxe. Même les lecteurs cultivés ne se risquent plus aux grandes œuvres, imparfaites, torrentielles, celles qui ouvrent des chemins vers l'inconnu . Ils choisissent les œuvres parfaites des grands maîtres. Ou ce qui revient au même : ils veulent voir les grands maîtres dans des séances d'entraînement à l'escrime, mais ne veulent rien savoir des vrais combats, contre ce qui nous terrifie tous, […] ce qui effraie et charge cornes baissées, où il y a du sang, des blessures mortelles et de la puanteur ».
Oui, c'est vrai : quand on doit tourner la page après un tel compagnonnage littéraire, on se sent en deuil d'une conversation, grave, éblouissante, dense et limpide, sur ce que la littérature a à nous dire de la noirceur du siècle.
A lire, dès le prochain confinement.