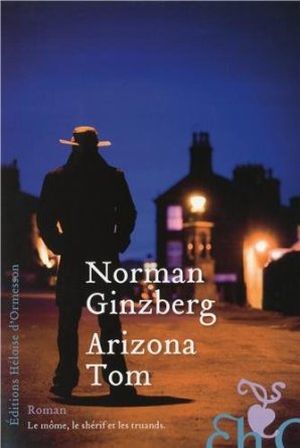Arizona, 1888, un sourd-muet de douze ans traîne en plein désert un cadavre démembré. Arizona Tom ferait une série télévisée en huit ou dix épisodes tout à fait regardable : le cadre s’y prête, les personnages sont ultra-typés, l’intrigue tient en haleine jusqu’à une chute par ailleurs excellente, le shérif – ici narrateur – qui mène l’enquête se pose là dans la catégorie pauvres-types-au-bout-du-rouleau. (Souvenez-vous que Tom est sourd-muet.)
Cela dit, Arizona Tom est un livre. Du coup on est en droit de s’attendre à quelque chose de riche : un bouquin avec un môme étranger au langage oral, et dont la maîtrise de l’écrit s’arrête à l’écriture de son prénom (tiens, en passant, heureusement qu’il ne s’appelle pas Jefferson), c’est comme un film sur un aveugle, ça doit donner un minimum de réflexion. (Souvenez-vous que Tom est sourd-muet.)
Mais non.
La question du sens ne se pose à aucun moment. (Souvenez-vous que Tom est sourd-muet.)
J’ai appris au cours de ma lecture que l’auteur travaillait dans la communication, ce qui ne veut rien dire et tout dire en même temps, mais ce qui explique que tout dans ce polar western est fait pour la lisibilité. (Avant que les s*c*urs – traduisez thuriféraires – de Bernard Werber me sautent dessus, quand je parle de lisibilité, je ne sous-entends pas qu’un bon livre doive être difficile à lire ; il y a des daubes hermétiques comme il y a des chefs-d’œuvre transparents qu’on peut comprendre et aimer avec le vocabulaire et les capacités cognitives d’un enfant de six ans.) En l’occurrence, l’auteur d’Arizona Tom considère que le cliché et la redondance sont des gages de lisibilité. (Et normalement c’est là que les s*c*urs – traduisez aficionados – de B. W. me sautent dessus.) (Souvenez-vous que Tom est sourd-muet.)
Par exemple, sitôt que le personnage de Tom (souvenez-vous qu’il est sourd-muet) intervient, l’auteur se sent obligé de rappeler qu’il est sourd-muet (vous vous en souveniez ?). Or, même dans une rame de métro surchargée en pleine heure de pointe, même après vingt heures sans dormir, même sous les bombes, un lecteur normalement constitué se souvient de ça. Et même un déficient mental. Qu’on m’explique le but de cette redondance, qui n’a rien d’un parti pris esthétique.
Autre raté : les personnages. Le gosse, je vous le laisse ; question vraisemblance il fait tout juste la maille, surtout à mesure que l’intrigue avance, mais enfin on a vu pire, y compris dans des chefs-d’œuvre. (Ce qui fait une partie de la réussite du Seigneur des porcheries ou de la Conjuration des imbéciles, par exemple, c’est précisément la plongée des invraisemblables Kaltenbrunner ou Reilly dans un monde sinistrement vraisemblable.) Le shérif, à la rigueur… Admettons qu’il y ait une forme de distanciation secrète, de clin d’œil au lecteur dans la présence de ce pauvre-type-au-bout-du-rouleau (ça, je l’ai déjà dit) qui place l’ouverture des bouteilles de whisky presque aussi haut que la manifestation de la vérité. Mais pas plus haut, car le shérif est un homme bon qui a beaucoup souffert. Et le croque-mort Abner Drinkwater, un ami sur qui on peut compter, et qui a beaucoup souffert. Le crotale et sa bande, quant à eux, sont des hommes très mauvais. Texas King, lui, est un coquet très ridicule. La veuve Emily Hanson, refuge de tendresse pour celui qui ne la juge pas, une femme très bonne qui a beaucoup souffert. Le maire Artie Hackett, un fieffé gredin. Et l’ermite Winterbottom, un très fin connaisseur de la nature, et qui a beaucoup souffert. J’arrête là, même un enfant passionné par le Club des Cinq trouverait tout cela manichéen.
Venons-en au style. Enfin, « style », c’est une façon de parler. Pour tout dire, le narrateur ressemble souvent à ce vieil oncle des repas de famille, un peu beauf – pas le beauf Bidochon, le beauf à la Cabu –, qui vous raconte une de ses mésaventures destinée en réalité à le mettre en valeur. Quelques effets faciles, un zeste de grivoiserie, et le tour est joué. Cela dit, quand l’oncle se prend pour le Rimbaud du « Bateau ivre », c’est pire : « J’ai traversé des déserts drapés de vermillon, de pourpre et d’or, j’ai couvé des ciels bleus aussi doux qu’une première caresse, j’ai connu des vallées gardées par mille chênes, plus secrètes qu’un ventre de vierge, j’ai gravi des collines aussi douces que les fesses d’une matrone et couru des plaines aux longs cheveux vermeils qui ondoyaient sous la caresse du vent. » (chap. 1, p. 15 du « Livre de poche ») !
Et n’oublions pas pas les réjouissantes leçons de vie, telles que « Ce jour-là, malgré mon âge avancé, j’ai encore appris quelque chose d’utile : pour gagner un combat difficile, mieux vaut faire croire à ses adversaires qu’on est en train de perdre et s’en remettre à la providence. Il arrive que celle-ci soit juste » (chap. 5, p. 110).
Et puis merde, le principe de charité, ça va bien cinq minutes : qu’un auteur écrive lui-même les notes explicatives de bas de page de son roman, ça devrait être rédhibitoire.
Tiens, plutôt qu’Arizona Tom, lisez « Chickamauga » d’Ambrose Bierce, pour voir ce qu’un écrivain fait avec les mêmes ingrédients.
(Et souvenez-vous que Tom est sourd-muet.)