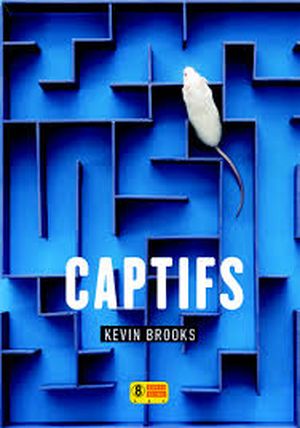Il y aurait une étude à faire sur ce qu’on pourrait appeler les fictions de l’expérience sociale dans notre modernité. On y mettrait pêle-mêle Battle Royale, Sa Majesté des Mouches, The 100, Hunger Games, Lost, peut-être encore Funny Games ou 2001 Odyssée de l’espace, avec les 120 Journées de Sodome comme matrice… On noterait sans surprise que les thèmes de l’enfermement et du jeu – sous une forme dégradée, ou « ultime » – sont récurrents dans les œuvres suscitées, mais on serait peut-être un peu plus intrigué par la sur-représentation de l’adolescence : ici, c’est le narrateur qui a seize ans. Il faudrait encore relier tout cela à la « télé-réalité » et à la vogue récente des escape games, virtuels ou réels.
Tout ça pour dire que Captifs, dont le titre original est peut-être moins affriolant, ne sort pas de nulle part, et pas que du cerveau de son auteur. De fait, on relativisera aussi le caractère prétendument subversif du roman : si le récit de Kevin Brooks dérange, c’est principalement pour le pessimisme absolu de sa fin ouverte sur le vide. D’ailleurs, c’est seulement au bout d’une grosse centaine de pages que j’ai commencé à me dire que j’avais peut-être entre les mains autre chose qu’un page-turner bien foutu. (Si on veut du vraiment dérangeant, du sordide rendu plus malsain encore par l’usage d’un humour noir qui fait cruellement défaut à tout ce « courant », on lira du Brian Evenson, ou pourquoi pas Joko fête son anniversaire de Topor.)
Précisons aussi que le style brille par… par quoi, d’ailleurs ? – par rien : il ne brille pas, il est sacrément terne. Heureusement pour la traductrice qu’elle avait quelques comptines et jeux de mots à se mettre sous la dent, en dehors de quoi elle a dû profondément s’ennuyer. À la rigueur on admettra que le style n’est pas le premier critère de ce genre de bouquins.
Non, en fait, le péché originel de Captifs, ce sont ses personnages. Plutôt que de véritables individus, le bunker qui sert de théâtre à ce huis clos massacreur accueille successivement six types : Linus le gosse de riche que le manque affectif a décidé à vivre dans la rue, Jenny la petite fille innocente, Fred l’héroïnomane costaud sur-adapté aux états-limite, Bird l’homme d’affaires sans cœur à l’égoïsme agressif, Anja la jolie trentenaire totalement étrangère à la notion même de débrouillardise et Russell le vieux sage qui n’en a plus pour très longtemps. Sans oublier, bien sûr, le sadique anonyme aux manettes.
Or, l’auteur aurait pu, en variant les points de vue, donner à l’ensemble un peu de relief et exploiter encore davantage les tensions entre personnages ; ou encore, en évitant de confier la narration au premier arrivé, ajouter un peu de paranoïa. Il a préféré n’en rien faire : à la chronique d’un jeu de massacre – qui a dit slasher ? – s’ajoute donc une tentative de récit initiatique, ce qui déséquilibre le récit. À titre personnel, je me suis d’autant plus désintéressé des souvenirs de Linus – finalement assez convenus – que les autres personnages semblent n’avoir presque aucun passé.
Cent cinquante pages rugueuses et grattées jusqu’à l’os auraient été parfaites, ou alors six cents pages d’une narration polyphonique. Mais là, on a juste un assez bon bouquin.