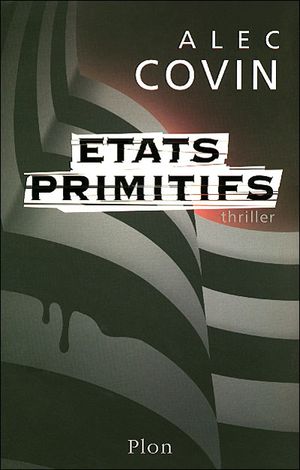Comme pour Les loups de Fenryder, le souvenir marquant d’États primitifs ne m’a jamais quitté : nourrissant de longue date l’envie d’y revenir, le second volet de la trilogie phare d’Alec Covin se dévore de fait avec gourmandise, non sans souffrir de la comparaison avec son prédécesseur.
Un parallèle émergeant d’abord à l’aune de leurs différences fondamentales, le présent roman s’arrogeant une dimension urbaine que n’avait pas son aîné, lui qui élisait domicile dans la campagne louisianaise. Partageant toujours une même mythologie et un goût prononcé pour l’épouvante, cette suite délaisse toutefois les affres de personnages du commun pour mieux embrasser la dimension politique, historique et (aussi) philosophique de son univers, lequel engendre ici un thriller fantastique palpitant à souhait.
Dans l’immensité New-Yorkaise, États primitifs lie ainsi le phénomène, au demeurant isolé, de Tusitala au complot de plus grande envergure ourdi par les Loups et leur damné général, manipulant et massacrant dans l’ombre à ses fins de domination. Par l’entremise de sa palette de protagonistes luttant contre un adversaire surpuissant, le récit approfondit le poids de l’Histoire et les motivations du général sudiste, déterminé à prendre sa revanche sur les États-Unis : cela est notamment permis (de façon commode) par les Stevenson, dont la matriarche est une experte de la guerre de Sécession, tandis que la connue Sarah Wildar fait le lien entre les événements de Tusitala et ses nouveaux comparses.
S’instaure ainsi un effréné jeu de piste et d’échanges secrets, Tim et compagnie s’échinant à lever le voile sur les manigances occultes des Loups. Du Sénat au FBI, ou plus largement le gratin capitaliste des lieux, États primitifs déploie une envergure autrement plus ambitieuse mais, par voie de conséquence, davantage risquée. Covin semble en effet moins en maîtrise avec sa galerie étendue de personnages secondaires et tiers, ses réflexions sur l’anarchie, le nihilisme et autres joyeusetés complexifiant un récit déjà dense : et puis, le fameux tour de force final n’a pas le même impact, sans que cela n’est trait au fait de savoir.
La trahison est à ce titre rondement menée, certes, cependant elle souffre d’une crédibilité moindre faute de subtilité (dans le discours et ses révélations du moins). Dommage car l’effet est donc bel et bien diabolique, dans la droite lignée de la cruauté sans borne de Loups se jouant de leurs agneaux... surtout ceux qui oseraient se rebeller. Le dénouement, qui évoque puissamment la détresse des Baldwin ou de Stanley Holder, fonctionne ainsi malgré tout, à tel point que nous ne pouvons quitter États primitifs qu’avec un goût amer en bouche... dans le bon sens du terme.
Le roman marque donc les esprits, surtout lorsque le cauchemar prend forme : la séquence du restaurant tout particulièrement, horrifique de façon primale, mais aussi celle du chalet, quoique plus pénible à subir (c’est le mot). Reste un ensemble ambitieux mais perfectible, voire parfois décevant (10-13 tient du pétard mouillé), et les nombreuses interrogations que soulève le prochain et dernier opus : Le général Enfer parviendra-t-il à ses fins ?