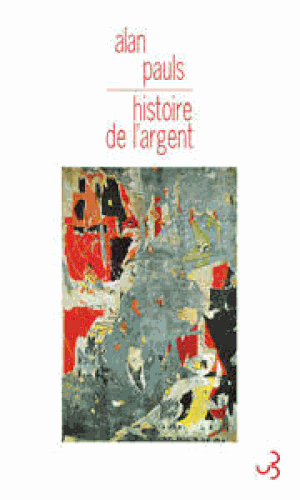Alan Pauls, écrivain né en 1959, était un enfant en cette période troublée des années 1970 en Argentine, comme le héros du livre, un jeune garçon à l’acuité extrême frappé par l’énigme de l’argent.
Au début du roman, l’enfant, alors âgé de quatorze ans, voit arriver dans la maison de son beau-père le cadavre d’un ami de la famille, mort dans un accident d’hélicoptère alors qu’il emportait une mallette pleine d’argent dans une puissante entreprise sidérurgique touchée par un conflit syndical, un argent obscur censé dénouer la situation, capable de tout résoudre ou de tout faire exploser. Pour l’adulte se remémorant cet événement des années plus tard, la présence du cadavre, et la disparition de la mallette, étrangement volatilisée dans le crash, semblent être une parabole de l’obscurité et l’irrationalité de l’argent.
«À présent, avec le visage du mort si près de lui, rattrapé par l’onde de choc du craquement des crostines, il ne peut éviter de se demander combien d’argent il y a, en vérité, dans l’attaché-case dont on n’a aucune nouvelle lorsque les plongeurs de la préfecture découvrent l’hélicoptère et les corps au fond de la rivière, combien d’argent et surtout pourquoi on charge le mort de transporter cet argent en personne jusqu’à l’usine de Zárate ; est-ce pour payer le dessous de table que la police a exigé pour exécuter l’ordre de réprimer les ouvriers, ordre que le patron a négocié avec les autorités locales de la force publique, ou pour amadouer les ouvriers avec une augmentation qui les détournera des revendications radicales auxquelles les pousse la fraction rouge de la direction syndicale, qui joue à tout ou rien, ou directement pour suborner la fraction rouge de la direction syndicale et résoudre toute l’affaire en évitant un bain de sang ? Mais ce qu’il aimerait à présent, c’est pouvoir se souvenir du prix du voyage jusqu’à Villa Gesell, en taxi. Mais ce n’est pas le cas : le blanc est total. Il sait, malgré tout, que c’est la première grande quantité d’argent dont il prend conscience, ou la première fois qu’il a conscience que l’argent peut être une quantité. Jusqu’à présent, c’est quelque chose de petit, de portable, une chose parmi d’autres, néanmoins touchée par une petite baguette magique très archaïque – si archaïque que les quelques personnes qui l’ont vue en action en sont mortes – qui lui confère le pouvoir de s’approprier d’autres choses, de les manger, le même pouvoir que possèdent ses propres pièces contre les pièces adverses et vice versa, ainsi qu’il le découvre par la suite devant un échiquier, dans la salle à manger de l’hôtel des Croates auquel il rêve en se rendant en taxi, à Villa Gesell.»
L’histoire de l’Argentine des années 70, celle de la lutte armée et de la violence d’état, n’est ici qu’un arrière-plan. La grande histoire est présente avec la démence inflationniste, contexte à cette histoire d’une famille de la classe moyenne. «Histoire de l'argent» est surtout le récit du rapport intime, de la passion spécifique ou bien de la souffrance que génère pour chacun le rapport à l’argent, et la peur de ne plus en avoir : pour le père magnifique, passionné de nombres, de calcul et de jeu de cartes et de poker, pour la mère, héritière aride et pingre dont on ne découvre réellement le rapport à l’argent qu’à la toute fin du livre, et enfin pour l’enfant tentant de déchiffrer le pathos de l’argent, le délire de ces nombres qui loin de rationaliser l’émotion l’amplifient en folie multiforme, filtre à l’aune duquel se mesurent la mort, l’amour, la vieillesse et la vie.
«Mais compter, en plus, au sens de l’action physique, comme lorsque l’on dit compter des billets, est quelque chose qui le saisit depuis qu’il est tout jeune, une fois qu’il a un après-midi libre et accompagne son père lors de son périple au centre-ville, où celui-ci travaille, et qu’il le voit encaisser des chèques dans les banques, payer des billets dans les compagnies aériennes, acheter ou vendre des devises étrangères dans les bureaux de change, et qui le saisira toujours, jusqu’aux derniers jours lorsque, quarante-deux ans plus tard, à l’hôpital, un peu avant l’infection pulmonaire qui va le condamner au masque à oxygène et à l’intubation, son père choisira dans une liasse déjà considérablement écornée, les deux billets de cinquante pesos qu’il a décidé de donner comme pourboire «avant qu’il ne soit trop tard», comme il le dit lui-même, à l’infirmière du matin qui, à sa grande surprise, lui parle allemand tandis qu’elle lui change la sonde, lui fait un piqûre ou lui prend la température. Personne n’arbore un tel aplomb, une telle efficacité élégante et hautaine, qui transforme le fait de payer en une action souveraine et fait oublier le caractère de réponse, toujours secondaire, qu’il possède en réalité. »
Après «Histoire des larmes» et «Histoire des cheveux», ce dernier volume d’une trilogie, dont chaque volume peut se lire indépendamment, est un roman éblouissant par la longue phrase d’Alan Pauls, cette phrase héritière de Proust, hypnotique, sinueuse et truffée de sens, capable faire toucher du doigt en seulement quelques lignes l'écart des perceptions humaines, comme Juan José Saer l'avait fait superbement dans «Glose», et d'embrasser tout l’espace entre naissance et mort.
Retrouvez cette note de lecture sur mon blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2016/01/08/note-de-lecture-histoire-de-largent-alan-pauls/
Pour acheter ce livre à la librairie Charybde, sur place ou par correspondance, c'est par là :
http://www.charybde.fr/alan-pauls/histoire-de-l-argent