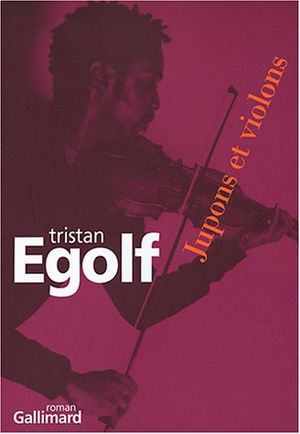Jupons et Violons, quand on considère le Seigneur des porcheries comme un chef-d’œuvre et Kornwolf comme un des meilleurs inachevés jamais publiés, c’est toujours bon à lire. Et comme ça, je peux dire que j’ai lu tout Tristan Egolf. (Tiens, d’ailleurs, Jupons et Violons fait allusion au Seigneur des porcheries : « une ville dans le Kentucky se souvenant d’une grève du ramassage des ordures. ENFER BOUSEUX, disait le titre » d’un journal feuilleté par le héros, p. 108. Je relirai Kornwolf en cherchant des références au Seigneur.)
Le Seigneur des porcheries, c’était un violent de la catégorie poids lourds : il feint d’abord de rester à distance de l’adversaire – sur l’identité duquel je reviendrai peut-être un de ces jours –, puis lui démontait la mâchoire, le nez, les dents et l’arcade en une volée de directs du droit. Le George Foreman de la littérature états-unienne. Ce roman-ci, c’est autre chose : un genre de poids léger qui ne se laisse pas toucher et enchaîne jab sur jab, sans accorder le moindre répit à son adversaire, faisant pleuvoir un déluge de coups qui encaissés un à un ne feraient pas mal mais dont la répétition laisse groggy.
Cela dit, les deux boxeurs sont de la même écurie…
Mais un mot de l’« histoire », tout de même. Elle se passe probablement vers 1990 probablement à Philadelphie, rebaptisée « Philordurie » pour l’occasion – on pense au « Pennsyltucky » de Kornwolf. Charlie Evans et Tinsel Greetz sont deux losers, deux types à côté de qui le Jay et le Silent Bob de Kevin Smith ressemblent à Rocard et Balladur. Ils vivotent d’expédients, comme on l’écrivait dans les traductions de romans des années 1930 : parasites sociaux, peintres par contrainte, dératiseurs à l’occasion, l’un violoniste amer, l’autre « principal anarchiste de bazar, bandit et saboteur du quartier, […] qui se voit en Boxcar Willie des temps modernes, hargne incluse, […] qui incendie les gars ordinaires, les traitants d’esclaves des conventions parce qu’ils ont un boulot » (p. 26)… Au lendemain d’un passage à tabac (« Je ressemble à une tranche de foie pourrie », p. 105), ils rencontrent une certaine Louise : « Française, c’est sûr. / Elle conduit comme une tarée » (p. 137). Jupons et Violons est donc l’occasion de passer au lance-flammes – ou à la mitrailleuse, ou au laminoir, ou à tout engin destructeur qu’on voudra – ces États-Unis pseudo-civilisés, ou plutôt pseudo-raffinés : si dans le camp des personnages principaux quelqu’un pue, cette puanteur-là n’est que physique.
Mais en chaque romancier, paraît-il, un sarcastique et un lyrique cohabitent…
Bien sûr les scènes les plus marquantes de Jupons et Violons sont écrites par le premier : un concert inaugural qui tourne au pur fiasco, une chasse aux rats clandestine dans les égouts, un dîner dans un restaurant de luxe, le sabotage en règle d’un tournage de film… (On pourrait ajouter d’autres scènes, et peut-être même tout le récit. Aucune cependant n’atteint les sommets du match de basket dans le Seigneur des porcheries.) Mais le narrateur, à la différence de John Kaltenbrunner et d’Owen Brynmor, tombe amoureux, et il a un ami. Et c’en est presque émouvant. Le lyrisme est bel et bien là – ce lyrisme picaresque qui fait bafouiller le clochard devant la belle, et qui le fait hésiter entre amour et amitié.
Oui, un passage comme « “Oui.” Je me cramponne. “Mais, tu sais, je ne suis qu’un…” Lâche “Dans un élément…” À côté de mes… “pompes, je veux dire : hors de mon élément. Pas habitué à ce genre de …” / – Quoi ? hôtel ? / – Ouais.” C’est ça, accuse le bâtiment. “Enfin, pas exactement… Je veux dire, je vis dans un hôtel” – merdeux – “moi-même. Mais pas comme… Comment dire ?” Xanadu. “Pas comme… / – Celui-ci, acquiesce-t-elle en regardant à l’entour. Je sais.” » (p. 115), un tel passage, disais-je, il faut pour l’apprécier avoir déjà bafouillé des trucs incompréhensibles et fait n’importe quoi devant la Louise qu’on aimait et dont on venait de découvrir qu’elle nous aimait aussi sans qu’on comprenne pourquoi, tout cela non pour l’impressionner mais par pure timidité. Avec une pointe de paranoïa en plus, pour aider…
Et on goûtera d’autant plus Jupons et Violons qu’on aura déjà eu – à l’adolescence ou pas, et qu’on a déjà peut-être encore – comme véritable ami, sincèrement, un pur tocard, capable de brailler « COROLLO ENCULE LES MOUTONS ! » (p. 188) au mégaphone par la fenêtre d’une chambre d’hôtel, un mythomane têtu, maladroit, contrariant et alcoolique, un type dont l’« odeur n’est pas nécessaire. […] Elle est palpable » (p. 140), un tocard authentique dont la spécialité consiste à susciter catastrophe sur catastrophe avec les meilleures intentions du monde – mais avec qui « chaque fois qu’on est ensemble, il se passe quelque chose » (p. 167).