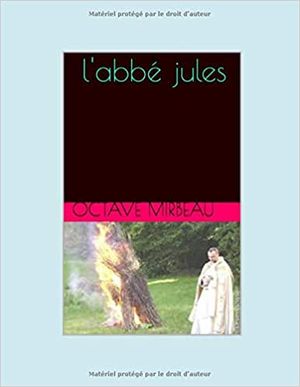Il faut régulièrement s’éloigner un peu de notre époque pour « prendre du recul ». Il faut se ressourcer régulièrement en lisant ou en relisant ceux qui savaient écrire, qui avaient encore une haute estime de la langue française. Même les meilleurs romans modernes ne peuvent égaler cette force de la langue utilisée par des Bloy, des D’Aurevilly, des Mirbeau. Ils avaient tout compris de leur époque qui portait la nôtre en germe.
Car le style vient de l’esprit. Et ils n’en manquaient pas.
La beauté de leur langue vient de leur regard acéré sur l’évolution d’une société malade de sa civilisation et s’écroulant tout doucement. C’est une beauté désespérée.
Le personnage de l’abbé Jules porte en lui toute la révolte, toute la violence et l’extrême pureté de l’esprit libre de son auteur. Personnage complexe, tourmenté, tour à tour haineux et d’une extrême bonté, il apparaît comme une sorte d’anarchiste à la recherche d’un improbable idéal, un asocial sans concession envers les mesquineries de ses congénères mais inconsolable de ne pouvoir trouver la pureté qu’il peut concevoir sans jamais l’atteindre.
Tourmenté par ses aspirations contraires, tiraillé entre la puissance de ses instincts refoulés par une éducation étouffante de médiocrité et son amour de la nature et de l’art, l’abbé fait tout le mal dont il est capable. Il tourmente un évêque trop faible et naïf dont il sera le secrétaire tyrannique et méprise sa famille auprès de laquelle il sera obligé de revenir vivre une fois renvoyé de l’évêché.
L’anticléricalisme de Mirbeau prend des accents violents : « Vous mentez tous !… Depuis une heure, je vous regarde… Et, à le voir porté par vous, je rougis de l’habit que je porte, moi… moi qui suis un prêtre infâme, qui ai volé, et qui vaux mieux que vous, pourtant !… Je vous connais, allez, prêtres indignes, réfractaires au devoir social, déserteurs de la patrie, qui n’êtes ici que parce que vous vous sentiez trop bêtes, ou trop lâches, pour être des hommes, pour accepter les sacrifices de la vie des petits !… Et, c’est vous à qui les âmes sont confiées, qui devez les pétrir, les façonner, vous dont les mains sont encore mal essuyées de l’ordure de vos étables… Des âmes, des âmes de femme, des âmes d’enfant, à vous qui n’avez jamais conduit que des cochons !… Et c’est vous qui représentez le christianisme, avec vos mufles de bêtes à l’engrais, vous qui ne pouvez rien comprendre à son œuvre sublime de rédemption humaine, ni à sa grande mission d’amour… Cela fait rire et cela fait pleurer aussi !… Une âme naît, et c’est dix francs… Une âme meurt, et c’est dix francs encore… Et le Christ n’est mort que pour vous permettre, n’est-ce pas, de creuser la fente d’une tirelire dans le mystère de son tabernacle et de changer le ciboire en sébile de mendiant… Mais, quand je vous entends parler de la Vierge, il me semble que j’assiste au viol d’une jeune fille par un bouc… »
Mais il dissimule mal une aspiration à une Eglise mieux servie, plus pure, à une foi véritable, lui qui demandera à son neveu, lors de sa longue agonie, de lui lire des pages de Pascal. Il connaîtra le vrai visage de la foi à travers le personnage haut en couleur de l’abbé Pamphile qui se livrera aux pires bassesses afin d’obtenir les fonds nécessaires pour reconstruire une petite chapelle au fond des bois où il vit en ermite, entièrement voué à son idéal : « Les choses, en harmonie avec l’état de son âme, revêtaient, sous leur tristesse infinie, des aspects de mystère physique et de grandeur morale qui le troublaient étrangement. Une vie qu’il ne connaissait pas, et devant laquelle il se sentait si petit, si laid, si misérablement lâche, si complètement indigne, une vie à laquelle il n’atteindrait jamais, ouvrait par les fentes des murailles, de larges horizons insoupçonnés, des espaces fleuris de fleurs de rêve, de belles fleurs au-dessus desquelles voltigeaient des âmes, des âmes d’enfant, des âmes de vieillard, des âmes de pauvres, de belles fleurs qui berçaient de toutes petites âmes mortes, au fond de leurs calices parfumés… Durant la route, une multitude d’idées confuses, sans lien direct avec ce qu’il avait vu et entendu, au Réno, se heurtèrent dans sa tête. Mais, toutes, elles le ramenaient obstinément au Père Pamphile, et du Père Pamphile au miracle des religions d’amour qui mettent tant de joies dans la souffrance, tant de sagesse dans la folie, tant de grandeur dans l’avilissement ; elles le ramenaient aussi à la douloureuse constatation de sa propre déchéance… Il avait beau chercher, dans sa vie, depuis le jour où la conscience s’était éveillée en lui, il ne retrouvait que des viletés et des hontes, avec de courtes échappées, de fugitives aspirations vers le bien, dont le seul résultat était de rendre ses rechutes plus lourdes et plus irréparables. Aucune foi, aucun amour, aucune passion même ; des instincts furieux de bête, des manies de déformation intellectuelle, et, avec tout cela, la sensation d’un vide intraversable, l’immense dégoût de vivre, l’immense effroi de mourir… »
Car ce qu’exprime ce beau et grand roman, c’est le combat d’une âme entre le Bien et le Mal qui souvent, prend le dessus. Ce mal qui s’exprime si bien à travers toutes les institutions qui pervertissent plutôt qu’elles n’élèvent : l’Eglise, la justice, l’éducation. C’est la haine envers abjection des hommes quand on peut cependant sentir qu’ils pourraient être autrement, plus innocents, comme ce jeune neveu de l’abbé, le narrateur, qu’il parviendra quand même à -mal- aimer.