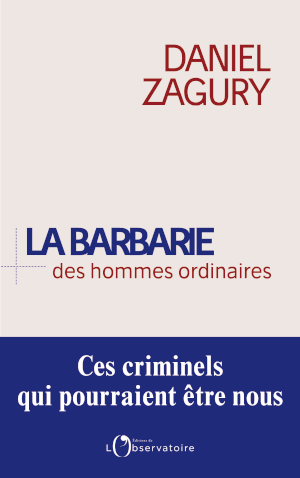Daniel Zagury met à profit son expérience expertale psychiatrique pour alimenter une réflexion sur les crimes commis par des personnes indemnes de toute pathologie mentale. Diverses catégories toutes plus riantes les unes que les autres sont ainsi structurées, des meurtres (maladroitement dits) passionnels aux néonaticides, en passant par les génocides, le terrorisme ou cet aparté moins sanguinolent sur l'emprise mentale à travers l'affaire hallucinante des reclus de Monflanquin (ce qui m'a d'ailleurs amené à ce livre).
J'ai d'abord été déçu en tant que professionnel par le peu de détail clinique des cas exposés mais la raison s'en fait vite comprendre car Zagury s'intéresse plus à l'élaboration des caractéristiques communes à ces différents crimes et à leurs auteurs, dans un développement sans cesse renouvelé (un brin répétitif ?) des distinctions à apporter entre le normal et l'ordinaire. Il s'empare du concept de la banalité du mal chère à Hannah Arendt pour l'articuler avec sa propre pensée et ainsi évoluer en équilibre sur le fragile fil qui sépare les deux visions extrêmes que sont la réduction des criminels à des monstres inhumains ou au contraire l'universalisation du crime, chacun d'entre nous pouvant à tout moment basculer (valence qui a ma préférence intuitive). Il parvient ainsi à faire émerger le caractère ordinaire de tels criminels, plutôt tristes et pathétiques, et bien loin des génies du mal fantasmés, mais également les failles psychiques qui feront le lit de la "barbarie" en titre. A ce sujet, Zagury insiste beaucoup sur le défaut de la pensée libre et du dialogue intérieur au profit d'un mode opératoire, excluant du champs réflexif tout grain de sable irritant (elle peut ne plus m'aimer, cette grossesse va aboutir à un accouchement, ce génocidé/cet infidèle est un sujet humain et non pas une chose à éliminer, etc.).
Autre élément fondamental : le processus de transformation physique qu'un contexte individuel ou collectif va autoriser pour permettre le passage à l'acte. C'est d'ailleurs sur le sujet du génocide que j'ai trouvé les illustrations cliniques véritablement glaçantes, avec cette absence, démontrée comme logique, de culpabilité post-massacre et cette pauvreté stéréotypée des explications apportées ("c'était l'époque qui voulait ça"). La tyrannie du groupe est en effet un vecteur qui nous échappe tellement en tant qu'individu qu'elle me terrifiera toujours. Bon, je ne peux pas non plus nier l'horreur qu'entraine la réflexion de Zagury au sujet des tueurs en série, mettant en avant non pas la jouissance des souffrances imposées aux victimes mais plutôt la jouissance de ne pas/plus ressentir d'émotions devant ces souffrances provoquées, preuve mégalomane de la toute-puissance psychique permettant de s'extraire de la condition humaine. Et vive la vie...
La barbarie des hommes ordinaires est donc une lecture assez morbide mais pour autant riche en réflexions intéressantes, d'autant plus que notre société connectée et médiatisée nous expose sans cesse à ces faits divers terribles qui débordent nos capacités de compréhension. Et pour les pris, la place de la psychiatre expertale et sa lutte plus ou moins active pour ne pas être instrumentalisée sont également évoquées.