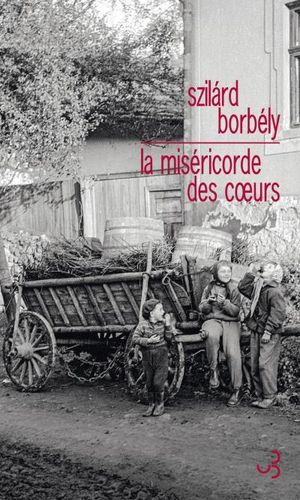Sauf que l’humour de Gary rend la misère supportable, l’ennoblit pour ainsi dire. Rien de cela avec Bordély : la misère est crue, violente, cruelle.
Un jeune enfant raconte sa vie dans un petit village de Hongrie, entre une mère malheureuse, courageuse et suicidaire et un père alcoolique, violent, et rejeté parce qu’il est le fils du seul juif rescapé du village.
Il y a deux manières de voir le peuple. Soit à force d’humilité et de compassion pour sa misère, on le voit grand, on l’idéalise. Soit il est vu dans sa terrible réalité, objectivement, comme dans ce récit au ton distancié. Car la misère rend l’homme cruel, mauvais et il est lui-même le premier et le plus sûr artisan de son propre malheur.
Le ton adopté est certes celui d’un enfant, mais pas haut en couleur et gouailleur comme Momo, un enfant qui, pour surmonter ses traumatismes, met tout à distance et devient pour survivre psychiquement, le bourreau des plus humbles que lui : les animaux. S’ensuivent des scènes difficiles de tortures d’animaux, image du rapport violent qu’entretiennent ceux qui n’ont presque rien avec les êtres dont ils doivent se nourrir ou qu’ils utilisent comme les chiens ou les chats : ils n’ont pas le temps ni intérêt à établir des rapports affectifs avec eux…
Cette cruauté est le miroir de celle qu’on fait subir aux hommes. Il y a des scènes terribles où le communisme triomphant veut emprisonner le pope du village. Ainsi, on voit l’annihilation lente mais radicale des symboles de la religion : « Puis un jour, ils ont appris sans indignation que la petite église en bois ramenée des hautes montagnes avait pris feu, on ne sait comment, et qu’au matin elle était réduite en cendres. Lorsqu’ils s’assemblèrent autour des cendres fumantes il n’y avait plus rien à éteindre ? Et il n’y avait non plus rien à raviver. » ( Folio p. 192) Et finalement, la religion disparait aussi des cœurs : « Le mystère se perd (…) quand on prive le peuple de mots » ( p. 187) . Une vague superstition et quelques traditions vidées de leur contenu subsistent à sa place.
Le mal, c’est aussi les souvenirs conservés par les vieux. Celui de cet épicier juif, insulté puis persécuté par les jeunes du village dans un crescendo inexorable. Le vieux est revenu brisé et muet des camps, sans sa femme ni ses enfants, et ses biens ont été volés jusqu’au plus petit objet, sa maison vidée morceau par morceau, par ces habitants qui lui devaient de l’argent ; ce vieux juif n’est plus bon qu’à vider les latrines pour gagner sa subsistance - et à servir de défouloir aux hommes. A l’image du ton adopté dans ce roman, il montre qu’à un certain degré de misère, l’anesthésie est le seul moyen de survivre.
Il y a les tziganes traités comme des pestiférés, les vieilles femmes sans enfants qui vont terminer leurs jours dans des mouroirs, les paysans propriétaires d’avant le communisme qui « n’ont rien à faire ici. Les bâtards de koulaks peuvent bien crever avec leurs gosses. Celui qui sème la discorde, à qui rien n’est assez bon et qui ne respecte pas les autorités, celui-là, on n’en a pas besoin. Ici, on construit le communisme, on n’a pas besoin des réactionnaires de l’ancien monde. » ( p.227) Et ces amis du peuple privent de travail le père du narrateur dont le petit frère meurt de misère avant d’atteindre sa première année – mais maintenant, il dort mieux, il ne l’entend plus pleurer dans la pièce où vit entassée toute la famille…
Plus je découvre la littérature hongroise, plus je suis happée par sa violence, sa puissance. Celle des peuples qui ont beaucoup souffert…
Köszönöm à Eric pour cette découverte!