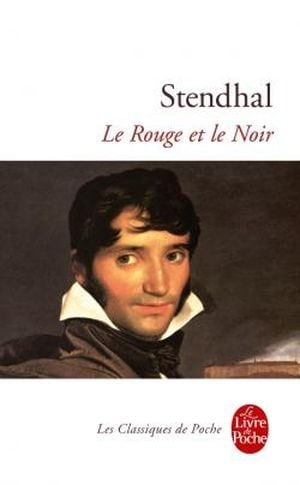Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous pousse à lire Le Rouge et le Noir ? Avant tout son statut de classique : on l'aura lu pour l'école, ou par curiosité, poussé par une volonté de collecter un savoir qui s'approcherait de l'encyclopédique... ou simplement parce qu'amis et artistes nous l'auront maintes fois vanté. Mais quoi encore ? à quoi tient cette réputation ?
Le Rouge et le Noir, de son sous-titre Chronique de du XIXè siècle est un roman de la Restauration. Au fil de l'intrigue, c'est une peinture de la société et des ses mœurs politiques qui est brossée : M. de Rênal, premier marchepied vers le monde pour Julien, est le symbole de la noblesse provinciale entreprenante et ultra, en constante rivalité avec les Valenod, libéraux non moins provinciaux ni entreprenants ; la famille de la Mole et sa clientèle, qui déclinent les figures de l'aristocratie parisienne et des élites cléricales qui les entourent, etc. En ces dernières années de la monarchie des Bourbons, la société se ferme et ralentit autour d'une noblesse encore marquée par les secousses révolutionnaires et impériales, nostalgique comme son monarque d'une ancienne monarchie, glorieuse, sans la charte libérale de Louis XVIII.
C'est cette société-là qui engendre la naissance de Julien Sorel, roturier révolté, produit inéluctable de cette société atrophiée. Un personnage finement ciselé par Stendhal qui fait ainsi disparaître tout hiatus entre fiction et réalité. L'intérêt historique de ce monument du réalisme est démontré (plus par les critiques littéraires que par ma rhétorique limitée, j'en conviens). Mais, pour celui qui ne sera pas curieux de la société d'antan et de ses mœurs fanées, pour celui qui cherchera dans ses lectures une connaissance plus intime, quoi de si grand dans Le Rouge et le Noir ?
Julien n'est pas un personnage verrouillé dans son époque ; son aventure échappe à la temporalité, devient universelle (mais non pour autant archétypale). Souvent présenté en icone de l'ambitieux hypocrite, son caractère se voit en vérité, au cours de l'avancée dans le monde, considérablement changé. Dans un premier temps «petit hypocrite» quand il vaque aux alentours de la famille Rênal, Julien a lancé un défi à la société – celui d'un ambitieux, ou plutôt d'un héros qui accepte de se mettre au ban de la société pour affronter son sort sans crainte ni regret.
En effet, sur les bases que sont cette ambition et cette hypocrisie sourdent des traits de caractère d'un romantisme tout différent de ceux de Chateaubriand ou de Lamartine, dénué de leur lyrisme, tourné vers l'individu, l'énergie, et des passions puissantes. Le petit Machiavel qu'est Julien montre assez tôt qu'il n'est pas un simple arriviste, lorsqu'il se retrouve face aux véritables âmes basses, cauteleuses et vulgaires des séminaristes. Le dernier acte transcende ce grand caractère : la remontée dans les grandioses vallées franc-comtoises (qu'un magnifique incipit fait fleurir dès l'orée du roman), un crime mû par la passion, l'enfermement dans un haut donjon où le héros,
(puisqu'il faut désormais l'appeler ainsi) prend conscience de son véritable soi... Julien Sorel est un être de tous les temps, un être mythique.
Encore Le Rouge et le Noir filtre-t-il, dans quelques élans, le romantisme bouillonnant de son époque – c'est en 1830 que déferle, symbole, Hernani : Verrières s'éveillant au chant des scies, Julien échappant à ses fantômes qui l'entravent quand il conquiert les hauteurs jurassiennes, la vision éthérée de la dernière bénédiction de l'amante... Je ne m’attarde pas sur les croisements qui s'opèrent avec les personnages forts : Mathilde de la Mole et sa mélancolie romantique, l'abbé Chélan dans son effacement, le spectre de Napoléon... C'est que le premier chef-d'œuvre de Stendhal, grâce à un style sec porteur de ce que l'on pourrait appeler un réalisme "objectif", laisse une grande part au travail de reconstitution de l'expérience propre par le lecteur.