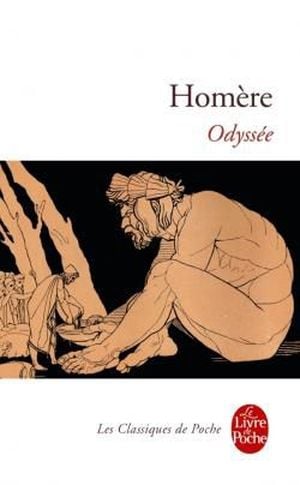Il est si loin de ses parents, le héros aux mille ruses ! Ilion détruite, – puisse son nom périr après elle – il s’en revenait sur la mer infertile ; mais les Immortels peuvent tout, et leur colère à son encontre est irrévocable. Il a perdu sa maison, Ulysse, ce roi perdu, inconnu de son fils, loin de son épouse, oublié même de sa jeune noblesse qu’il prenait pourtant jadis sur ses genoux, afin de l’éduquer et de la nourrir tel un père. Il a perdu sa modeste maison, un rocher aride, bon seulement pour les chèvres, Ithaque, cette racine de laquelle il extrait toute sa vigoureuse sève.
L’Odyssée n’est peut-être pas tant ce récit de voyages mythique, mais avant tout une ode au sol maternel, la complainte d’un exilé. À travers toutes ses errances, Ulysse n’a d’yeux que vers sa maison, si humble soit-elle ; c’était pour sa gloire et sa richesse qu’il était parti autrefois épauler au combat les autres Achéens, à Troie. Face à la grandeur des luttes de l’Iliade, si la constance d’Ulysse ne triomphe pas moins puissamment, l’Odyssée prend un visage tout autre : elle se voue à la terre, aux oliviers noueux mais robustes, aux sillons riants que bêche un Laërte mélancolique et prosterné.
« Ton père vit aux champs, sans plus descendre en ville. Il ne veut pour dormir ni cadre, ni couvertures, ni draps moirés : l’hiver, c’est au logis qu’il dort, parmi ses gens, près du feu, dans la cendre, et n’ayant sur la peau que grossiers vêtements ; mais quand revient l’été, puis l’automne opulent, il s’en vient tristement, se faire un lit par terre, des feuilles qui, partout, ont jonché le penchant de son coteau de vignes. Le chagrin de son cœur va toujours grandissant, et son triste désir de te savoir rentré, tandis qu’avec ses maux, la vieillesse lui vient. »
(XI, 180-204)
Ce n’est pas un hasard si les compagnons d’Ulysse, chez les Lotophages, endurent l’une des plus périlleuses épreuves : ces derniers, peuple iréniste, vivent loin de tout échange humain ; ils tirent leur nourriture du Lotus, ou fruit du jujube, psychotrope dissolvant ces chagrins qu’endurent les marins sous le joug des dieux, mais effaçant par là-même la mélancolie de leur patrie. Loin d’elle, les souvenirs de leur terre maternelle s’estompent. Les braves guerriers en perdent pour ainsi dire toute amarre, et, s’ils trouvent enfin le délassement, leur âme s’égare, épave sur la mer ingrate. Les véritables héros sont ceux qui comprennent cet attachement profondément humain qu'il s'agit de maintenir vibrant.
Ainsi Ulysse sur l’île de Calypso. Hermès lui-même, le messager des dieux, marque un arrêt devant la grotte de la nymphe magnifique : au fond d’un sous-bois aux effluves de pins et de thuyas pétillants s’ouvre une grotte d’où s’écoulent quatre sources parfaitement disposées. En son sein y tisse et chante la plus douce des femmes, servante d’Aphrodite ; on y boit le nectar et l’Ambroisie, la liqueur des Immortels. Mais le héros d’Ithaque est absent. Il sanglote sur la sèche grève, ses yeux brouillés des embruns de la mer sont rivés sur un horizon indécis. Charybde, Scylla, Kikones, Polyphème, Arès… ces antres humides et leurs périls n’ont pas abîmé l’âme d’Ulysse ; c’est qu’il doit rentrer chez lui.
Les chants successifs de l’Odyssée modulent un nouveau thème, concomitant : celui de l’hospitalité. Dans la Grèce antique, les voyageurs qui partageaient pour un soir le banquet et le logis de leur hôte, divisaient à leur départ une pièce métallique en deux : le σύμβολον. Chacun en conservait une moitié, l’ami (φίλος) et l’étranger (ξένος), en dévotion aux années futures. Le sou divisé constituait alors une marque de reconnaissance, mais aussi de garantie : dans le besoin, celui qui avait autrefois accueilli saura trouver secours chez le nécessiteux d’autrefois. Aux retrouvailles, ils ressouderont leur pièce en une alliance de deux foyers.
Le périple d’Ulysse et les premiers voyages de Télémaque dressent une galerie de bons et de mauvais hôtes. Si Ulysse doit subir la fureur de Poséidon, c’est parce qu’il a blessé le fils de l’Ébranleur des terres ; et s’il s’est retrouvé pris au piège dans la tanière de Polyphème, c’est qu’il s’était présenté chez le Cyclope sans pudeur, insolent, lui réclamant un don indu. Les prétendants quant à eux sont l’archétype des hôtes exagérés, qui violent la maison du maître absent, le trésor le plus précieux de son Sang.
À l'abord du vaste texte, la réappropriation et l’expérience personnelle sont essentielles pour le nouveau lecteur, mais le contexte originel de l’œuvre – ainsi que son aura de texte fondateur – sont difficilement oubliables. D’ailleurs, le style et le rythme du récit épique respirent d’un certain archaïsme, en tout cas d’une ancienneté, d’un vocabulaire et d’une vision du monde qui ne sont plus les nôtres. Ce "style formulaire", appellation qualifiant cette écriture qui fait sans cesse resurgir de longs noms, voire de longs éléments de récit identiques, prend des accents incantatoires.
À ma première lecture, il m’avait paru une parfaite invocation à un âge ancien. « Athéna, la déesse aux yeux pers », « les bœufs à la démarche torse », et surtout « l’Aurore aux doigts de rose ». J’entendais presque ces aèdes anciens, qui modulaient leur chant sur ces vers appris comme autant de légendes anciennes. Deux ans plus tard, dans une nouvelle lecture, je n’ai pas su éveiller cette sensibilité-là : les expressions m’ont parues galvaudées, répétitives, assommantes. Il faut dire que des pans entiers du récit sont répétés presque mot pour mot, et parfois à plusieurs reprises ; et l’on ne compte pas le nombre de banquets, dont le déroulement est systématiquement filé avec les plus grands scrupules d’exhaustivité.
Mais, à la fois, ces innombrables – et interminables – banquets constituent l’aliment de l’attachement à la terre-mère. Ils en donnent l’odeur, la saveur, et la couleur : tons safranés du réfectoire, brûlure des vins aux feux sombres fleurant le miel, âcre senteur des victimes calcinées en sacrifice aux dieux. Le style même de l’Odyssée œuvre comme un potier sur l’argile : il tourne sa mélodie, la module, lui donne sa rondeur et ses doux échos. Quand le navire d’Ulysse boute bel et bien sur les plages d’Ithaque, le goût des embruns demeure au coin des lèvres.
Il devient là difficile d’analyser l’Odyssée d’Homère comme une œuvre banale. Sa portée est trop immense pour cela. Elle a trop ensemencé, mère de tant de mythes et de thèmes littéraires (on pourrait analyser chaque œuvre au jour de l’Iliade et de l’Odyssée, certains s’y sont parfois essayés) pour que l’on puisse la considérer comme une œuvre achevée, un édifice clos. Tout au contraire, l’Odyssée est un livre, un chant ouvert, qui en a modulé des centaines d’autres, et qui revêt des tonalités différentes au creux des générations successives qui tâchent de s’y plonger, un chef-d’œuvre intemporel qui sait charmer tant les aventuriers que les déracinés, amoureux de leur domicile perdu – a-t-il jamais existé ? – dont regorgent les sociétés d'aujourd'hui.
Lu dans la traduction de Victor Bérard, désormais ancienne et parfois trop chargée, mais qui a le mérite de donner au texte son rythme originel.
Ce texte constitue une refonte complète d'une première critique datée d'août 2018.