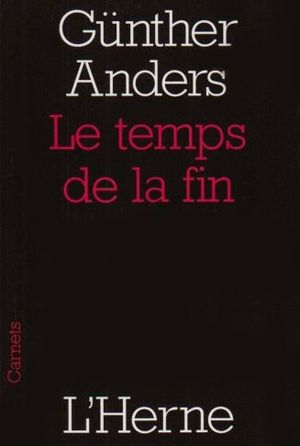« Du genre des mortels, nous sommes devenus le genre mortel. »
Qu’implique pour l’humain d’aujourd’hui de vivre dans un monde où il sait que son espèce peut s’éteindre à tout moment ? Réflexion on ne peut plus contemporaine avec la catastrophe écologique, même s’il n’y a pas cet aspect de quasi-immédiateté dans l’extinction. Ce qui est important est l’idée que la fin est possiblement à venir.
Notre temps permet désormais d’imaginer le « non-être » de manière beaucoup plus concrète qu’auparavant, c’est-à-dire d’imaginer un monde où il n’y aurait plus de futur pour penser le passé, puisque les humains du futur auraient également disparu.
Günther Anders pose aussi la question de la disparition de la méchanceté et de la moralité puisque la loi de la technique est : plus grands sont les effets, plus petite est l’intervention de l’homme. Il y a des catastrophes décidées par des hommes, mais sans haine. Dans ce cadre, existe-t-il encore des « actes » ? Par cette idée, l’auteur rejoint - possiblement - L. Goldmann qui estime que depuis l’avènement du "capitalisme d’organisation" (capitalisme plus ou moins auto-régulé d'après 1945), l’implacabilité des lois économiques retire de la responsabilité et de l’initiative aux travailleurs. Il y a cette idée globale de déresponsabilisation, d’automatisation inhumaine. G. Anders voit plutôt la technique comme la cause de cela tandis que L. Goldmann insiste sur les lois économiques capitalistes. Les deux causes doivent probablement interagir et se rejoignent dans les conclusions qui en sont tirées sur nos sociétés contemporaines.
Hiroshima et Nagasaki ont manifestement été d’une importance capitale pour la pensée de l’auteur, mais aussi pour celle de Hannah Arendt dont il a été le premier époux. Tous les deux sont des disciples de Heidegger.
Plus loin, l’auteur fait un parallèle entre l’attente de la parousie dans le christianisme et l’attente de la guerre nucléaire totale ; dans les deux cas, il y a « délai » et non « époque ».