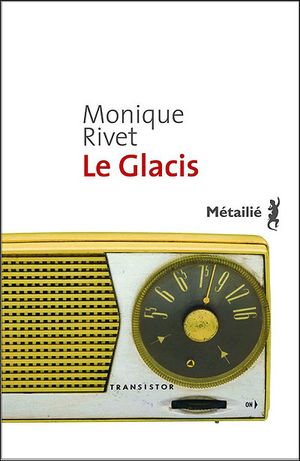Jeune parisienne d’une vingtaine d’années, Laure Delessert est nommée professeur de lettres dans la ville fictive d’El-Djond en Algérie au milieu des années 1950.
À El-Djond dans cette période trouble, la partition géographique des communautés est matérialisée par le glacis, «une large avenue coupée d’un terre-plein et bordée, côté indigène, d’une rangée de boutiques arabes» qui divise la ville en deux parties. Profondément choquée par cette ségrégation, Laure refuse de rester du côté du glacis qui devrait être le sien.
«L’homme se redressa lentement. Il regardait les rues qui s’ouvraient devant lui en longs rayons noirs. Puis il se mit en marche. Il se dirigeait vers le glacis. Au-delà c’était ce qu’on appelle le village nègre. Des barbelés zigzaguaient dans la lumière de la lune.»
Personnalité étonnamment libre de ses mouvements et de ses pensées pour l’époque, et ignorante du contexte dans lequel elle plonge, Laure Delessert découvre en y étant confrontée le racisme envers les arabes, les juifs ou les espagnols, les brimades, vexations, la violence qui enflamme le pays et la ségrégation radicale entre européens et algériens. Happée malgré elle dans ce conflit, se liant avec Felipe, un Républicain espagnol installé en Algérie à la fin de la guerre d’Espagne, elle découvre peu à peu que ses paroles ou ses actes peuvent gravement lui nuire, et la gravité des menaces qui pèsent sur elle.
«Je comprends que je ne suis pas au Quartier Latin, Elena me le rappelle sans cesse, mais dans une petite ville de province ou les mœurs sont encore celles du XIXe siècle, je comprends aussi que s’y ajoute une ségrégation des communautés que prétendent nier ou combattre des slogans officiels bien tardifs et de toute façon émis à une distance sidérale de la réalité. Et en même temps, c’est vrai, je ne comprends pas, parce que je n’éprouve rien de tout cela, parce que moi aussi je suis à cette distance sidérale où rien d’autre n’est visible que des figures abstraites, où rien n’est perceptible des passions qui habitent ces figures.»
Écrit à la fin des années 1950, et publié seulement en 2012 par Métailié après son remaniement par Monique Rivet, ce roman qui s’inspire de sa propre expérience d’institutrice à Siddi Bel Abbès frappe par sa justesse, pour communiquer la tension extrême qui couve, les confrontations muettes et les explosions de violence, pour raconter le début de cette guerre que les français se refusent à nommer, parlant – et ce fut longtemps le cas - des «événements».
«-Tout est calme ?
-Très calme.
Très calme en effet. La nuit nous ouvrait ses portes étincelantes d’étoiles, comme toutes celles qui avaient couvert de leur splendeur les crimes et les assassinats d’autrefois. Quel assassinat, quel crime la nuit d’El-Djond cachait-elle pour nous dans ses plis ?»
«La guerre. Bien sûr que leurs événements, c’était la guerre. Je la reconnaissais au rythme qu’elle donne à la vie, à sa disparate, ses à-coups, sa façon de s’évanouir comme si elle n’avait jamais existé et de réapparaître comme si elle était notre état naturel. Nous ne l’avions pas laissée derrière nous, elle était là.»
Retrouvez cette note de lecture, et toutes celles de Charybde 2 et 7 sur leur blog ici :
https://charybde2.wordpress.com/2015/04/06/note-de-lecture-le-glacis-monique-rivet/