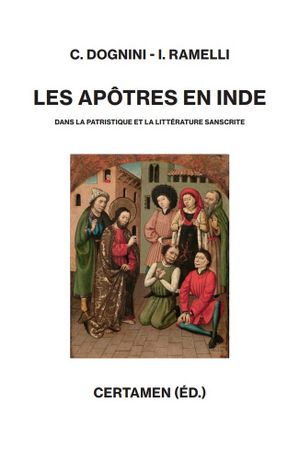Après plusieurs mois, j’ai enfin pu m’attaquer aux Apôtres en Inde dans la tradition patristique et la littérature sanscrite, qui autant l’annoncer d’emblée, est un livre exigeant. Ma compagne (qui fait tout pour m'arracher aux jeux vidéos) me l’avait offert quasiment à sa sortie, mais très vite j’avais compris que ce serait une lecture de vacances.
Cet ouvrage, comme l’indique son titre, traite de l’évangélisation précoce de l’Inde durant l’Antiquité, qui est examinée à travers les sources antiques (chrétiennes et indiennes), mais également à travers l’archéologie et l’historiographie moderne, et l’étude des liturgies orientales. Les auteurs sont deux professeurs d’université italiens : Ilaria Ramelli (une antiquiste de renommée internationale), et Cristiano Dognini (un sanscritiste et antiquiste). Tous deux sont les élèves de la grande historienne italienne Marta Sordi, dont j’ai chroniqué ici un excellent ouvrage.
LE POSTULAT DE DÉPART
Les auteurs constatent que l’historiographie moderne retient que les premiers contacts entre l'Inde et le christianisme ont eu lieu sous Constantin. Mais, observent-ils :
- les contacts entre l’Occident grec, puis romain, sont beaucoup plus précoces que Constantin, et ont atteint par moment une intensité surprenante.
- la patristique, ainsi que les chroniques et géographes chrétiens, qui sont d’ordinaire considérés comme des sources historiques généralement valides, évoquent de manière récurrente une chrétienté indienne plus ancienne.
En effet, malgré de forts éléments légendaires tardifs focalisés sur les figures des Apôtres Barthélémy et Thomas, qu’il est facile d’isoler, la tradition chrétienne antique semble receler des indices sérieux en faveur de l’historicité, ou du moins de la vraisemblabilité d’un élan évangélisateur précoce vers l’Inde, dès le Ier siècle. Le point nodal de l’ouvrage, en réalité, se trouve dans le témoignage de Pantène d’Alexandrie, qui affirmait être parti en mission en Inde à la fin IIe siècle, et y avoir rencontré des communautés chrétiennes préexistantes à sa venue, lesquelles possédaient un évangile de Matthieu archaïque « écrit en lettres sémitiques ».
Les auteurs s’attachent à examiner la plausibilité d’un tel témoignage : dans quelle mesure une évangélisation précoce aurait-elle été possible ? Par quels canaux et quels relais ? Peut-on identifier cet évangile sémitique archaïque et que nous enseignerait-il de cet éventuel christianisme indien primitif ? Comment inscrire cette éventuelle vague d’évangélisation précoce dans le cadre historique antique certain ?
Des deux premiers chapitres de l’ouvrage (qui traitent des relations entre l’Occident grec, puis romain avec l’Inde antique de manière passionnante et exotique), il apparaît qu'une telle tentative évangélisatrice était, aux points de vue logistique et technique, tout à fait vraisemblable : à ma grande surprise, j’ai découvert que les rapports diplomatiques, mais également commerciaux et « touristiques » avec l’Inde et au-delà ( !) ont parfois été très intenses, avec des implantations romaines dans le sud de l’Inde au Ier siècle, et 120 navires par « mousson » qui faisaient la navette entre le sud de l’Inde et les ports égyptiens de la Mer rouge. C’est ainsi que Sénèque pouvait en son temps dire : « de Cadix à l’Inde, quelques jours pour celui que poussent les justes vents ».
DU POSSIBLE AU DÉMONTRABLE
Les chapitres suivants examinent, avec une érudition parfois écrasante, les signes (liturgiques, linguistiques, etc.) qui permettent de reconstituer un portrait-robot de ce christianisme indien primitif, et des différentes fortunes qui l’ont modifié : éradication au Nord par le retour de la Perse, puis l'arrivée de l'Islam dans les royaumes indo-grecs de la vallée de l’Indus (actuel Pakistan), superposition au Sud (Kerala, Coromandel) de plusieurs vagues de migrations, et d’évangélisation qui ont altéré sa configuration originelle.
Plusieurs chapitres par l’auteur sanscritiste s’intercalent (très bien à mon goût) pour aérer le raisonnement « historique dur » avec d’élégantes démonstrations de transferts culturels.
J’ai particulièrement apprécié le chapitre qui montre comment à partir du IIe siècle, les textes indiens sur le mythe de Krishna intègrent des emprunts occidentaux païens et surtout chrétiens, et notamment des transferts directs de scènes tirées de l’enfance de Jésus. De manière tout aussi convaincante, le prof. Dognini montre comment l’apologétique bouddhiste, en territoire indo-grec, emploie des images indiscutablement empruntées à des paraboles évangéliques. C’est pour l’auteur, le signe que ces textes circulaient en Inde, et étaient déjà suffisamment connus et compris pour que des lettrés hindouistes et bouddhistes puissent les assimiler et se les réapproprier dans leur propre univers spirituel. Ce n’est qu’en reculant la date des contacts entre Occident christianisé et Inde que l’on peut expliquer ces étonnantes convergences.
La « faisabilité » d’une première évangélisation précoce de l’Inde étant établie, et en partie étayée par des éléments de terrain, il reste le problème de l’historiographie moderne : pourquoi s’ancre-t-elle sur le terme constantinien alors qu’elle donne elle-même tous les éléments scientifiques pour envisager des hypothèses plus précoces ?
UNE QUESTION DE TOPONYMIE ?
Selon les auteurs, tout tourne autour de la division de l’Inde en Indes multiples dans les sources des Anciens. Les termes Inde citérieure, ultérieure, intérieure désignent selon eux des zones atteintes par l’Occident en des périodes différentes, par des moyens divers : l’Inde du Nord connue dès Alexandre le Grand, l’Inde du Sud, partenaire commercial de Rome du Ier au IVe siècle, l’Inde de la vallée du Gange, « explorée » par les Occidentaux à partir de Constantin. Cette division (qui est la plus logique, d’ailleurs, que celle qui ferait d’une Inde l’Inde authentique, d’une autre l’Arménie, ou encore l’Éthiopie) permet de valider plusieurs « phases » d’évangélisation que l’historiographie moderne retenait incompatibles, en ne reconnaissant que la plus tardive d’entre elles, à l’époque constantinienne.
Nous aurions donc d’abord une Inde septentrionale, celle des royaumes indo-grecs, évangélisée par voie de terre par la chrétienté orientale primitive, attachée à la figure de Thomas : cette chrétienté syro-araméenne, née entre Jérusalem en Antioche, ancrée à Édesse (Mésopotamie), à la forte identité sémitique, qui se déploie le long du grand réseau routier oriental du monde perse, pourrait être celle de « l’Évangile sémitique de Matthieu ». Sa progression vers l’Est est facilitée par le fait que l’Empire achéménide avait adopté sa propre langue, l’araméen, en guise d'idiome administratif, et l’avait ainsi transformée en lingua franca de l’Asie. Ces premiers missionnaires judéo-chrétiens du Ier siècle peuvent s'appuyer sur les nombreux foyers juifs qui parsème l'Orient, jusqu'en Inde même.
À cette Inde antérieure, ou citérieure, s’opposerait une Inde méridionale, ultérieure, évangélisée par voie maritime, liée à la chrétienté occidentale, à laquelle était rattachée l’Égypte. Cette chrétienté se rattache à la figure de Barthélémy, et à la mission que rapporte Pantène. L’Inde gangétique, est cette Inde intérieure, ou postérieure, qui n’est approchée que brièvement, sous Constantin. Avec le déclin de l’Empire romain d’Occident, le lien maritime entre l’Inde avec la chrétienté occidentale coupé. C’est la chrétienté orientale de Mésopotamie, et notamment l’Église perse, fille spirituelle de l’Église d’Édesse, qui prend la tutelle de la chrétienté indienne, qui n’existe plus qu’au Sud.
Avec, ici, un acquis très important de l’ouvrage, mais à mon sens sous-exploité (il est à peine évoqué à la fin du chap. VII), alors qu’il vient justifier toute la structure de l’ouvrage : l’effacement de Barthélémy au profit de Thomas dans les traditions indiennes, qui apparaît comme la CONSÉQUENCE de l’influence d'Édesse et de la tradition syro-orientale (via l’Église de Perse ensuite), que les faits de l’Histoire amènent à prendre le dessus sur celle d’Alexandrie.
EN CONCLUSION
Les Apôtres en Inde est un ouvrage d’une rare densité, qui demande des efforts de lecture non négligeables, mais donne la sensation d’avoir pris connaissance d’un monde insoupçonné. Je souligne encore ici la complémentarité entre les travaux des deux professeurs, avec les chapitres d’histoire antique et religieuse dure d’Ilaria Ramelli, et ceux d’analyse textuelle de Cristiano Dognini, qui réinscrivent toujours les acquis scientifiques dans une perspective d’histoire culturelle absolument rafraîchissante.
L’histoire de la prédication chrétienne en Inde est un sujet pour le moins spécialisé, mais cet ouvrage permet de le réinscrire dans la grande histoire de l’Antiquité, et compose une fresque des rapports à l’Orient fascinante. S’il n’y a qu’un ouvrage à lire, je pense que c’est celui-ci, pour son érudition, sa pondération, et les horizons qu’il fait découvrir. Je pense d’ailleurs que c’est le seul en langue française.
EN BREF
Les plus
- une lecture dépaysante et fascinante pour qui aime l’Antiquité et l’Orient lointain
- quantité phénoménale de connaissances brassées
- nombreuses références bibliographiques : cet ouvrage est structuré comme une étude historiographique, dans le cadre strict de laquelle prennent forme des hypothèses
- une grande prudence dans les déductions
Les moins
- une grande prudence qui parfois ressemble à un manque de courage
- une certaine circularité des raisonnements
- parfois trop d’emphase sur des points surspécialisés (chapitre VII, c’est de toi que je parle !)
- pas de cartes !