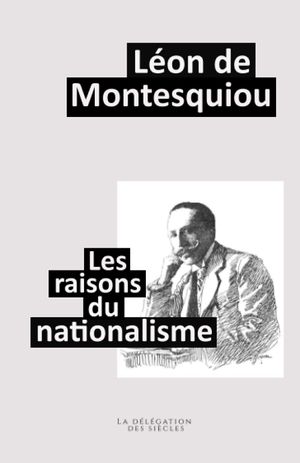Le livre de Montesquiou est un excellent compendium des doctrines du début du nationalisme. Forgé par Maurice Barrès, ce terme, cette pensée, ce mouvement allait faire florès. Le nationalisme n’est pas né de l’affaire Dreyfus comme on le prétends, mais, comme le montre Montesquiou, avait déjà été pensé, élaboré (sans que le mot soit là) tout au long du fécond 19ème siècle.
Léon de Montesquiou résume ainsi les pensées de Paul Bourget (dont il faut lire le chef d’œuvre Essais de psychologie contemporaine), de Hippolyte Taine, de Bonald sur la famille, surtout de Frédéric Le Play sur l’hérédité, la longue mémoire des ancêtres, l’exigence de prendre appui sur le passé plutôt que de créer une tabula rasa dans le présent.
Montesquiou montre que toutes les pensées révolutionnaires d’arrachement de l’identité s’appuient sur le Contrat social du funeste Rousseau (dont il révèle que Rousseau lui-même avait écrit ce livre sans vraiment comprendre ce qu’il y disait, sans mesurer la portée de ces propos).
Montesquiou a recours à des citations éclairantes. Et son propos est élégant et clair. Le nationaliste, le traditionnaliste sait que l’homme est perfectible. Ainsi, page 51., « Tel que le crée la nature, c’est une ébauche, mais qui a en elle la possibilité de devenir un chef d’œuvre. Ebauché par la nature, l’homme est modelé par la société. L’homme est le chef d’œuvre de la civilisation. Telle est la pensée du traditionnaliste », opposé au moderniste. On est loin, ainsi, d’une vision caricaturale que donne la gauche du nationalisme comme doctrine « fixiste », « figée » de l’homme ; bien au contraire !
Cette pensée rejoint celle de Nietzsche sur l’hérédité (Nietzsche avait lu Paul Bourget avec profit) ainsi que sur la pensée que l’homme est une ébauche et non un être déjà fixé dès le départ (« l’homme est un pont entre l’humain et le surhumain »).
Cette pensée renverse la dialectique rousseauiste et révolutionnaire. Par exemple, ce ne sont pas les lois qui créent les mœurs, mais les mœurs qui créent les lois. La volonté n’est pas ex nihilo, mais est le résultat de générations ininterrompus de travail, de sacrifice, de labeur. La démocratie n’améliore pas la condition des individus, mais fait plus souvent des déclassés, par le fait d’un mouvement permanent des classes trop forts, qui engendre désordre et chaos social. Ou encore, l’homme n’est pas soumis à des lois législatives, mais, bien plus, aux lois naturelles qui gouvernent une société. L’homme, in fine, dépends de la société, et n’est pas un atome parmi cette société. Et cette société n’est pas la collection d’individus disparates, mais une collection de familles, de groupements de travail (corporations), de provinces enracinées, dont chacune a une culture bien à elle. Enfin, la liberté n’est pas caprice et libre arbitre, mais avant tout « obéir et n’obéir qu’aux lois qui règlent notre existence » (p. 106). En outre, la vision républicaine révolutionnaire actuelle prétend révéler la « diversité » dans la société, alors que la réelle diversité a déjà été tuée, matée, par la volonté républicaine de tuer les provinces, les corporations de l’Ancien Régime, les institutions les plus durables de la France.
Léon de Montesquiou fait donc ici une admirable synthèse de la pensée traditionnaliste des Louis de Bonald, Frédéric Le Play, Paul Bourget, Hippolyte Taine, qui ont parcouru le 19ème siècle, pour inspirer la génération de l’Action Française naissante. Idées oubliées aujourd’hui, mais qui méritent qu’on les exhume, qu’on enlève la poussière que les années ont mis sur cette pensée féconde qui a comptait avec elles des cohortes de critiques littéraires (Jules Lemaître, Pierre Lasserre), de philosophes (Charles Maurras), de polémistes et romanciers (Léon Daudet), d’historiens (Jacques Bainville). Cette dernière donnait une vision différente de l’homme, non comme personne qui se crée sans cesse, mais comme héritier du passé, des mœurs, de la société. C’est de cette condition que dépendait l’avenir dans la longue durée d’une civilisation comme la France, comme l’avait compris Montesquiou.