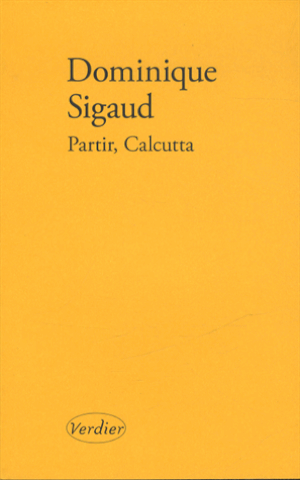Le motif des débuts, des naissances, de ce mouvement perpétuel où de la perte ou du départ peut surgir l’éclat semble traverser l’œuvre de Dominique Sigaud. Publié en 2014 aux éditions Verdier, son dix-septième livre, Partir, Calcutta raconte un départ, un voyage qui est comme une naissance, celle d’une écriture en écho à une ville, Calcutta. Le jaillissement de cette écriture se cristallise dans la première phrase, somptueuse, du livre :
Il y a dans ce que je suis, comme elle, Calcutta, des palais à l’abandon. C’est le début, il n’y en a pas d’autre. Quelque chose s’est résumé dans cette phrase. Je ne l’ai pas inventée. C’était des semaines après Calcutta. J’écoutais des violons et des violoncelles travailler un concerto de Haydn, j’ai sorti le carnet de mon sac et je l’ai notée. Elle avait dû naître parmi les mouvements du concerto. Je me suis souvenue d’une phrase de Pascal Quignard, « Dans deux trios de Londres de Haydn a lieu un événement très rare : des phrases qui se répondent et qui ont presque du sens. Elles sont à la limite du langage humain. » Une musique à la limite du langage humain a permis à cette phrase de se constituer.
Portée par un simple désir de partir, sans qu’une ville, un pays ou un but n’y soient précisément associés, mais par le désir de partir vraiment, Dominique Sigaud a choisi de s’envoler seule vers Calcutta. Dès la première vision de la ville renversée par sa découverte, elle explore l’intérieur de cette cité gigantesque et chaotique, affronte ses contrastes, la violence, la pauvreté et les traces sublimes d’une beauté déchue, la paix et la douceur des bords du Gange.
L’arrivée à Calcutta est un choc comme une dépossession, mais Dominique Sigaud s’y abandonne, loin du corps à corps téméraire de Philippe Rahmy avec Shangaï dans «Béton armé», et se laisse porter par ce qui s’y enchevêtre, la violence et la paix, le tumulte et la bienveillance, comprenant finalement la similitude entre la découverte de la ville et celle de son état intérieur, qui fait de Calcutta un miroir, une ville-sœur.
À l’intérieur de moi donc il y aurait, comme elle, les restes d’un héritage, structures abandonnées, traces d’un passé révolu, vestiges d’une occupation étrangère. C’est une certitude. À l’intérieur de moi aussi, ces constructions récentes érigées à la hâte, inachevées, ces vastes territoires de taudis, ces voies massives et chaotiques, ces paisibles ruelles. Ensemble, cette misère et cette grandeur, cette propension à vivre, cette ferveur parfois. Cette pauvreté extrême. Cette profusion. À l’intérieur de moi l’enfant qui mendie et le Brahmane ; le fou errant, l’Intouchable. Et ce fleuve séparant tout en deux parts, sacré et bordé d’immondices. Et cette poussière noircissant tout. Et ce bruit constant, ces déplacements chaotiques côte à côte avec cette lenteur et cette paix. L’intérieur de moi semblable à ce que j’avais vu d’elle, un territoire cherchant obstinément sa forme ; une ville sœur.
Semblant faire écho aux propos de Marguerite Duras, «il n’y a de voyage qu’en profondeur», ce récit est comme un long chant à l’écriture hypnotique ; l’énigme de la ville et la forme de l’écriture font écho aux livres de l’auteur du « Vice-Consul« . Comme une India Song, Dominique Sigaud nous offre un récit d’images et de sensations vibrantes, un voyage où l’extérieur et l’intérieur dialoguent, où le délabrement et le vacarme côtoient la poétique et l’éclat de la beauté, une perte et un aboutissement.
Nous finissions par atteindre un peu de ville. Un début de Calcutta. Le chauffeur s’arrête souvent, demande sa route. La ville se resserre, se densifie, la voiture emprunte d’innombrables ruelles en terre prises entre de hauts murs. J’entre dans un territoire, c’est très étranger. Je vois peu. J’ignore comment il se reconnaît dans ces voies sombres et resserrées où se mêlent femmes en sari, hommes, enfants et chiens, glissant plus qu’ils ne marchent, sans cesse frôlés par des vélos, motos, charrettes à bras et voitures s’entrecroisant malgré l’étroitesse, klaxons, écarts ; pas de rétroviseur extérieur. Un excès qui rapidement m’atteint, une matière excessive. Mais j’ai vu arrêtées contre des trottoirs déserts, de vieilles Ambassador blanches couvertes d’une poussière ocre, depuis combien d’années sont-elles là ? ; on dirait un film italien des années cinquante, passé, en noir et blanc, Rome ville ouverte. Et Duras un instant, le Calcutta de Duras, une nostalgie. L’instant d’après encore, un match de cricket dans un stade éclairé, seule lumière vive à des kilomètres. Mon ignorance grandit. Enchevêtrement. Ordures déposées là, tas d’ordures. Je veux arrêter de me déplacer. Chiens jaunes seuls. Arriver quelque part. Je suis comme cette voiture. Je deviens la voiture. Une carcasse, un moteur. Pas de rétroviseur. Juste la capacité mécanique à avancer. Pas un mot échangé avec le chauffeur. Nous ne pouvons que nous taire.
Une note de lecture à retrouver, avec beaucoup d'autres, sur le blog de Charybde 27 ici :
https://charybde2.wordpress.com/2018/07/24/note-de-lecture-partir-calcutta-dominique-sigaud/