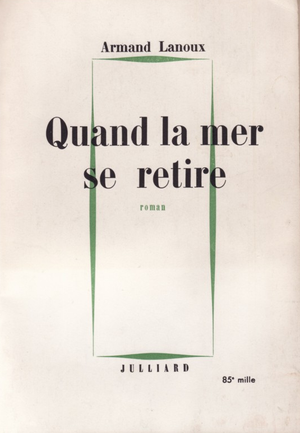Rare est une oeuvre qui témoigne d'une si grande souffrance, qui offre une douleur tellement sourde et tellement profonde qu'elle en devient presque une source d'un style torturé, complètement maculé d'un sang déjà disparu, mais qui imbibe toutes les pages, toutes les métaphores, toutes les évocations. Quand la mer se retire est un des meilleurs romans écrits sur la guerre, et notamment sur le Débarquement de Normandie du 6 juin 1944 : le mieux écrit sans doute, le plus terrifiant aussi, le plus glaçant. En fait, parfois, le lecteur se rend compte qu'il a entre les mains le journal d'un homme détruit, amputé, mutilé d'une part de son esprit, dont le style confine à la folie, à un tel point qu'il ne rentre jamais complètement dans ce roman qui pourtant transporte, et d'une certaine façon convainc. Armand Lamoux raconte l'histoire d'Abel, un ancien soldat canadien ayant participé au Débarquement de Normandie, qui revient en France dans les années soixante pour retrouver le lieu de la mort de son camarade militaire, et également de faire une sorte de voyage initiatique pour se retrouver lui-même, sans grand succès. Le roman est particulièrement douloureux parce qu'il ne laisse ni le narrateur, ni le lecteur profiter de la Normandie des années 60, et le ramène sans cesse aux heures sombres de la guerre, au feu, aux mêmes images, toujours les plus laides et les plus sanguinaires : une forme de film qui reviendrait sans cesse en boucle, de manière lancinante, comme des larmes qui ne cesseraient de couler, ou une plaie de saigner.
Quand la mer se retire est un roman en avance, car s'il a été écrit quelques années après le Débarquement, il cerne très bien les problèmes liés aux anciens combattants tels qu'ils sont appréhendés aujourd'hui. En fait, le roman traite du syndrome post-traumatique avant l'heure, et surtout le fait comprendre avec une grande efficacité, bien plus grande que celle que pourrait exprimer le psychiatre le plus vulgarisateur. Le titre lui-même est très évocateur, et par une pirouette qui fait référence évidemment aux plages normandes, il cerne plutôt bien cette idée d'une marée incessante, qui par le ressac, le flux et le reflux, submerge puis exhume les ruines matérielles et immatérielles d'une guerre passée. Un homme ne se remet jamais totalement d'une guerre, mais plus encore, Armand Lamoux nous rappelle évidemment l'hypocrisie des commémorations, des cimetières militaires et des hommages superficiels, en comparant Patton à un nazi, et démontrant le sacrifice des jeunesses innocentes et naïves sur l'autel de la guerre. Lamoux nous livre également quelques thèses originales, parfois un brin misogynes, sur le fait que la femme s'est affirmée en Occident sur les cadavres des hommes sacrifiés au front, ou alors s'épanche sur la médiocrité des foules et de l'être humain. En recherchant désespérément le lieu de la mort de son ami Jacques, entre deux femmes qu'il désire, il se rend compte de l'absurdité, et même de l'horreur, de l'idée d'un quelconque hommage, plein de vanité et de fatuité. Les fantômes de la guerre le rongent, le tirent vers l'abîme, et les bribes de souvenirs lui reviennent au fur et à mesure que se dévoile devant lui la Normandie, terre si belle, pleine d'algues, de soleil, d'azur et de maisons proprettes, qui ne parvient cependant pas à dissimuler les charniers d'antan, où les crevettes allaient se repaître, grossissant en se nourrissant de la chaire humaine, des Nazis comme des Américains.
Ce qui frappe le plus dans ce roman, c'est son style. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Armand Lamoux fait honneur à la littérature française, tant le style est très travaillé, à la limite de la boulimie métaphorique : les hyperboles, les métaphores et les nombreuses tentatives poétiques sont nombreuses, et témoignent secrètement d'une forme d'obsession inexplicable. A y regarder de plus près, le lecteur remarque des mécanismes récurrents, quasiment cycliques : d'abord, l'auteur peint la Normandie comme une peinture expressionniste, par la superposition permanente de masses de couleurs ; entre le bleu, le jaune, le vert et le rouge. Il y quelque chose d'éblouissant et presque d'épileptique dans ces descriptions ultra-colorées, qui se répercutent d'ailleurs étrangement dans le récit qui fait s'aligner des phrases et des informations de manière très lapidaire et rapide, comme s'il fallait tout dire, toujours tout dire pour exorciser la douleur. Le deuxième mécanisme est celui de l'évocation du passé : l'auteur pointe un détail du paysage ou des habitants, pour arriver quasiment instantanément à un moment très précis des combats du Débarquement de Normandie, avec son ami Jacques et sur les routes militaires de Normandie. L'exemple frappant est celui de feu d'artifice qui renvoie à l'immolation par le feu d'un militaire allemand, qui court comme une torche vivante pour s'effondrer en tas de charbon sur le sol sur le sable près d'un bunker. Le livre ne se lit pas sans difficulté, sans sensation de trop-plein, et parfois même saoule comme une beuverie dans un bar normand. Le roman a l'intérêt principal de nous transporter, ou plutôt de nous brinquebaler, de nous secouer : un véritable manifeste plus efficace que des vœux pieux pacifiques.