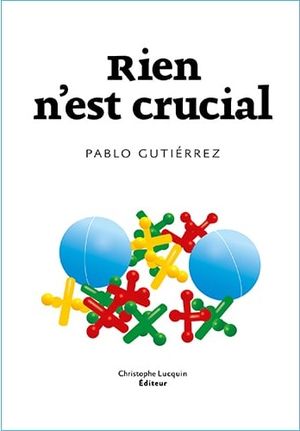Roman qui est à la fois l’illustration et l’anti-illustration de son titre, Rien n’est crucial ressemble surtout à un labyrinthe dont le bâtisseur n’aurait pas cherché à égarer le promeneur, mais à lui faire faire un maximum de détours en un minimum d’espace. Peut-être que si un nombre suffisant d’universitaires venait à découvrir l’existence de ce roman, il deviendrait le support d’une étude où figureraient les mots narrativité, métafiction, Bildungsroman et postmodernisme. En attendant, le livre raconte une histoire en tenant compte de l’idée que l’histoire n’est pas tout, ce qui est la condition a minima pour qu’on puisse parler de littérature. Mieux : il est pris dans un perpétuel mouvement de navette entre universel et particulier, ce qui pourrait en faire un classique.
Pourtant, Pablo Gutiérrez prévient d’entrée : « Il n’y a pas de métaphore là-dedans : les oiseaux sont des oiseaux et les abeilles des abeilles » (p. 9). L’esthétique de son récit est en effet assez simple : il s’agit de montrer que la vie et laide – l’univers du récit s’appelle Mondelaid –, alors autant en tirer quelque chose. Hors de tout misérabilisme, aussi éloigné que possible d’une approche réaliste / documentaire / journalistique, ni misérabiliste, ni glorificateur, Rien n’est crucial est simplement une mise en art de la misère sociale – à l’image, par exemple, de l’Été des charognes de Simon Johannin (roman dont je fais finir par croire qu’il cristallise une bonne part des enjeux romanesques contemporains, tant j’y fais référence dans mes autres critiques).
Les fils rouges de Rien n’est crucial, les points focaux autour desquels le récit revient toujours sont deux enfants « beaux et mutants comme des personnages de comics » (p. 10), dans un endroit qui « n’est pas New York, ni Berlin, ni Barcelone, ni aucune scène de film, mais un village de campagne de merde » (p. 143) et « à une époque lointaine où les administrations avaient des choses beaucoup plus importantes à faire que de s’occuper des enfants perdus » (p. 78-79). Lécumberri ou Antonio ou Lécou, « né d’un utérus qui a mariné dans la pâte de cocaïne » (p. 36), deviendra « le seul hobbit engendré par des junkies à n’avoir jamais pris une quelconque substance toxique, à l’exception du sorbitol, de l’acidifiant et des gazéifiants habituels de la nourriture en conserve » (p. 204), « ingénu, hébété et un tantinet imbécile comme la majorité des hobbits » (p. 205). Quant à Margarita ou Marga ou Magui, elle « devenait de plus en plus jolie à mesure que sa tristesse pasteurisait » (p. 73), mais « toujours la petite fille des épingles à cheveux et de l’eau de Cologne, même quand elle se transformait en Magui Suceuse » (p. 81).
Reste à préciser qu’autour de ces « deux héliotropes » (p. 298) gravitent d’autres personnages, que la vie n’a pas forcément mieux arrangés : pour le premier un « Monsieur Grand et Loquace » néochrétien, une « Gentille Dame n° 1 », une « Gentille Dame n° 2 » ; pour la seconde une mère célibataire, à une époque et un endroit où « si une femme est abandonnée par son mari, la Loi de la Normalité veut qu’elle reste seule et déprimée jusqu’à mourir d’écœurement, n’est-ce pas cela qui est juste ? » (p. 144). Ce qui arrive précisément à ces deux héros, je laisse le lecteur le deviner ; disons qu’assez vite on se prend au jeu de les suivre.
Car les extraits qui précèdent me semblent assez bien montrer ce que l’écriture de Rien n’est crucial a de dynamique, d’inventif, peut-être faut-il dire de baroque. (La traduction, soit dit en passant, laisse parfois un étrange arrière-goût, et quelques coquilles, par exemple souffre mis pour soufre, n’auraient pas dû échapper à une relecture sérieuse.) Jouant sur plusieurs tableaux – historique, romanesque, poétique –, ce roman est incontestablement, aussi, celui d’une voix, la voix d’un narrateur dont l’identité sera mise en lumière à la fin du récit, et qui joue non seulement avec « [s]on jouet Magui, […] [s]on jouet Lécou » (p. 15), mais aussi avec son propre statut : « Mais n’allez pas croire tout ce que je dis, les enfants, vous savez bien que les narrateurs ont souvent de nombreuses manies […]. Si jamais vous voyez que le narrateur se perd à nouveau dans des propos incongrus, vous n’avez qu’à sauter les lignes jusqu’au prochain caractère gras comme dans ces livres dont vous êtes le héros que maman vous achetait sur les stands de foire. Si tu décides d’entrer dans la maréchalerie, rends-toi à la page 64. Si tu préfères attendre dans l’écurie, va directement à la page 73 » (p. 32-33).
Chez Gentille Dame n° 2, « au mur, il y avait une image non encadrée du bon Jésus avec une devise qui disait “L’ami qui ne fait jamais défaut” et un calendrier de feuilles volantes avec une autre qui disait “Menuiserie Márquez. Réparations et commandes” » (p. 152). Mêlant à l’image de son titre la noirceur et la joie, le sordide et la légèreté, Rien n’est crucial ressemble à une prière qu’on ferait en joignant deux mains pleines de foutre.