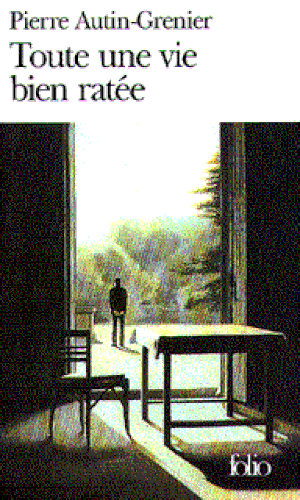Ceux qui me connaissent savent que j’aime bien Pierre Autin-Grenier (1). Ses miniatures sur presque rien ; ses chutes qui en sont à peine ; ses titres qui ont l’air d’être arrivés là par hasard ; sa presque résignation au presque pire ; sa prose, petite musique d’un cerveau sain fatigué d’un monde malade : la première phrase du livre est « Je ne suis rien » (p. 11). Elle ouvre la première de trois épigraphes magnifiques de justesse (2).
Le ton est donné : Autin-Grenier n’est pas seulement l’inconnu qui vient tous les jours au bistrot du quartier, ni même seulement, parmi tous les inconnus du bistrot, celui avec qui tu lierais le plus facilement connaissance, mais bel et bien celui avec qui tu partagerais deux tournées et il te dirait qu’il ne fera pas beau demain, qu’on va tous crever, que la vie est pourrie, que la sienne particulièrement ne vaut pas tripette, « qu’il faut bien considérer que, de toute façon, toutes les questions sont inutiles et les réponses fausses » (dans « Question de plomberie existentielle », p. 102 en « Folio ») mais que ça n’est pas si grave… Dit autrement : « voilà tout à fait une journée assez ordinaire au cours de laquelle il va falloir se montrer avide de vivre, avide des gens et des choses ; seulement parce que nous sommes nés, que nous allons mourir et qu’entre les deux il n’existe pas d’autre solution qu’être un minimum combatif et utopiste » (dans « Les Bégonias de Nasbinals, Thomas Bernhardt et les Écureuils », p. 50).
Après ça, Pierre Autin-Grenier t’aurait raconté une blague, t’aurait tapé dans le dos, t’aurait invité un de ces jours à manger un morceau avec quelques amis.
Il aimait la peinture. Son « Monologue à un ami absent » est adressé à un peintre (Ibrahim Shahda ?), avec des tonalités de « Jojo » de Jacques Brel : « En somme rien n’a vraiment changé, tu vois, tout continue comme avant : toi tu es mort de ce foutu cancer maintenant et moi pas encore ; mais notre amitié reste tout à fait tel ce portrait posé sur le chevalet, dans l’atelier, et dont la peinture ne serait toujours pas vraiment sèche » (p. 94). Ses phrases à lui semblent de grandes traces de peinture, souvent noire : « Le plus clair de la semaine je l’emploie à faire bouger doucement mes orteils au-dedans de mes souliers pour m’assurer ainsi que je suis toujours en vie, et le dimanche ce n’est guère mieux, c’est seulement dimanche en plus et voilà tout » (p. 14-15).
Alors, pourquoi est-ce que je place Toute une vie bien ratée un étage en dessous d’Analyser la situation ou de Je ne suis pas un héros ? Peut-être parce que, paraît-il, qui aime bien châtie bien. Ce recueil, je l’ai peut-être lu un peu à la va-vite, ou pas au bon moment – je le relirai, comme je relirai régulièrement ce que je trouve de Pierre Autin-Grenier –, ou alors après avoir pris le pli de son écriture. Mais rien de grave, vraiment, car « Finalement, tant de choses essentielles pour notre propre vie si longtemps nous échappent que c’en est, après tout, et sans pour autant désespérer, tant pis » (fin de « Tant de choses nous échappent ! », p. 71).
(1) Ceux qui me connaissent mieux savent que je l’ai découvert par hasard, lors d’une braderie, en dénichant Un cri. Une qui me connaît encore mieux a même eu la chance insigne que je le lui lise – mais ce sont d’autres histoires.
P.S. : Pour le plaisir, les trois épigraphes en entier, respectivement tirées de Tabacaria de Pessoa (que je n’arrive pas à aimer), de Nous qui désirons sans fin de Vaneigem (que je n’aime pas) et d’Elle danse dans le noir de René Fregni (jamais entendu parler !) :
Je ne suis rien.
Je ne serai jamais rien.
Je ne peux rien vouloir être.
À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde.
Nous avons à apprendre des bêtes et des plantes ce que nous avons désappris de nous-mêmes en marchandant notre génie.
L’enfance a ses répits que l’homme ne connaît plus. Les fauves sont en nous. Il faut dormir debout une hache à la main.