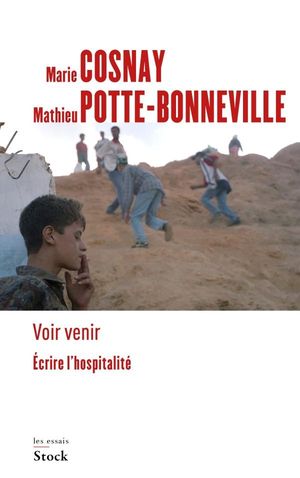On commence un livre par sa fin, par ce qui, la dernière page tournée continue en nous et fait véritablement le livre. Qui fait du livre plus qu’un ensemble de pages et de mots, un continuum de pensée et d’imaginaire.
Ce n’est pas qu’il n’y ait d’autres modes d’être affecté par la lecture bien sûr, il y a tous ces livres que l’on oublie la dernière page tournée, tous ces livres dont les mots s’effacent avec tout le bonheur de leur dissolution, et puis des livres-parenthèses, des livres-chapelets, des livres-diamantaires faits de mots brillants qui nous fascinent mais que l’on rend à l’obscurité cosmique qui les a vu naître. Que sais-je encore ? Beaucoup d’autres façons et d’autres encore à inventer.
Mais parfois on commence un livre par sa fin. Ainsi à rebours, ce livre, s’ouvre – je veux donc dire se termine – sur l’amitié et le récit, sur ce que l’amitié peut permettre au récit d’exil : une croyance sans réserve, une attention à ce qui se livre comme à ce qui se tait. Être cru au-delà du vraisemblable, du jugement, dans les variations de zones d’ombres et de lumière du récit, être accepté jusque dans ses silences. C’est une des politiques de l’amitié pour le récit, par le récit.
C’est mal dit. Bien mal dit. Pas seulement parce que Marie Cosnay comme Mathieu Potte-Bonneville sont de véritables écrivains jusque dans ce dialogue composé dans l’improvision virtuose – véritable hasard de la frappe, je garde ce barbarisme au lieu de « l’improvisation » prévue tant le livre tisse sans cesse une réflexion sur le rapport entre écrire et prévenir, sur la prophétie, l’oracle et le pressentiment, et ce qui aussi les déborde, ce qui fait que le passé, le futur, l’ici et le là-bas se mélangent et se métamorphosent (« en des corps nouveaux » comme dirait l’autre). Histoires de silence, d’interruption, d’incessant et d’impromptus. Mais « c’est mal dit » aussi de ma part parce que Marie Cosnay et Mathieu Potte-Bonneville défont les appels vains à l’éthique ou à un cosmopolitisme vertigineux dont une recension peut donner la fausse impression en utilisant des mots abstraits (#amitié, #politique, #éthique, #écriture, #mythologie, #hospitalité inconditionnelle).
C’est là une des beautés de ces textes que de déployer des récits et de ne pouvoir se détacher des récits et de notre époque pour se considérer « hors sol », pour en abstraire des vérités immortelles ou déployer une culture antique et philosophique au secours d’une morale vacillante. Au contraire, c’est la foucaldienne « inquiétude des sols » comme « inquiétude de l’histoire » que l’on retrouve ici. C’est à la surface même des récits individuels, des difficultés collectives, des façons de dire et d’être dit dans les discours que se réfléchit l’hospitalité.
Ce qui se produit à la croisée des tremblements intimes et de la réflexion c’est alors une éthique en acte qui « s’enroule autour de difficultés insolubles », avec les débords de l’hospitalité comme avec la logique de l’émotion. Immédiatement, urgemment et pourtant remontant un temps long, celui de la culture, entrelacé à celui de l’anecdote, de l’actualité, cette série de textes travaille de l’antique à aujourd’hui des répétitions qui diffèrent. Ce retour à des schèmes antiques (Virgile, Ovide, Euripide, Homère) n’est pas fait pour élever à une dignité sacrée l’hospitalité, la mythifier (au contraire les auteurs rappellent tout le quotidien d’une vie d’exilé en France et des personnes souhaitant les aider), ni pour les exhausser hors du temps mais pour rassembler là où le lointain et le familier se retrouvent.
Reprendre et faire bouger les lignes, déborder : ce que l’écriture et l’hospitalité amènent à faire se traduit aussi dans la forme du livre. Par la conversation faite de textes alternés de l’un et de l’autre, formant comme une respiration d’amitié où l’un étend et l’autre rassemble. Et puis, dans cette écriture qui circule et se multiplie en divergeant par des réseaux de termes proches se dit quelque chose du rhizome de Deleuze et Guattari : pratique d’un livre sans chapitre et d’une écriture sans méthode. Ainsi, si l’on trouve une table des matières et des manières de faire, ce n’est pas à la fin du livre qu’il faut regarder, c’est au milieu du livre, où se livre cette reprise familière :
« Première série – comment dire ?
Des formes de la pensée. – Métaphores, comparaison, métamorphoses. – Des rengaines et de ce qui les fait bifurquer. – Des trois fonctions de l’anecdote (boucler, échanger, transmettre). – Écrire et prendre soin.
Deuxième série – comment faire ?
Les questions insolubles. – La réciprocité et ce qui l’interrompt. – Ce qui reste de devoir (ne pas faire le pire qu’on peut faire). – De la porosité des normes. – De l’endurance et de la fatigue.
Troisième série – comment passer ?
Des rapports impossibles au temps. – De l’amour du temps qui passe. – Des répétitions et des reprises. – Le bouclier d’Énée. – Virbius, Lévi-Strauss.
Quatrième série – comment voir ?
Écriture et exploration. – Écrire-penser en avant et en arrière. – Des remontées et des visions : la grotte d’Actéon. – De la mémoire et des souvenirs impersonnels. – Du pressentiment, des oracles. »
Table incomplète bien sûr. Il y aurait tant d’éléments à déployer et à rajouter. Pense-bête :
1/ Ne pas mythologiser le récit des exilés. Ce qui se dit dans l’écart
et la proximité. Comme dans la traduction.
2/ Nécessité de dire l’insoluble.
3/ La littérature est impure : des témoignages et des anecdotes faites
pour l’oral, mais au-delà aussi. Des silences. Des vérités et des
mensonges.
4/ Écrire pour ceux qui sont perdus. Écrire c’est aussi faire la part
de ce qui est perdu.
5/ L’humain n’est pas qu’un être de parole, aussi de silences. Il est
des choses insurmontables dont on ne pas en parler, mais seulement en
bavarder.
6/ Brièveté versus interpréter : indécision du vrai et du faux ; de
l’importance de garder du jeu.
7/ Écrire pour pressentir : les récits à venir des exilés vont
bouleverser le récit dans leur écriture de la traversée. Leur
témoignage est épopée. Choc, confusion, dépassement.
Mais je n’ai pas perdu de vue l’amitié annoncée depuis le début de la fin et qui œuvre puissamment à l’intérieur du livre et au-delà. Elle est là, entre les deux auteurs, dans leurs récits, dans ce qu’ils mettent en jeu, mais aussi dans ce dont, eux, témoignent. Cela serait déjà beaucoup, pourtant il y a encore ce que ce livre fait à ses lectrices et lecteurs.
On ne peut qu’être frappé par le fait que ce texte puisse bouleverser l’écriture même de la critique qui elle aussi a pour fonction à faire hospitalité au texte des autres.
Lire les textes de Stéphane Habib dans Diacritik, ou de Laurence De Cock dans Libération, c’est réaliser combien ce livre en plus de donner à lire une éthique en acte accomplit aussi une transformation du geste critique. Il est frappant que dans un cas, le discours se creuse pour faire place à un impossible « écrire avec » plutôt qu’un « écrire sur », et que dans l’autre, il se fasse adresse qui prend sur elle aussi d’écrire avec, mais non plus en se creusant pour laisser entendre le texte, mais en s’incluant plutôt dans l’échange épistolaire – approche de la communauté (il y aurait de quoi relancer le débat Nancy-Blanchot-Agamben). Qu’un texte puisse avoir un tel effet montre que cette écriture de l’hospitalité est déjà capable d’accomplir la métamorphose de la critique en amitié et d’ouvrir un horizon utopique pas si loin du rêve de Foucault :
« Je ne peux m’empêcher de penser à une critique qui ne chercherait pas à juger, mais à faire exister une œuvre, un livre, une phrase, une idée ; elle allumerait des feux, regarderait l’herbe pousser, écouterait le vent et saisirait l’écume au vol pour l’éparpiller. Elle multiplierait non les jugements, mais les signes d’existence ; elle les appellerait, les tirerait de leur sommeil. Elle les inventerait parfois ? Tant mieux, tant mieux. La critique par sentence m’endort ; j’aimerai une critique par scintillements imaginatifs. Elle ne serait pas souveraine ni vêtue de rouge. Elle porterait l’éclair des orages possibles. »
Michel Foucault, « Le philosophe masqué » (1980)
Sentiment des orages, pressentiment de l’amour du lointain, récit des fictions essentielles et nécessité de faire l’impossible, Voir venir est un livre contemporain qui nous éclaire sur notre période de ténèbres.