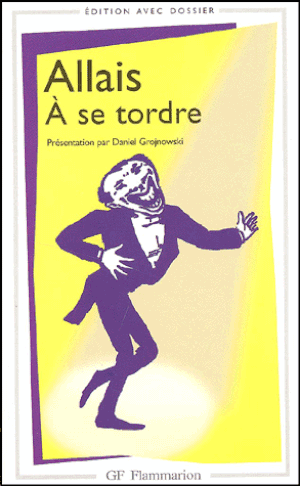L’introduction de l’édition « GF » le souligne : Allais, c’est un humour qu’on ne pratique plus guère, la même lignée qu’un Raymond Devos plus tard. Il me semble, du reste, que sa présence dans l’Anthologie de l’humour noir de Breton, sans être entièrement infondée, est à la fois le fruit et la cause de bien des malentendus. Alors peut-être que pour redonner aux contes et anecdotes d’À se tordre toute leur charge comique, il faut les lire avec l’intonation la plus lugubre possible – ce qui implique, dans les circonstances ordinaires de la lecture, d’être à la fois Coquelin cadet et le public de Coquelin cadet.
Élitiste, l’humour d’Allais ? Oui, si on ne connaît pas le proverbe sur lequel repose ce passage, par exemple : « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’adore l’Angleterre. / Je lâcherais tout, même la proie, pour Londres » (dans « Comfort », p. 159). Mais non, dans le sens où un enfant qui aurait déjà entendu des histoires racontées au passé simple peut comprendre l’histoire de « Ferdinand, qui, à cette époque, était un jeune canard dans les deux ou trois mois. Ferdinand et moi, nous nous plûmes rapidement » (dans « Ferdinand », p. 42).
J’ai écrit comprendre, pas rire de. L’humour d’Allais, ça passe ou ça casse – comme par exemple pour « le Hareng saur » de Cros, qu’Allais traduisit en anglais et qui plaît généralement aux enfants. D’ailleurs, si l’éditeur du recueil en « GF » le lie tout à fait judicieusement et très clairement à l’humour fumiste, il me semble qu’il aurait pu mettre davantage en lumière ce que cette tournure d’esprit a d’enfantin – ce dont Breton s’était aperçu (1).
À l’autre extrémité du spectre, il y a « Un drame bien parisien », et surtout l’analyse qu’en a faite Umberto Eco. D’autres contes d’À se tordre jouent sur les attentes du public et sur cette construction conjointe de l’œuvre par l’auteur et par le lecteur, dont la critique universitaire fera un incontournable soixante-dix ans plus tard.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul point sur lequel Allais soit un pionnier. Ses monochromes figuratifs, par exemple, sont à ma connaissance le premier cas dans l’histoire de l’art où les caricatures viennent chronologiquement avant les œuvres caricaturées. Je crois que sur ce point, et aussi dans certains passages d’À se tordre, Allais applique à merveille le projet flaubertien d’écrire « de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui ou non » (lettre à Bouilhet, 4 septembre 1850).
L’enchaînement de deux phrases comme « Axelsen pleurait comme un veau marin. Je lui serrai la main » (dans « Une mort bizarre », p. 136) doit pousser n’importe quel lecteur à se poser la question, et à se dire que ça ne tient pas debout. Et écrire « C’est effrayant ce qu’on vieillit entre deux Expositions Universelles, surtout lorsqu’elles sont séparées par un laps considérable » (dans « Excentric’s », p. 139), c’est poser le même type de pièges que plus tard un Pierre Desproges, par exemple, tendra à son public.
(1) Il me semble encore que ce côte enfantin est à mettre en lien avec le dégoût profond qu’un certain nombre d’auteurs éprouvaient pour cette société déjà saturée de positif et de pratique – on dirait aujourd’hui concret, mais ça signifie toujours rentable. À la même époque, un Schwob ou un Gourmont y réagiront d’une autre manière, un Villiers ou un Bloy d’une autre encore. Pour tous ceux-là il faudrait étudier ce que leur œuvre a d’enfantin. Pas grand-chose à voir avec la notion d’enfance telle que la verront plus tard un Cocteau ou un Picasso, par exemple, qui ne portaient pas le même regard sur la société et sur eux-mêmes.