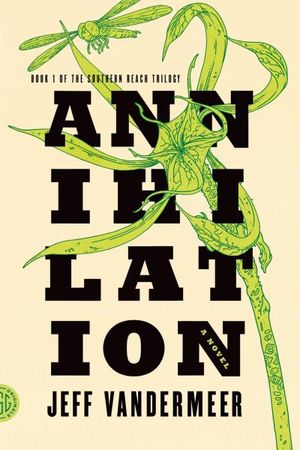Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/08/annihilation-de-jeff-vandermeer.html
J’avais découvert Jeff VanderMeer, comme beaucoup de lecteurs francophones, avec son extraordinaire « truc indéfinissable » La Cité des saints et des fous, un livre aussi monstrueux et dingue que drôle et stimulant – assurément un livre qui m’avait fait une très forte impression, inaugurant peu ou prou la défunte collection « Interstices » chez Calmann-Lévy, dont je me suis régulièrement régalé. Hélas, depuis ce coup de maître, nous n’avions pas eu droit à d’autres traductions de cet apôtre du « new weird » (je parle de ses fictions – il y a eu deux bouquins sur le steampunk ; mentionnons aussi, outre Atlantique, son activité d’anthologiste, éventuellement avec son épouse Ann : sa colossale somme The Weird sommeille, intimidante autant qu’attirante, dans ma liseuse…)… L’auteur ne s’était pourtant pas arrêté là : il avait livré d’autres romans prenant le cadre d’Ambregris, mais aussi des choses indépendantes, dont un Veniss Underground à l’excellente réputation ; mais, si je désespérais de voir ça en français un jour, je n’avais pas vraiment le courage de m’y atteler en anglais…
La nouvelle de la parution d’Annihilation au Diable Vauvert m’a donc fait un immense plaisir, et je me suis procuré bien vite ce court roman – sans trouver, pour tout un tas de raisons plus ou moins bonnes, le temps de le lire jusqu’à présent, bon… En tout cas, cette publication en annonce d’autres, puisque Annihilation est le premier tome d’une trilogie, dite « du Rempart Sud » (« Southern Reach » en VO), dont les trois volumes sont sortis peu ou prou en même temps aux États-Unis en 2014, mais leur publication française (dans une traduction de Gilles Goullet, comme pour La Cité des saints et des fous) sera par contre étalée sur trois ans a priori.
Les échos étaient très bons – évoquant des références éventuelles enthousiasmantes, dont, sans surprise, Lovecraft (qui jouait déjà son rôle dans La Cité des saints et des fous), ou encore l’épatant Stalker d’Arkadi et Boris Strougatski. Et ça se vérifie très vite, sans pour autant que le roman vire au pastiche de l’un ou de l’autre ou d’autre chose encore, mais en gardant toute sa singularité, thématique, narrative, etc.
Il y a donc la Zone X – et on ne sait pas ce que c’est au juste : c’est bien le propos… Prosaïquement, c’est une zone sauvage, où la nature a repris ses droits (VanderMeer s’est ici inspiré d’un parc naturel de Floride, et sa description du cadre, soignée, peut éventuellement évoquer du « nature writing »), laissant tout juste paraître quelques traces anciennes d’occupation humaine (ou pas ?), notamment un phare et un tunnel que la narratrice tient à qualifier de tour, et qui s’enfonce indéfiniment dans le sol. Mais la Zone X, et c’est surtout cela qui la caractérise, est coupée du reste du monde – là encore, sans que l’on ne sache trop ni comment, ni pourquoi : on évoque bien une « catastrophe », mais sans en dire davantage ; on évoque aussi une « frontière », invisible et intangible, avec un unique point d’accès – ni comment ni pourquoi, idem ; on suppose enfin que cette frontière recule, ou, si l’on préfère, que la Zone X s’étend insidieusement… Mais c’est de toute façon une région qui semble résister aux entreprises de cartographie.
C’est pourtant à ces fins (ou pas ?) que l’organisation gouvernementale (secrète ?) dite « Rempart Sud » ne cesse d’y dépêcher des expéditions. Onze se sont ainsi succédées – pour lesquelles les choses se sont très mal passées… Mais chaque fois d’une manière différente ! Ici, les membres de l’expédition se sont entretués ; là, ils se sont tous suicidés ; là encore, ils sont sortis de la Zone sans savoir comment, mais ne sont revenus « dans le monde réel » que pour y périr d’un cancer à l’évolution extrêmement rapide… Pas exactement un lieu de villégiature, donc – mais d’emblée un endroit menaçant, voire fatal…
Or, étonnamment (ou pas ?), il y a toujours des volontaires pour s’y rendre, et tenter de percer à jour les indicibles secrets de la Zone X. Il y a donc une douzième expédition, et c’est celle qui nous intéresse plus particulièrement dans Annihilation – le titre, avec ces quelques informations préalables, sans même parler d’une laconique déclaration survenant très tôt dans le récit, laissant déjà supposer le pire… ou pas ? On en revient toujours à ce « où pas »…
Cette expédition est strictement féminine, et composée de quatre membres dont on ne connaît pas les noms, et qui ne sont désignés que par leur fonction – qu’ils emploient par ailleurs pour s’interpeller. S’il devait y avoir un chef au groupe, ce serait par défaut la psychologue ; il y a aussi (outre la linguiste qui a finalement dû renoncer à l’expédition) une géomètre, une anthropologue, et enfin une biologiste, qui est notre narratrice : Annihilation prend en effet la forme d’un journal, avec la subjectivité qui sied au genre, et qui donne très vite sa teinte essentielle au roman – la subjectivité y a en effet un rôle fondamental, couplée au procédé habilement développé du narrateur non fiable… l’astuce étant que c’est d’emblée cette narratrice elle-même qui expose ces dimensions.
Balancées en plein dans cette Zone X à laquelle elles ne comprennent rien, nos investigatrices passent d’abord un certain temps autour de cette structure souterraine que toutes envisagent comme étant « le tunnel », mais que la narratrice tient à appeler « la tour » – une tour inversée, qui s’enfonce dans le sol, au fil d’escaliers interminables. Les premières explorations, sans aller forcément bien loin, achoppent déjà sur nombre de phénomènes étranges, et tout particulièrement sur ces textes cryptiques et sans queue ni tête (littéralement : l’ensemble est constitué d’un amas de propositions n’ayant ni début ni fin mais s’enchaînant et se renouvelant sans cesse), que la biologiste devine bientôt être le fait d’organismes vivants, peut-être en rapport avec une entité éminemment lovecraftienne rôdant dans les étages inférieurs… Très vite, en fait, la biologiste suppose avoir été contaminée, d’une manière ou d’une autre, par la tour, ou les créatures qui y vivent, ou ces textes qu’elles écrivent. Elle en est pleinement consciente : elle sait, dès lors – et le lecteur avec elle –, ne pas être fiable…
Le problème est bien sûr que ses camarades ne le sont pas davantage. Et si l’anthropologue est trop effacée pour vraiment retenir son attention (et peu importe), il n’en va pas de même de la géomètre – la militaire de l’équipe – et a fortiori de la psychologue… dont l’usage de l’hypnose et de la suggestion a nécessairement quelque chose d’inquiétant.
À l’angoisse sourde et éventuellement cosmique en même temps qui suinte de la tour se superpose ainsi une seconde couche d’inquiétude, relevant cette fois davantage du fantastique psychologique – et, étonnamment, plus propice à l’action ? L’indicible et la curiosité morbide des « héros » lovecraftiens se doublent donc d’une dimension paranoïaque essentielle, qui colore bien autrement le récit. La certitude de la biologiste – qui entend bien en convaincre son hypothétique lecteur (ou pas si hypothétique que cela ?) – que Rempart Sud en sait bien davantage sur la Zone X qu’on ne leur a dit, la certitude qu’on leur a délibérément caché la vérité, imprègnent tout autant sinon plus les pages que les rapports d’exploration, lesquels n’ont finalement pour fonction que de revenir sans cesse sur le grand mensonge initial, avec toute l’obsession que peut y mettre un schizophrène au dernier degré.
Cette dimension psychologique se complique par ailleurs sous un autre angle, qui est celui de la motivation de la biologiste : nous apprenons en effet assez vite que ce personnage d’une extrême froideur et peu ou prou dénué d’empathie avait ses raisons de venir dans la Zone X – son mari avait fait partie de la précédente expédition, la onzième (qui s’est donc soldée par le cancer généralisé évoqué plus haut) ; si elle s’est portée volontaire pour la douzième expédition, c’est sans doute tout autant en raison de son sentiment de culpabilité, difficilement répressible, que de sa compétence et de sa curiosité scientifiques… Ce qui introduit donc un biais supplémentaire dans son propos.
Dimension qui s’accentue enfin quand la biologiste, nécessairement, aura l’occasion de lire d’autres journaux – confrontant sa subjectivité écrite à d’autres, et triant pour son lecteur le pertinent de ce qui ne l’est pas… Ceci dans le phare qui, pour figurer l’antithèse de « la tour », n’en est donc pas moins chargé d’un lourd bagage de peur – simplement d’un autre ordre.
Sur le plan narratif, tout cela fonctionne très bien, et se montre indéniablement pertinent. L’angoisse sourde des explorations cthoniennes n’a rien à envier à un Lovecraft au sommet de sa forme, tandis que les relations entre les différents membres de l’expédition parviennent à exprimer une étonnante humanité dans cet univers farouchement abstrait – les quatre femmes ont beau être réduites à des archétypes fonctionnels, elles n’en existent pas moins. Il y a donc une peur qui suinte à tous les niveaux – peur mêlée de fascination, comme de juste, dans la vaine appréhension des mystères de la Zone X, mais peut-être tout autant sur le plan humain : la question de la suggestion hypnotique a éventuellement ce rôle. Au-delà, la violence et la haine, au-delà des contaminations supposées de la Zone (ou, d’ordre psychique, résultant de suggestions hypnotiques ou d’autres formes de conditionnement ?), dessinent plus ou moins une humanité qui se perd toute seule, et n’a finalement guère besoin qu’on l’y pousse : à cet égard, les pièges de la Zone X sont tout autant des prétextes.
Au-delà de cette peur qui rôde, le roman brille donc surtout dans son utilisation du procédé du narrateur non fiable. Les déclarations mêmes de la biologiste dans son journal incitent le lecteur à intégrer cet aspect du récit, dont découlent des conséquences joliment paradoxales – relevant presque, d’ailleurs, du fameux « paradoxe du menteur ». C’est un moyen pertinent d’intégrer le lecteur lui-même dans la paranoïa ambiante – avec pour cause principale de ses inquiétudes la narratrice elle-même, si elle reporte bien sûr ses propres craintes sur ses collègues et l’organisation Rempart Sud. Et cela va peut-être encore au-delà, puisque l’on est amené à remettre en cause tout, absolument tout, de ce qui nous est narré. Ce qui revient à démonter les ressorts de la fiction : en temps normal, celle-ci, par jeu, affirme nous dire la vérité, quand nous savons que ce n’est pas le cas – elle n’en est pas moins conçue avec toute l’habileté d’un canular, pour reprendre l’expression connue de Lovecraft… Mais ici, il y a un renversement : le récit dont on sait qu’il est fiction en rajoute une couche : rompant avec les principes du genre, bien loin d’asseoir l’authenticité (d’un second ordre) de ce qu’il rapporte, il ne cesse de nous dire qu’il ment, ou, plus exactement et de manière plus insidieuse, il nous le laisse entendre au travers d’une multiplicité d’indices… qui devraient justement être eux aussi questionnés, à tout prendre. Si la narration est fluide et globalement ordonnée, elle n’en est pas moins riche de ces bizarreries fictionnelles ou anti-fictionnelles (un « post-machin », sans doute…), à même de susciter, de manière finalement ludique, tant la fascination que la migraine.
Tout ceci, on l’aura compris, fait un bon roman. Et peut-être même très bon. Pourtant, il me faut bien admettre une relative déception… Sans doute ne tient-elle pas au roman en lui-même, mais aux attentes extrêmement élevées que je plaçais en lui. C’est que j’avais encore le souvenir émerveillé de La Cité des saints et des fous, et espérais donc, consciemment ou pas, quelque chose d’aussi fort et d’aussi fou. Ce que n’est à mon sens pas Annihilation. Si les deux œuvres jouent dans la même catégorie du « weird », c’est pourtant de manière très différente. La Cité des saints et des fous était baroque, foisonnante, drôle, ludique, au point d’en être parfois gratuite, mais, avouons-le, délicieusement gratuite. Annihilation n’est rien de tout ça : c’est un récit autrement sobre, autrement humain, quand bien même paradoxalement, autrement focalisé aussi. L’humour n’y a guère sa place, le baroque encore moins. Si La Cité des saints et des fous tenait de l’encyclopédie absurdement cohérente d’un monde fantasque, Annihilation s’en tient au format autrement court, diffus, délibérément imprécis, sourdement pathologique, du rêve ou du cauchemar. Aussi folle soit-elle, Ambregris avait quelque chose de concret, de palpable – aux antipodes finalement de cette Zone X essentiellement abstraite et dont l’essentiel de la valeur réside justement dans l’indéfinition. Ce sont bien sûr deux approches aussi légitimes l’une que l’autre – et deux approches tout aussi à même de me séduire ; il n’en reste pas moins que mon souvenir, éventuellement idéalisé, de la première, a probablement parasité ma lecture de la seconde.
Ces attentes sont comme de juste vicieuses… Elles m’ont fait espérer le chef-d’œuvre, et, au final, j’ai donc été déçu de ne lire qu’un très bon roman… « Rien que ça… » Cela en vaut pourtant la peine – et je ne doute guère de prolonger l’expérience avec les deux romans suivants, semble-t-il très différents, et éclairant d’un regard singulier les mystères de la Zone X… et peut-être tout autant les mystères de la narration et de la fiction. Ce qui n’est certainement pas rien.