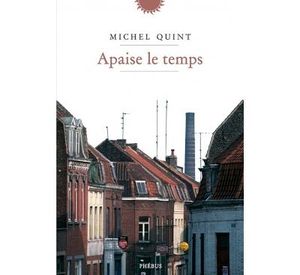J'avais quelques raisons d'avoir envie de lire ce roman : il est très court, l'action se situe dans le Nord, à Roubaix, il traite de la guerre d'Algérie, sujet longtemps plus ou moins (plutôt plus que moins) tabou en France.
Le bilan est assez mitigé. Mon premier problème, et il est de taille, c'est le style d'écriture, hérité de Marguerite Duras et consorts, au phrasé volontairement sobre et qui mêle sans cesse style direct et style indirect libre. Leslie Kaplan écrit de cette façon depuis longtemps, Mathias Enard (qui pourtant est un écrivain assez jeune) écrit de cette façon également, persuadé, lui, que c'est très original. Bon, non seulement ce parti-pris n'est pas très nouveau, mais je pourrais carrément dire que c'est vieillot et pas très intéressant, soixante ans après l'apparition du Nouveau roman. Cela dit, malgré mon peu de goût pour cette écriture, j'ai paradoxalement trouvé que la lecture était aisée et assez agréable. Peut-être parce que le roman est court. D'autant que j'ai découvert un fait historique que j'ignorais totalement, la guerre des cafés, liée à la guerre d'Algérie.
Après, c'est un livre qui donne un peu trop pour moi dans les bons sentiments. C'est un roman qui prêche - le mot n'est pas trop fort - la réconciliation et je ne vois rien à redire à ça d'une manière générale. Maintenant, quand, à la toute fin de l'ouvrage, cet effort de réconciliation prend la forme d'un rapprochement, initié par une assistante sociale, entre une mère et sa fille adolescente, la première ayant forcé la seconde à se prostituer, je dis qu'il ne faut pas tout confondre. Déjà, le thème se délite complètement à vouloir finir sur une situation qui n'a rien à voir avec l'intrigue, même si j'ai bien compris que le but des personnages et de l'auteur, c'était de travailler sur une réconciliation générale et quotidienne. J'ai été très choquée par le fait qu'un cas de maltraitance et d’exploitation sexuelle soit mise sur le même plan que des rancœurs tenaces liées à une guerre, à l'histoire de deux pays, dont l'un a colonisé l'autre pendant un temps. Non seulement, j'estime que ça n'a strictement rien à voir, mais je trouve également que c'est très dangereux. En mettant en avant à tout prix le besoin de réconciliation, on se retrouve à mettre cette femme face à sa fille en rejetant toute idée de crime, de justice, de victime, de traumatisme, de reconstruction d'un psychisme brisé, pour clamer l'idée que c'est le dialogue qui est important entre les gens, avant toute autre chose. Alors là je dis non, non, et non. Les bons sentiments, c'est bien joli, mais tout voir sous le jour du pardon et de la réconciliation, c'est aussi complètement occulter la souffrance. C'est une arme dévastatrice pour les victimes. Ce choix de situation pour terminer l'ouvrage a pour moi complètement gâché le reste, bousillé tout le discours (qui ne va tout de même pas très loin) sur les cicatrices encore ouvertes de la guerre d'Algérie. Trop de bons sentiments, ça peut être ravageur.