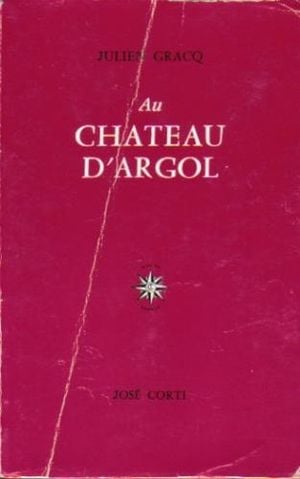Au château d'Argol est l'unique roman de Julien Gracq que j'aie lu, avec La maison. Mais je vous invite bien sûr à croiser cette critique avec d'autres.
Ce roman fait partie de des nombreux romans du XXème siècle qui sont scriptibles (pour reprendre le terme de Barthes), c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas déchiffrer facilement, qu'il est assez exigeant pour le lecteur.
D'abord le style de Gracq est très agréable, du moins dans la première partie du livre : nous avons un magnifique portrait d'Albert, le personnage principal, puis la description en mouvement de la campagne bretonne, puis du château labyrinthique et menaçant qu'il vient d'acheter… On se pâme voluptueusement dans ses descriptions touffues, aux phrases avec une architecture cyclique… Puis dès que les autres protagonistes arrivent, une complexité apparaît : il faut se plonger plus profondément dans la lecture si on veut suivre l'intrigue qui est brouillée par l'éther des mots de Gracq.
L'intrigue se déroule dans un cadre aristocratique, utopique. Une passion amoureuse, accompagnée du fameux troisième personnage – ou rival – qui se tient en embuscade, sur un fond d'instabilité aqueuse et lunaire. L'intensité positive ou négative – voire suicidale – des personnages vont bien avec l'ennui aristocratique qui est la plaie de ces milieux-là.
Le roman reste toujours énigmatique après la première lecture, et c'est à nous de décider, d'élucider telle scène si déroutante pour nos repaires contextuels, ou tel événement si contraire à ce à quoi semblait vouloir nous amener le récit.
C'est un roman contemplatif, autotélique, puissant dans sa prise de parole où les déploiements de propositions grandement délicats et pudiques servent à la fois de cachette et de haut-parleur sur une réalité indicible. Je réécrit en guise d'illustration un exemple de cette voix, tiré de la deuxième partie :
"Elle paraissait entièrement vêtue d'étoffes blanches, d'un travail remarquablement délicat, – aux plis amples, parmi lesquels jouaient ses mains roses. Son visage était divers comme les heures du jours, et la combinaison magnifique des plans y semblait réalisée d'une façon telle que l'on eût dit un prisme où tout rayon de lumière qui l'atteignait dût rester enfermé et rester sous sa peau d'une clarté douce, une cristallisation animée du jour."
J'ai vu la critique d'un autre internaute sur ce site qui affirme que le livre est dégoulinant de sentimentalisme. C'est complètement faux pour deux raisons : d'abord, les personnages sont en proie à un Ennui terrible dans ce grand château fantomatique et on sait (entre autre grâce à Jean Giono) que l'ennui est porteur d'une véritable menace de pulsion de mort ou de crime pour ceux qui l'éprouvent. L'enjeu principal n'est pas de vivre une romance – et d'ailleurs pour mieux dire : il n'y en a pas ! Il n'y a qu'une passion vouée à un funeste destin.
Ensuite, Gracq, sans éluder la sensualité et la complexité des sentiments, reste très froid dans sa narration. Chaque mot semble poinçonné sur du papier glacé. C'est ce mélange habile entre le feu et la glace qui relève d'une prouesse d'écrivain. Car si feu il y a, il n'éclate presque jamais en pleine lumière : il y a toujours un écart, un grand délai de perception entre l'observation des faits et le ressenti des personnages. C'est ce décalage environnement (le château, la forêt et la mer) et intériorité qui entraîne dans une perception d'apparence noble, sensible, élitiste, totalement fantasmée et comme tragiquement coupée des rapports spontanés que l'on peut avoir avec le monde.
Je comprends très bien que ce livre ne plaise pas à tous. Mais si vous êtes sensible à la puissante beauté d'une histoire d'amour gelée, et nostalgique de valeurs médiévales que vous n'avez même pas connues, alors ce livre est pour vous.