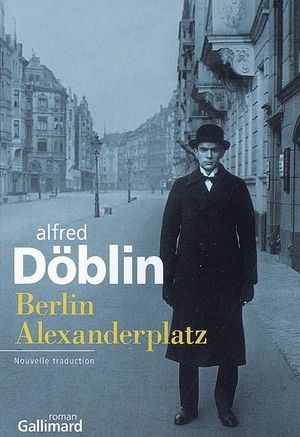Un livre très farfelu, qui part dans tous les sens, brouille les pistes à l’aide phrases extrêmement alambiquées. Si les premières pages du livre peuvent décontenancer, l’on s’adapte puis l’on prend vite plaisir à se laisser balader par le rythme effréné des petites saynètes, anecdotes et autres bars miteux du Berlin des années 1920.
L’argot majoritairement présent permet de donner une véritable violence au phrasé, confinant parfois à l’horrifique (scènes d’ l’abattoir qui ne sont pas sans rappeler
Le bras perdu de Franz, devenu un véritable bestiau prisonnier d’une jungle urbaine.)
La perdition progressive de Franz dans le bruit blanc incessant de la ville, malgré sa volonté de rester intègre, le ramène à une véritable animalité qui pousse la description vers celle d’une bête de somme (jarrets musclés et autres détails anatomiques)
M).
Le récit s’appuie également sur l’évocation de mythes divers, plutôt de paraboles qui forment une tresse avec le récit, dessinant au fur et à mesure un personnage vaincu par la fatalité, victime, plus que d’un homme (Reinhold), d’une immense machine (politique, sociale, intime) qui broie les individus aussi bien moralement que physiquement.
Döblin nous montre un Berlin plein de vie, aux soirées enivrantes, aux vies décousues qui se retrouvent autour d’un schnaps. Un Berlin populaire et politique, mais pouvant se montrer suspicieux, hostile et brutal. Ces dans ces petites magouilles qui semblent contenir autant d’existences grouillantes, énigmatiques que de vices plaisants, que l’intégrité ne suffit plus.
Le récit démarre vraiment lors de la rencontre avec Reinhold, donnant naissance à de véritable enjeux narratifs et moraux, avant cela, il est difficile d’accès et très échevelé.